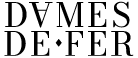Le projet DAMES·DE·FER est délibérément ancré dans le contexte de l’instauration, en 1789, de la liberté de la presse, qui correspond à une libération de la parole – notamment des femmes –, tout en tenant compte de la réintroduction, pendant la période dite de « la Terreur », d’une forme de censure. Il s’attache à étudier les modalités de l’expression des femmes dans l’espace public, au sein ou, le plus souvent, en dehors des assemblées où la profération directe de leur parole n’est pas tolérée, au cours d’un processus historique marqué aussi, fin mars 1793, par l’interdiction des clubs de femmes. Émanant parfois explicitement de femmes ou d’hommes, le plus souvent anonymes, les discours et les écrits considérés abordent des questions centrales sur la place des femmes dans une société française qui connaît des bouleversements en profondeur.
Ce projet comporte deux volets principaux.
Une collection
La collection de ces textes vise la constitution d’une archive, à construire et à structurer, qui
— donne à lire, avec un accompagnement critique (annotation, dossier critique), des textes, établis selon des normes philologiques rigoureuses, publiés entre 1789 et 1804, sur la représentation des femmes qui expriment les points de vue des et/ou sur les femmes pendant le processus révolutionnaire. Leur (ré-)interprétation bénéficie des apports des outils, concepts et méthodes des études littéraires et des études sur le genre ;
— par les liens tissés entre les différents textes, a pour ambition de mettre au jour la circulation des idées et des discours au cours de la période, et de proposer, dans des dossiers transversaux, des synthèses sur les questions saillantes abordées et/ou débattues dans les textes constituant l’archive.
Un répertoire d’actions
Orientées dans une perspective de médiation scientifique, qui repose sur trois types de contenus :
— autour des manifestations scientifiques organisées dans le cadre du projet, l’insertion de capsules vidéo exposant, à l’intention d’un public élargi, des synthèses sur les grands débats qui traversent l’espace public au cours de la période étudiée et au-delà ;
— la déclinaison pédagogique, en concertation avec des enseignantes et enseignants du secondaire, des dossiers scientifiques transversaux, ainsi que des dossiers spécifiquement conçus en fonction des programmes du collège et du lycée ;
— des expositions virtuelles reprenant les expositions physiques organisées sur des thématiques en lien avec les sujets abordés dans les textes réunis au sein de la collection.