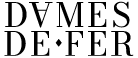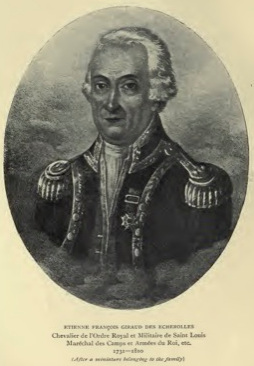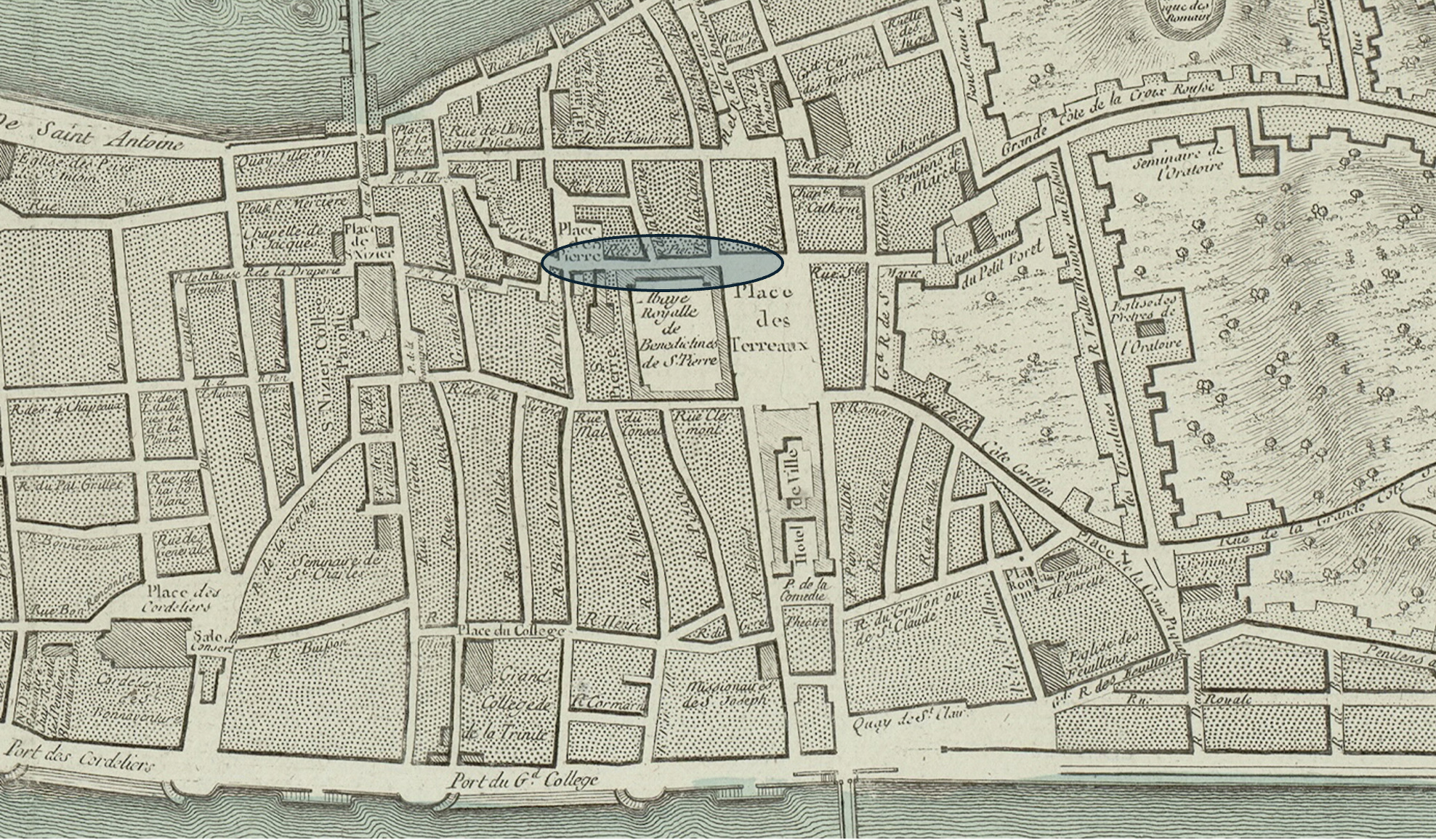Quelques années de ma vie
Liste des abréviations
AD : Archives départementales
ADR : Archives départementales du Rhône et de la métropole de Lyon
AML : Archives municipales de Lyon
AN : Archives nationales, Paris
L’autrice
« Alexandrine des Écherolles » naît le 28 septembre 1779 aux Écherolles, dans l’Allier, à vingt kilomètres au sud de Moulins, canton de Neuilly-le-Réal, commune de La Ferté-Hauterive. Elle est baptisée dans la paroisse de Saint-Loup, non loin des Écherolles où ses parents possèdent un domaine 1 .
Elle naît sous le nom de Giraud. Comme souvent aux filles, on ne donne pas le nom de la terre, dont elles ne sont pas censées hériter du titre, mais simplement le patronyme du père. C’est ainsi que nous l’appellerons désormais, suivant ainsi l’usage et, par-là, le nom sous lequel elle était généralement connue de ses contemporain·es.
On lui donne les prénoms de Étiennette Marie Charlotte Alexandrine. Elle naît fille légitime de Étienne François Giraud seigneur des Écherolles et chevalier de Saint-Louis, lieutenant-colonel et commandant du Bataillon de Garnison de Royal, et de Marie Odile Anne Tarade 2 . Son parrain est messire Étienne Nazaire Girard, écuyer et seigneur de Montifaut ; sa marraine est « madame de Malestros de Quemarra [Kermarchar 3 ] de Postemoguire [Portzmoguer 4 ], épouse de monsieur de Tarade » (oncle de la baptisée, écuyer, chevalier de Saint-Louis et lieutenant de vaisseau) ; ne s’étant pas déplacée pour l’occasion, elle a demandé à Marianne Lagoute, femme de chambre de la jeune mère, Madame des Écherolles, de la représenter 5 . Alexandrine Giraud est la dernière-née d’une fratrie de trois frères et une sœur aînée 6 . Comme ses frères et sa sœur, elle grandit au domaine dit des Écherolles.
Orpheline de mère, à l’âge de 7 ans, en 1786, la petite fille est confiée à sa tante, Marie Anne Giraud des Écherolles, qui vit à Moulins 7 . Cette tante originale, très riche, joue le rôle de mère de cœur auprès des enfants, en particulier auprès de la benjamine.
Alexandrine Giraud n’a pas tout à fait 10 ans quand la Révolution éclate. Après les premières années qui voient son père s’engager dans la garde nationale de Moulins, elle doit fuir sa ville natale avec sa famille et deux domestiques pour rejoindre Lyon, quelques semaines avant le siège de la ville 8 ; elle vit l’été 1793 au rythme des bombardements, au plus près des combats, aux côtés de son père engagé militairement dans la défense de la ville. Après que Lyon est devenue « Ville-Affranchie » en octobre 1793, la toute jeune fille (elle vient d’avoir 14 ans) assiste à l’arrestation de sa tante 9 . Elle lui rend visite à la prison des Recluses presque tous les jours, multiplie les démarches pour obtenir sa libération, en vain. Marie Anne Giraud est guillotinée le 11 février 1794 10 .
Commence alors, pour la jeune fille, une période qui lui laissera le souvenir d’une intense solitude : privée de ses frères, tous deux soldats sur différents fronts, de son père enfui vers la Suisse, elle trouve refuge dans des familles amies, dans le Rhône d’abord, puis dans l’Allier et la Nièvre, en général dans des habitations reculées, loin des villes plus surveillées 11 .
La vie d’Alexandrine Giraud connaît un tournant majeur à la fin de la décennie révolutionnaire, lorsque la famille a perdu tout espoir de racheter ses biens. Le père, revenu d’exil, rayé de la liste des émigrés, n’obtient qu’une demi-pension de militaire et doit chercher du travail. Un ami lui en propose à Lyon. Bien que ruiné, le veuf se voit proposer le mariage par une femme presque aussi ruinée que lui, cherchant à échapper à l’emprise de sa famille. Ce remariage, et la difficulté économique de vivre à trois avec les revenus diminués du nouveau couple, poussent Alexandrine Giraud à prendre à son tour le chemin de l’exil. Pour subvenir à ses besoins, elle accepte une place de gouvernante des filles aînées de la duchesse de Wurtemberg, à Stuttgart 12 . Ayant accédé, quelques années plus tard, au statut de dame d’honneur, puis devenue chanoinesse du chapitre de Sainte-Anne de Munich, elle y aurait acquis, selon Jean R. Marboutin, « une très grande influence qu’elle mit au service de la religion catholique 13 ».
Elle rédige ses mémoires qu’elle publie en 1843. Entre-temps, elle élève sa nièce Maria, fille aînée de son frère cadet « Chambolle », à laquelle elle dédie son ouvrage 14 .
On trouve, dans l’une des traductions anglaises de cet ouvrage 15 , un portrait réalisé à partir d’une miniature appartenant à la famille :

Dame d’honneur de S.A.E. Mad. la Duchesse de Wurtemberg
Dame Chanoinesse de l’Ordre Royal de Ste. Anne de Bavière
1779-1850
Les Archives départementales de l’Allier disposent d’une description très précise d’Alexandrine Giraud, à l’âge de 16 ans :
« Nous, membres composant l’administration municipale du canton de Bessay, certifions, sur l’attestation des citoyens Michel Quilleret, Jacques Ray…, tous domiciliés dans la commune de La Ferté-Hauterive… que la citoyenne Alexandrine Giraud des Echerolles, rentière de la municipalité de Vaize, département du Rhône, âgée de seize ans, taille de quatre pieds, six pouces [137 cm], cheveux et sourcils châtains, front bien fait (sic), yeux gris bleus, nez bien fait (sic), bouche grande, menton rond, visage oval et uni, réside sans interruption dans la dite commune de La Ferté-Hauterive, maison appartenant au citoyen Giraud, son père, depuis le 29 ventôse dernier jusqu’à ce jour. » Fait en la maison commune de Bessay et signé par Alexandrine Giraud des Echerolles (9 floréal [an IV ; 28 avril 1796]) 16 .
L’autrice n’a publié que ce récit, dont il existe plusieurs éditions 17 .
Les membres de la famille
Les grands-parents
L’autrice ne fait mention que de ses grands-parents paternels, bien qu’elle ne les ait pas connu·es.
Côté paternel
Sa grand-mère paternelle est Jeanne Marie Martiale Melon (née entre 1695 et 1705, décédée en 1773 18 ), originaire du Nivernais. Elle est la fille d’un receveur des tailles de Nevers, Charles Antoine Melon du Verdier 19 , et d’Edmée Sallonyer.
L’autrice, comme souvent dans son récit, valorise le rôle des femmes. Sa grand-mère, déclare-t-elle, était « douée d’une tête forte et de beaucoup d’esprit » : alors que son mari courait les bois quand il n’était pas sur les champs de bataille, Martiale Aimée Melon « remédia au désordre que le genre de vie de son mari apportait dans ses affaires. Un sage discernement, joint à une grande activité, sauvèrent la famille d’une ruine inévitable ; et mon grand-père qui n’aimait à s’occuper que de ses plaisirs, satisfait de l’aisance que la prudente économie de sa femme répandait autour de lui, jouissait commodément du bien-être qu’il devait à ses soins. » (p. I-2) [p. ] C’est une description qui lui a été rapportée puisque Alexandrine Giraud naît en 1779, six ans après le décès de sa grand-mère.
Le couple des grands-parents paternels se marie le 14 mars 1730 à Nevers 20 . Si Martiale Melon est née en 1695, il est remarquable que l’épouse soit plus âgée que l’époux, car le phénomène était extrêmement rare : les épouses étaient recherchées pour leur capacité à engendrer une descendance pour la branche paternelle de leur époux. Le fait d’avoir des biens pouvait éventuellement compenser l’âge, mais une jeune fille bien dotée n’attendait pas l’âge de 35 ans pour se marier. Si elle est née en 1705, comme le laissent penser les biographies consultées, elle n’a que 25 ans au moment de son mariage, ce qui est beaucoup plus dans la norme.
Gilbert François Giraud des Écherolles (1702-1759 21 ) est un infatigable combattant et chasseur, sur lequel sa petite-fille n’a que peu à dire, sinon ce qui a été mentionné plus haut ; on sait qu’il enrôle son fils très tôt pour en faire un soldat intrépide.
Côté maternel
Les grands-parents maternels de l’autrice sont Jacques Gabriel de Tarade, né en 1683 à Strasbourg (on ignore sa date de décès), et Anne Marie du Pont (ou Dupont) du Vivier, dont on ne connaît, à ce jour, ni la date ni le lieu de naissance, non plus que la date de mort. On sait seulement que leur fille Odile est orpheline de ses deux parents en 1748 22 . Le couple se marie à Paris le 6 mars 1734 23 et a au moins quatre enfants, dont Jacques François Marie de Malestros de Tarade dont il est fait mention rapidement dans Quelques années de ma vie, et Odile de Tarade, la mère de l’autrice, elle-même orpheline dès l’âge de cinq ans, en 1747. Ses enfants n’ont donc pas non plus connu leurs grands-parents maternels.
La mère : Marie Anne Odile de Tarade (1742-1786)
Marie Anne Odile de Tarade serait née en novembre 1742 24 à Paris. D’après l’autrice, sa mère sort d’un couvent à Paris pour se marier en 1767 avec Étienne François Giraud des Écherolles ; elle a (probablement) 25 ans.
L’autrice, qui l’a peu connue mais qui, on le verra, a une mémoire prodigieuse, décrit sa mère dans les termes élogieux que lui a rapportés son entourage. Au moment de son mariage, écrit-elle, « ses goûts étaient tranquilles ; la retraite où elle avait passé sa vie à cultiver son esprit et ses talents lui avait fait contracter l’habitude des occupations sérieuses. Pour ses amis, elle était charmante, et mon père trouva près d’elle un bonheur doux et sûr. » (p. I-4 et I-5)
Plus loin, elle poursuit :
Le monde et la société n’avaient aucun attrait pour elle. Distraite, parlant peu, jouant mal, elle y était méconnue. Mais les qualités de son cœur et de son esprit la rendaient chère à ses amis. Sa grande bienfaisance la faisait aimer du pauvre, et sa piété sincère inspirait à tous une juste vénération. Je n’ai vu aucune des personnes qui l’avaient connue me parler d’elle sans lui donner les plus vifs regrets. Bientôt mûre pour l’éternité, elle fut enlevée à sa jeune famille. Je n’avais alors que sept ans. Elle laissa quatre enfants : deux fils et deux filles. (p. I-5)
Marie Anne Odile de Tarade, épouse Giraud, décède après avoir mis au monde au moins sept enfants, en 1786, à l’âge de 40 ans ; elle est inhumée comme son fils Étienne François Louis à Saint-Gérand-de-Vaux, non loin des Écherolles, le 8 septembre 1786 25 .
D’après l’autrice, elle était « [c]hérie de tous les paysans des Écherolles, chacun d’eux crut perdre une mère ; ils ne se trompaient pas » :
Ses adieux furent touchants, et, malgré mon jeune âge, me firent une impression que le temps n’effaça jamais. […] Elle défendit tout frais de luxe pour sa sépulture, disposa de la somme qu’on y aurait employée pour doubler les aumônes qu’elle ordonna de distribuer aux nécessiteux, et fit habiller beaucoup de pauvres. Plus j’ai réfléchi depuis sur cette perte, et plus j’ai compris son étendue. Dans quel abandon se trouvent les jeunes enfants privés de leur mère, sevrés des soins et de la prévoyance de ce cœur qui jamais ne sommeille. (p. I-6-I-7)
D’après l’autrice toujours, sa mère est restée inconsolable d’avoir confié sa fille Odille à une nourrice qui lui aurait transmis une maladie – qu’elle ne nomme pas, mais qu’on pense être la syphilis. Ainsi, elle explique que, « [a]yant une santé très délicate », sa mère « n’avait pu nourrir elle-même aucun de ses enfants » (n. 1, p. II-87).
On n’en apprendra guère plus sur cette femme.
Le père : Étienne François Giraud des Écherolles (1731-1810)
Étienne François Giraud des Écherolles (désormais désigné comme Étienne Giraud des Écherolles) est né le 24 janvier 1731 26 à Moulins. Il a un frère, Pierre Marie, né en 1732 27 , et une sœur, Marie Anne, née en 1733 28 .
Carrière
Toute sa carrière, et on peut dire l’essentiel de sa vie, est consacrée à se battre. Après avoir obtenu (à une date que l’on ignore à ce jour) la croix de Saint-Louis, qui récompense le mérite militaire, avoir combattu dans les armées royales et reçu moult blessures, il est, au moment des préparatifs du siège de Lyon, sollicité pour en prendre le commandement. Ayant décliné l’offre du fait de son âge, il accepte cependant de contribuer à la défense des postes de Saint-Irénée et Saint-Just.
Son père l’enrôle dans l’armée vers l’âge de 9 ans :
Il voulait le former de bonne heure aux fatigues et à la vie dure des camps, et non-seulement il y façonna ce petit guerrier en herbe, mais il lui adjoignit encore une douzaine de cousins du même âge, qu’il se plaisait à aguerrir : petite troupe pleine de courage, qui se jetait gaiement à travers le péril. Tous devinrent d’honnêtes gens et de braves soldats. (p. I-2)
Dès l’âge de 12 ans, Étienne, blessé, garde au visage la marque de ce coup de sabre, dont il se fait une gloire : « Ce petit officier, bientôt échangé, revint tout fier de rapporter une glorieuse cicatrice, bien visible, car elle s’étendait en demi-cercle de l’oreille à la lèvre supérieure. » (p. I-4) Une gloire et un argument de séduction, comme en témoigne son fils lorsqu’ils paradent à Paris, en 1790, sous les regards des femmes. C’est Chambolle qui raconte la matinée passée à préparer la « plus belle tenue possible », et qui mentionne la présence, aux fenêtres de l’habitation qu’il occupe avec son père, d’une certaine Agathe, « toute glorieuse et pimpante », n’ayant d’yeux et des soins que pour « le beau balafré », son père. Et il ajoute :
Je ne parlerai donc plus de cette parisienne, vrai modèle de ces servantes maîtresses, au joug desquelles se soumettent, par habitude, les célibataires qu’elles dorlotent. Elle eut raison, car elle pouvait espérer de mon père au départ de riches étrennes, tant le Bourbonichon est généreux et de moi, tout au plus, ces trois mots : “Au revoir, Agathe……….” 29 .
Consciente du peu d’instruction reçue par son père, l’autrice l’explique par cette enfance entraînée de manière précoce à combattre et chasser. Aussi, conclut-elle, faut-il plus s’étonner « de ce qu’il savait que de ce qu’il ne savait pas » (p. I-4).
Mariage
En 1767, vers l’âge de trente-six ans, Étienne François Giraud des Écherolles épouse mademoiselle de Tarade 30 . Le couple fait baptiser cinq enfants, dont quatre atteindront l’âge adulte. [p. ] Étienne Giraud de Écherolles devient veuf en 1786.
Engagement dans la Révolution
Lorsque la Révolution débute à Moulins, Étienne Giraud des Écherolles est nommé d’office chef de la garde nationale 31 . À ce titre, il prend la route avec la délégation du département, le 8 juillet 1790, pour rejoindre la fête parisienne de la Fédération. Le groupe, assez nombreux puisqu’il est constitué des représentants du département, du district, de la municipalité et des gardes nationales de douze villes de l’Allier, revient sous les acclamations. Il est porteur d’une relique à laquelle on prête des « pouvoirs miraculeux » : sur la bannière fédératrice sont brodées, sur fond blanc, des couronnes de chêne, et à l’intérieur, les mots de Constitution de 1790, Confédération nationale de Paris, 14 juillet 1790, Département de l’Allier 32 . Il n’est pas certain que le père d’Alexandrine partage cette ferveur populaire. Pour certains historiens, il s’est rendu à Paris « dans l’espoir d’entraîner le Roi dans un coup de force contre l’Assemblée constituante 33 ». Sa fille confirme qu’il en « revint au désespoir », s’étant « flatté qu’à cette fameuse journée du Champ-de-Mars, le roi, se mettant à leur tête, marcherait contre l’Assemblée nationale pour la dissoudre. “Ce parti, disait-il, eût sauvé la France et le roi qui ne sut pas profiter de l’enthousiasme qu’il inspirait encore.” » (p. I-13)
Ayant démissionné de sa charge de colonel de la garde nationale, sous la pression du peuple qui l’accuse d’avoir remis en liberté Noailly, un « accapareur de grain », il est arrêté le 24 juin 1792 au motif qu’il a cherché à constituer une compagnie à cheval composée de jeunes gens issus des meilleures familiales moulinoises, avec le dessein de « détruire la Liberté ». Après deux mois de détention, le tribunal reconnaît son innocence et le fait libérer 34 .
Rôle pendant le siège de Lyon
Comme on l’a vu, Étienne Giraud des Écherolles continue de jouer un rôle militaire actif même à un âge considéré comme avancé à l’époque : il a 62 ans quand on le sollicite pour prendre la tête du commandement en charge de la défense de Lyon contre l’assaut mené par les troupes de la Convention. Il refuse ce poste trop exigeant mais accepte de se mettre sous le commandement du chevalier de Mélon 35 sur la colline « qui prie » (par opposition à la colline « qui travaille », celle de la Croix-Rousse), aux portes de Saint-Irénée et Saint-Just.
L’émigré
Après le siège, alors que la ville est tombée, il est placé sur la liste des émigrés du département de l’Allier, le 31 octobre 1793, et ses biens sont saisis 36 .
Dans les mois qui suivent, alors que la répression s’abat sur Ville-Affranchie et qu’il est activement recherché, il doit se cacher, puis fuir la ville. Il erre de famille en famille jusqu’à la rencontre, à « Fontaine 37 », des Chazière qui lui offrent un abri temporaire mais sûr, à quelques mètres de la frontière avec le département de l’Ain. Il émigre ensuite en Suisse 38 , avant de retrouver Moulins et de se faire rayer définitivement de la liste des émigrés. Ses biens, après avoir été mis sous séquestre, sont vendus.
Malgré ses efforts, il ne lui reste pas une fortune suffisante pour les racheter, et doit à la générosité de rares acquéreurs de s’en faire céder quelques-uns à bon prix. Le château et la terre des Écherolles, bastion de la famille, échappe à cette tentative de réinstallation, et la famille quitte définitivement Moulins.
Remariage
Quelque temps après, alors qu’il a accepté depuis peu la responsabilité du bureau lyonnais des vélocifères, Étienne Giraud des Écherolles se remarie, le 5 mars 1804, avec Catherine Cirlot 39 (1753-1828). Il a 73 ans, elle en a 50. Le couple s’installe probablement rue Saint-Joseph (actuelle rue Auguste Comte), au numéro 154 ; c’est encore là qu’il habite au moment de son décès.
Étienne Giraud des Écherolles fait ses adieux à sa fille lorsque celle-ci comprend qu’elle pèse sur la fragile économie du couple, et s’apprête à prendre une place de gouvernante à l’étranger.
Il meurt le 16 novembre 1810 à l’âge de 79 ans à Lyon 40 .
Très souvent, au cours de son récit, Alexandrine Giraud décrit un père à l’énergie difficile à canaliser. Un exemple suffira à illustrer cette disposition. Alors qu’Étienne Giraud des Écherolles se cache à Vaise, dans la maison de la famille Guichard, il se fait surprendre par un agent de l’administration qui, grâce à la présence d’esprit de l’hôtesse, accepte de se laisser soudoyer. Le militaire a désormais comme mot d’ordre de ne plus sortir, même de nuit :
[…] la vie lui devenait odieuse et la contrainte irritait son ame ; il voyait un beau jardin devant lui, et n’osait y faire un pas : c’était le supplice de Tantale. Privé d’exercice, son sang s’agitait, la véhémence de son caractère s’exaltait par tant de contrariétés ; son esprit s’aigrissait, et plein d’amertume et d’impatience, il appelait à grands cris la liberté ou la mort. Que de fois il m’a répété — : J’aime mieux mourir que de vivre comme je vis ; que l’on me prenne, que l’on me guillo[ti]ne, ce sera fini ; je ne puis supporter une semblable existence, mieux vaut mourir. — Et moi, mon père, et moi ! que deviendrais-je ? (p. II-79)
La traduction anglaise de 1904, déjà mentionnée, comporte également un portrait réalisé à partir d’une miniature appartenant à la famille :
La fratrie
Marie Odile de Tarade met au monde au moins six enfants 41 . Parmi ces enfants dont aujourd’hui nous connaissons les prénoms, tous les garçons, sauf un, portent le premier prénom de leur père, Étienne. Même l’autrice porte le nom féminisé de son père, Étiennette 42 .
Comme souvent dans les familles à l’époque, même lorsqu’elles sont bien dotées en capitaux économiques et sociaux, et quoique entourées de médecins et d’une nombreuse domesticité, quatre enfants seulement survivent jusqu’à l’âge adulte. Nous n’indiquons, ci-dessous, que les noms des enfants dont on a pu retrouver la trace dans les archives, et indiquons en gras celles et ceux qui ont survécu au-delà de leur enfance 43 :
- Jacques Martial François Giraud des Écherolles, né en 1769.
- Anne Denis Louis Étienne Giraud des Écherolles, né en 1773.
- Étienne François Louis Giraud des Écherolles, né en 1774.
- Joseph Marie Étienne Giraud des Écherolles, né en 1775.
- Odille Antoinette Victoire Giraud, née en 1776 44 .
- Étienne Giraud des Écherolles, né en 1777.
- Étiennette Marie Charlotte Alexandrine Giraud, née en 1779 45 .
Jacques Martial François Giraud des Écherolles (1769- ?)
Jacques Martial François Giraud des Écherolles, né le 22 juillet 1769, a été baptisé plus de six mois après sa naissance, le 30 janvier 1770, dans la paroisse de Saint-Pierre-des-Ménestraux, à Moulins 46 . Il était exceptionnel que les enfants soient baptisés à une date si éloignée de leur naissance. En général, c’est une faiblesse extrême du nouveau-né qui empêchait de transporter l’enfant à l’église, et retenait les parents de prendre le risque d’un décès sans baptême. Dans ce cas, on faisait « ondoyer » l’enfant au domicile. Son parrain est messire Jacques Marie François Tarade ; sa marraine est dame Jeanne Marie Martial Melon, épouse de messire Giraud des Écherolles, ancien capitaine grenadier.
Comme son père, il entre très tôt dans l’armée : il a 13 ans quand il devient officier de cavalerie. L’autrice, qui justifie son père dans tous ses choix, n’en désapprouve pas moins ce qu’elle appelle « l’abus de ces émancipations prématurées » (p. I-5-I-6) :
Il n’y a pas de doute qu’un enfant lancé dans le monde, sans être fortifié par une éducation sage et par la maturité qu’amènent la réflexion et les années ; il n’y a pas de doute, dis-je, que cet enfant, sitôt jeune homme, ne soit exposé à des dangers trop grands pour qu’il n’y succombe pas. Les nombreuses exceptions qui existent ne sauraient diminuer la force de cette vérité. L’enfant qui sera assez malheureux pour jouer à treize ans le rôle d’un homme, ne sera le plus souvent, pendant toute sa vie, qu’une plante amaigrie qui s’allonge sur la terre sans y produire de bons fruits, et dont les racines faibles, à moitié rompues, ne sauraient porter à sa tige les sucs vigoureux qu’elles auraient puisés dans une éducation sagement surveillée 47 .
Il est à noter qu’elle n’aura pas le même jugement sur son frère Chambolle, pourtant lui aussi enrégimenté très tôt.
Si Alexandrine n’évoque jamais ou presque ce frère, on trouve dans les archives des traces de sa présence à Lyon. Elles étonnent, car elles attestent (ou voudraient attester) que Martial est détenu à Ville affranchie du 13 octobre 1793 au 30 pluviôse an II (18 février 1794), dans la maison d’arrêt de Saint-Joseph, la même où sa tante est incarcérée après son transfert depuis les Recluses, et où sa propre sœur vient rendre visite à Marie Anne Giraud. L’autrice ne fait jamais allusion à cette incarcération, dont on ne sait dire si elle-même l’ignore, si elle souhaite la taire au moment de l’écriture de son récit, ou si son frère s’est servi d’un faux certificat pour obtenir sa radiation de la liste des émigrés. Le même certificat atteste que Martial Giraud réside à Lyon jusqu’en fructidor de l’an V, rue Poulaillerie d’abord, puis au numéro 69 de la rue Saint-Dominique chez un dénommé Joachim Chapeau 48 .
Un autre certificat atteste que Martial aurait même résidé à Lyon du 3 mai au 9 octobre 1793 49 . Enfin, une lettre du greffier des prisons de Saint-Joseph certifie que « conformément aux Registres du Greffe des dites prisons Le Citoyen Joseph François Martial Giraud a été incarcéré dans la ditte prison le treize du Mois d’octobre dix sept cent quatre vingt treize, par ordre du Comité de surveillance Comme prévenu de Rebellion Lyonnaise 50 ».
Quand Alexandrine Giraud évoque son frère Martial, c’est d’une manière détachée qui diffère considérablement de la tendresse qu’elle montre pour son autre frère, Chambolle (qui le lui rend bien). Il faut dire aussi que Chambolle, père de onze enfants, est l’exception qui confirme la règle si, par « plante amaigrie qui s’allonge […] sans y produire de bons fruits », elle fait référence, dans ce jugement sévère contre Martial, à la capacité de procréer.
Jacques Martial François Giraud des Écherolles meurt à Naples à une date que nous n’avons pas pu retrouver.
Anne Denis Louis Étienne Giraud des Écherolles (1773- ?)
Nous n’avons guère d’informations sur cet enfant né le 13 janvier 1773 dans la paroisse de Saint-Pierre-des-Ménestraux de Moulins 51 . Sa marraine est Marie Anne Giraud des Écherolles. Nous ignorons à quelle date il meurt, faute d’avoir retrouvé l’acte de son décès dans les registres d’état civil (nous avons consulté ceux de Moulins et de Saint-Gérand-de-Vaux).
Étienne François Louis Giraud des Écherolles (1774-1783)
Étienne François Louis Giraud des Écherolles est né le 30 mars 1774 ; il a été baptisé le lendemain, 31 mars, en la paroisse de Saint-Pierre-des-Ménestraux à Moulins 52 .
Lors du baptême d’Alexandrine, en 1779, il est témoin, bien qu’il n’ait que 5 ans. L’autrice, qui a environ 4 ans quand son frère décède, n’en parle jamais, pas même une fois pour mentionner son existence.
Il meurt le 11 décembre 1783, à l’âge de 9 ans, inhumé au cimetière de Saint-Gérand-de-Vaux le lendemain 53 . Lorsque sa mère décède, trois ans plus tard, elle sera également inhumée dans ce cimetière.
Joseph Marie Étienne Giraud des Écherolles (1775-1865)
Joseph Marie Étienne Giraud des Écherolles est baptisé dans la même paroisse que ses frères, celle de Saint-Pierre-des-Ménestraux, à Moulins, le 17 mai 1775 54 . Sa marraine est sa tante paternelle, Marie-Anne Giraud des Écherolles 55 .
C’est lui que l’autrice nomme Chambolle. On le trouve aussi identifié comme Combye 56 .
Aux Écherolles, il a pour précepteur un certain abbé Pinglin, dont il garde un « très mauvais souvenir 57 ». Comme son frère, il entre très tôt dans l’armée : dès l’âge de 12 ans, en 1787, il intègre l’école militaire de Metz comme aspirant au corps royal de l’artillerie 58 .
En 1789, revenu à Moulins, il est nommé sous-lieutenant dans la garde nationale. En 1790, il semble qu’il soit lieutenant des grenadiers royaux 59 ; il est aussi envoyé à Paris avec son père, alors colonel de la garde nationale de Moulins, pour la fête de la Fédération 60 . On a, de lui, des souvenirs de ces jours de découverte de la ville et de ses lieux de plaisir, d’émotions au spectacle du roi et de sa famille, mais aussi de déception 61 . Ces souvenirs ont été dépouillés par un historien, Jean R. Marboutin, qui en a livré des synthèses 62 . Il y décrit un père au caractère violent, emporté, d’une raideur toute militaire, et qui, du fait d’une infirmité corporelle, le voit d’un « assez mauvais œil 63 ».
Les versions divergent, ici, entre le récit de l’autrice et celui qu’il en fait lui-même. Il déclare avoir quitté Moulins, le 25 décembre 1791, pour aller à Paris sur ordre de son père et rejoindre M. de Tarade de Montemont, capitaine d’artillerie, qui se rendait à Maubeuge. Son épouse, une demoiselle de Lavernier, l’accompagne et ne reste pas insensible à son charme 64 . C’est seulement après, dit-il, qu’il rejoint Maubeuge, se mêle à la société militaire, décrivant un milieu libertin. Son père lui ordonne alors d’émigrer : il rejoint à Ath le régiment de « couronne infanterie » dans lequel il s’engage, toujours d’après les notes recueillies par l’historien. Le dossier dans lequel il récapitule ses états militaires, pour le compte du ministère de l’Intérieur, indique que, en 1792, il est « chasseur noble 65 », ce qui correspond aux membres d’un régiment de l’armée de Condé.
D’après Alexandrine Giraud, il est à l’armée de Condé, et c’est lorsque celle-ci est licenciée qu’il rentre en France en passant par Paris. On serait, d’après le témoignage de sa sœur, en 1791, puisque son frère n’a que 16 ans, ce qui ne correspond pas aux dates qu’il indique lui-même 66 .
Toujours selon le récit qu’en fait sa sœur, Chambolle serait resté plus d’un an à la capitale, travaillant chez un tailleur de pierre pour survivre. Lorsqu’il est averti par une « amie de la famille », Mme de Lavernier, que sa famille est à Lyon, il aurait quitté Paris (le jour même de la mort du roi, donc le 21 janvier 1793). À Lyon, un autre ami de la famille aurait offert de l’occuper dans une verrerie qu’il possédait à Rive-de-Gier, une petite ville qui connaissait alors un fort développement de l’exploitation de ses mines de charbon. Il prendrait alors un nom d’emprunt et deviendrait commis, avant qu’un autre allié, M. de Gueriot, commandant de l’artillerie de la ville, lui donne un brevet de conducteur du train d’artillerie, avec la commission de faire des achats de fer et de charbon pour l’arsenal de Lyon, ce qui justifie aussi son séjour à Rive-de-Gier 67 .
Dans les années qui suivent, Joseph Marie Giraud des Écherolles combat sous les ordres de M. de Gueriot, d’abord en Italie, puis à l’armée des côtes de l’Ouest 68 . Apprenant qu’une expédition se prépare pour l’Irlande, il se fait enrôler comme inspecteur général des équipages, aux ordres du général Hardy et du commandant Pernetti, sur la frégate La Coquille. Il assiste à la bataille navale de Swilly (12 octobre 1798 69 ), où il est blessé et fait prisonnier. On retrouve, ici, le récit de l’autrice, qui raconte que son frère est en prison en Écosse. De fait, il est emmené jusqu’à Glasgow, puis détenu au château d’Édimbourg où les prisonniers subissent des « traitements atroces 70 ». Il revient en France huit mois après, à l’automne 1799. Envoyé d’abord à Lorient, où il reste un an, il rejoint M. de Gueriot à Genève, puis le suit à Auxonne 71 .
Les liens semblent forts entre ce frère et cette sœur :
[…] le plus souvent mon frère partagea ce qu’il possédait avec moi. Son amitié devinait ce qui pouvait me manquer ; et sans doute plus d’une fois, ce fut aux dépens de ce qui lui était nécessaire qu’il vint à mon secours. Je ne puis assez dire combien sa tendresse sut adoucir ma triste existence. (p. II-124)
Lorsque, en 1802, il obtient d’être rayé de la liste des émigrés 72 , Chambolle envisage de s’enrôler dans une expédition contre l’Amérique. Sa sœur, qui se dit « tendrement attachée » à son frère (p. II-152), s’en émeut, craignant une nouvelle séparation. Prenant conscience qu’au décès de son père, la jeune femme se retrouvera sans aucun soutien, et redoutant de la voir devenir « sœur grise » (un projet qu’elle nourrit depuis longtemps, lui confie-t-elle), son frère négocie avec succès son propre renoncement à l’expédition américaine en échange du sien à cette carrière religieuse (p. II-152-II-153).
On le perd de vue à peu près à cette époque : l’autrice ne le mentionne plus. On sait qu’il continue sa carrière dans l’armée de Napoléon, où il se fait remarquer par son intrépidité 73 ; il fait la campagne d’Espagne, au cours de laquelle il rencontre celle qui deviendra sa femme, Marie Louise Lucienne de Leygonie [ou Leygonier], fille d’un négociant français installé depuis quarante ans à Séville 74 . Le 17 mai 1811, au moment de son mariage, il est officier à Vérone 75 . Marie Louise Lucienne de Leygonie est enceinte et le couple en informe l’officier d’état civil, reconnaissant l’enfant à naître pour sien ; une petite fille naîtra en juillet, qu’on appellera Maria Amalia : il s’agit de la nièce dédicataire du livre ici édité 76 . Une douzaine de naissances suivront 77 .
Le couple est très mobile, géographiquement, ce que l’on suit aisément en observant les lieux de naissance des enfants. On note ainsi la naissance d’un Louis, le 11 avril 1813, à Kirchheim unter Teck, dans le district de Stuttgart, où vit Alexandrine Giraud. D’après les notes qu’il a laissées, et les recherches de Jean R. Marboutin, « Chambolle » est à Düsseldorf pour commander le train d’artillerie du grand-duché de Berg à partir de 1811, passe aux lanciers de Berg en 1812, jusqu’au licenciement de ce régiment en 1813. Son épouse l’a sans doute suivi en Allemagne, et s’est peut-être installée auprès de sa belle-sœur, raison pour laquelle son fils naît à Stuttgart. Une autre naissance survient à Villefranche, alors que, ayant pris sa retraite de l’armée, le père s’est fait nommer sous-préfet de cette ville. Une autre naissance se situe à Belley, dans l’Ain, où là aussi, après moult péripéties, « Chambolle » occupe le poste de sous-préfet. Une série de naissances a encore lieu à Saint-Gaudens, dans la Haute-Garonne, où il occupe la fonction de sous-préfet. Les dernières naissances sont toutes situées à Agen, alors que, dénoncé par le préfet de Toulouse « comme une tête trop ardente, atteinte de folie », Joseph Marie Étienne Giraud des Écherolles a été rétrogradé secrétaire général de la préfecture d’Agen 78 .
Le couple se fixe finalement dans le Lot-et-Garonne, en 1817, après avoir acquis la propriété de Castelnoubel, près d’Agen. « Chambolle » est, à ce moment, secrétaire général de la préfecture 79 .
Joseph Marie Étienne Giraud des Écherolles, devenu le comte Joseph Marie Étienne Giraud des Écherolles, meurt, veuf depuis vingt-cinq ans, à l’âge de 90 ans, le 30 juillet 1865 à Paris, au numéro 45 de la rue Blomet, dans le 15e arrondissement 80 .
Dans les notes qu’il a laissées, on trouve l’idée qu’il se faisait, en 1802, de son caractère : « Imagination exaltée qui peut entraîner le jugement 81 » ; « [é]ducation manquée ; conséquence, ne pourra qu’être superficiel, ayant la soif du savoir 82 » ; « [m]alin, frondeur, caustique, austère, s’est aliéné l’affection générale » ; « [f]oncièrement bon, loyal, original devant avoir peu d’amis, parce qu’il sera donné à peu de le concevoir, mais sera révéré s’il est apprécié. »
Les documents d’archives livrent à plusieurs reprises un signalement de Chambolle. Ainsi, par exemple, de cet « Extrait des Registres des Déliberations de la Commune de Rivedegier », qui décrit « Etienne Marie Joseph Giraud dit Combye », à l’âge « d’environ Vingt ans » : « Taille de Cinq pieds un pouce et demi, Cheveux Chatains, Sourcils idem yeux Gris bien fendus nez aquilin et Grand, Visage Long pâle et maigre, un peu taché de Rousses, bouche moyenne, menton Rond » 83 .
On a conservé 84 un cliché qui le représente en pied, vêtu de son costume militaire et paré de ses décorations, dont la légion d’honneur :
Odille Antoinette Victoire Giraud (1776-1796)
Odille Antoinette Victoire Giraud naît le 24 septembre 1776, « ondoyée à la maison le même jour eu égard au danger de mort », et n’est baptisée que deux mois après, le 9 novembre, à Moulins 85 .
Elle est mise en nourrice et, malgré le soin que, selon sa sœur, sa mère a mis à choisir cette femme, il semble que celle-ci lui a transmis la syphilis. On lui attribue, en tout cas, la responsabilité du grave handicap qui, très tôt, réduit l’enfant à des limitations cognitives et physiques dont on ignore le degré de gravité :
[…] Le mercure pris par sa nourrice, pendant qu’elle l’allaitait, détruisit ses forces vitales et altéra sa raison : exemple funeste des dangers auxquels une mère expose son enfant, lorsqu’elle est obligée de recourir au sein d’une étrangère pour le nourrir. La mienne ne s’en consola jamais, et jusqu’à sa mort s’en fit les plus vifs reproches. Cependant, elle avait pris très scrupuleusement des informations sur cette nourrice ; mais sa prudence fut endormie ou satisfaite par les témoignages qu’elle reçut de la conduite d’une femme assez adroite pour en imposer à tous. (p. II-87)
Au moment de mourir, la mère d’Alexandrine confie Odille, qui n’a alors que 10 ans, à ses frères : elle « les pria de protéger et de soigner avec amour Odille, […] dont la raison était aliénée et les souffrances continuelles » (p. I-7) C’est en réalité Babet, une femme de la maison 86 , qui prendra soin de la petite fille jusqu’à son décès dix ans plus tard, le 3 messidor an IV (21 juin 1796) 87 .
L’autrice a ces mots à propos du décès de sa sœur : « elle mourut de vieillesse à vingt ans » (p. II-86-II-87).
Étienne Giraud des Écherolles (1777-1779)
Nous n’avons pas retrouvé l’acte de baptême de cet enfant à Moulins, lieu de naissance de toute la fratrie. Mais son existence est attestée par un acte de décès en date du 15 octobre 1779 : il est mort la veille, à l’âge « d’environ deux ans », dans la commune de Saint-Loup. Ce sont deux « domestique[s] de mr. Giraud des Echerolles de Cette parroisse » qui « ont assisté à sa sepulture » 88 .
Les collatéraux
La tante : Marie Anne Giraud 89 [des Écherolles] (1733-1794)
Marie Anne Giraud 90 , née le 8 septembre 1733 à Moulins, dans l’Allier, est baptisée le même jour dans l’église de Saint-Pierre-des-Ménestraux 91 . Elle est la fille de Gilbert Giraud, seigneur des Écherolles, et de dame Jeanne Marie Martiale Melon. On ne sait rien de son enfance et de sa jeunesse. D’après l’autrice, elle choisit de ne pas se marier : « La sœur de mon père refusa tous les partis qui lui furent proposés, et ne se maria point. » (p. I-5) On ignore tout de ses motivations, mais sa fortune, assez importante si l’on en juge par le volume d’argenterie qu’elle réussit à cacher dans sa cave en prévision des jours sombres qui se préparaient pour sa nièce, lui permettait ce choix. C’est à la mort de sa propre mère qu’elle choisit de vivre seule dans une « maison séparée » (ibid.) de celle de son frère et de sa belle-sœur.
C’est elle qui recueille les enfants Giraud à la mort de leur mère, probablement dès 1786 : Alexandrine a 7 ans ; Odille, 10 ans ; « Chambolle », 12 ans ; et l’aîné, Martial, 17 ans. Marie Anne ne se plaisant qu’à la ville, les enfants quittent le domaine parental des Écherolles et viennent s’installer avec elle. On sait que les deux garçons sont enrôlés très jeunes, suivant l’exemple paternel. Alexandrine Giraud reste donc très vite seule auprès de sa tante, avec sa sœur aînée Odille. La petite fille aurait dû aller au couvent, où sa mère avait semble-t-il vécu une enfance et une adolescence heureuses et confortables, mais malgré le vœu que celle-ci en a fait sur son lit de mort, et l’insistance (qui ne faiblira jamais), de la part d’Alexandrine, à exaucer le souhait maternel, son père et sa tante refuseront toujours de l’envoyer au couvent.
Une salonnière de la ville
Marie Anne Giraud demeure à Moulins près du Jacquemart 92 ; son salon est « le rendez-vous de tout ce que la ville comptait de distingué 93 ». C’est, d’après sa nièce, une femme du monde qui a tôt acquis les qualités d’une salonnière recherchée et appréciée, parfois redoutée pour la vivacité de ses réparties :
Ma tante était d’une constitution délicate ; son éducation avait perfectionné la finesse de son esprit plus que sa raison et sa pensée. Répandue très jeune dans le monde, elle aimait la société par habitude et par goût ; son amabilité s’y fit bientôt remarquer et s’y acquit une des premières places. Le jeu, la conversation, la science du monde, les devoirs qu’il impose, devinrent pour elle une étude importante, et dans laquelle ses progrès furent incontestables. Personne ne recevait mieux, personne n’avait plus de gaieté, plus d’esprit qu’elle. Possédant au plus haut point la répartie fine et vive, maniant la parole avec une vivacité sans égale, riche en bons mots qu’elle jetait avec profusion dans l’entraînement des joyeuses causeries de salon, elle y devint une puissance parfois redoutable ; car elle ne sut jamais résister au plaisir de dire un mot spirituel. — J’aime mieux faire des excuses ensuite, disait-elle. Comment l’étouffer ? il est trop joli. — Cependant, les excuses n’adoucissaient pas l[e m]al produit par ce mot. Il frappait si juste, il faisait portrait, il dévouait au ridicule ; enfin ses blessures étaient incurables, et beaucoup ne les lui pardonnèrent jamais. C’est ainsi que souvent l’esprit cache le cœur.
Elle recevait tous les jours du monde, aimait à faire sa partie, et retenait tous les soirs quelques personnes à souper. C’était alors qu’elle se livrait sans réserve à la vivacité de son esprit, que sa conversation agréablement enjouée entraînait par sa gaieté tous ceux qui l’entouraient. Ces heures-là étaient les plus heureuses de sa journée. Sa table était abondante et recherchée. Donnant souvent de grands repas, elle rassemblait chez elle ce qu’il y avait de plus aimable à Moulins. Indépendante et jouissant d’une jolie fortune, rien n’avait contraint son penchant pour les délicatesses de la vie. C’était donc une femme du monde, aimant le monde, ayant brillé dans le monde, et ainsi faite par le monde. Si je m’arrête sur les détails d’une existence aussi superficielle, c’est pour admirer davantage ce qu’à son tour le malheur fit d’elle aussitôt qu’ayant déchiré les voiles brillants qui lui cachaient à elle-même la beauté de son ame, il la livra à toute la vigueur de cette ame fière et puissante. A peine touchée par l’infortune, elle secoua cette luisante poussière qu’elle avait prise pour de l’or, et sortant de cette tombe, elle ressuscita grande et forte. (p. I-255-I-257)
De la légèreté à la gravité
Mère adoptive et mère de cœur d’Alexandrine Giraud, qui a pour elle une véritable dévotion, Marie Anne Giraud va se révéler une tout autre personne au cours de son exil à Lyon, et en particulier au moment de sa captivité. C’est sa nièce qui témoigne de ce changement :
[…] Autant que je puis me le rappeler, les vues de ma tante étaient le plus souvent justes, et sa prévoyance grande ; elle se trompa rarement dans le jugement qu’elle porta des évènements. C’est alors que dans la femme spirituelle, connue par ses bons mots, ses plaisanteries fines et piquantes, se développa le caractère de la femme forte, et que ce petit mérite de femme aimable jeté là comme une fausse enveloppe, laissa paraître à tous les yeux la vraie grandeur de son ame. Déjà nous lui avions beaucoup et de grandes obligations. Son dévouement pour les siens fut sans bornes, ainsi que sa générosité. Dans la suite, c’est absolument de ses bienfaits que nous vécûmes ; non-seulement de ses revenus, mais encore du produit d’un domaine qu’elle vendit sans hésiter pour nous soutenir. (p. I-30-I-31)
En réalité, Marie Anne Giraud n’a pas attendu l’épreuve de l’exil, du siège et de la prison pour révéler un tempérament de femme d’action, tout à fait consciente des enjeux politiques du moment. C’est elle qui conseille à son frère de ne pas accepter la charge de colonel de la garde nationale, dès les premières années de la Révolution à Moulins ; et quand tout les pousse à s’expatrier à Lyon, c’est elle qui confie des louis d’or et cache une partie de l’argenterie familiale en prévision du retour. Sa nièce lui voue une admiration sans bornes d’avoir montré une telle prévoyance, corrélée à un tel sens de la situation politique désespérée de leur classe :
Bien des années se sont passées depuis ce moment [celui de son exécution], mais jamais, non jamais, je n’ai pu y penser sans être saisie d’une profonde vénération pour elle, et d’une admiration tout aussi grande pour les qualités éminentes dont elle était douée. Le regard de son esprit, pénétrant les mystères de l’avenir, pressentit ces temps de traverses et leurs orages ; il vit toujours juste. Son cœur, marchant à l’égal de son esprit, préparait les secours et les portait au loin. Répandant ses bienfaits à toute heure, elle les jeta à l’avenir qu’elle ne pouvait atteindre. (p. II-56)
Sa foi et les prières lui sont un soutien de chaque instant. On ne sait si elle a été si fervente dans ses années de jeunesse mais, à l’approche de la mort, elle montre à sa nièce un courage et une piété qu’elle veut exemplaires 94 :
Ma tante ne se fit jamais d’illusion sur le sort qui l’attendait, et n’eut pas même l’espérance qui soutint ou trompa tant d’infortunés. Elle le comprit dès le premier jour, se vit dévouée à la mort, et s’y prépara sans hésiter. Les épreuves de chaque minute lui parurent comme préparatoires à ce dernier sacrifice. Elle accepta tout d’une ame soumise et résignée, et se plut dans son obéissance à la volonté de Dieu. Ménageant ma tendresse et peut-être ma faiblesse, elle m’en parla peu. (p. I-168)
Itinéraire d’une condamnée
Marie-Anne Giraud est arrêtée en novembre 1793. Comme on l’a dit plus haut, on ignore à ce jour la date exacte de son arrestation. On connaît en revanche le nom des personnes qui la dénoncent, deux commissaires de la section du Change dont elle relève 95 .
Emprisonnée aux Recluses, elle y reçoit presque tous les jours la visite d’Alexandrine, qui lui apporte des repas préparés avec ce que la jeune fille, assistée de « la Cantat » 96 , parvient à se procurer dans une ville qui souffre de la disette : elle peut les réchauffer sur des « chaufferettes de poussier de charbon » (p. I-166) mises à disposition des dizaines de femmes entassées dans la même pièce. La plupart des recluses dorment sur de la paille qu’on ne leur change que rarement. Marie Anne bénéficie d’un matelas de crin que lui a fait passer sa nièce :
[…] Ce matelas était son lit, sa table, sa chaise. Je ne vis pas d’autres meubles dans cette chambre où elles étaient plus de cinquante. Celles qui n’avaient point de matelas, étaient couchées sur un peu, très peu de paille, et c’était le plus grand nombre. Voilà le spectacle qui frappa ma vue, et me contraignit pendant quelque temps au silence. (p. I-146)
Trop handicapée pour se baisser jusqu’au sol, la tante « s’était arrangée avec une pauvre paysanne, prisonnière aussi, qui faisait son lit chaque soir, et roulait son matelas tous les matins » (p. I-228). Quand la pression sur l’espace se fait plus forte, elle invoque ses rhumatismes (ibid.) pour échapper à la contrainte de partager son lit de misère avec une autre compagne de geôle.
D’après l’autrice, une petite « c[ot]erie » (p. I-164) se développe entre Marie Anne Giraud et trois compagnes de détention : Mlle Ollier, libraire ; Mlle Huette, couturière, et Mme Desplantes, propriétaire de l’Hôtel du Midi, sur la place Bellecour. Les quatre femmes organisent, avec la jeune fille, des repas, midi et soir, composés de veau froid, « coupé et réchauffé dans du bouillon » (p. I-166), d’œufs battus en omelette, d’un mauvais café, et de pain immangeable. Cette « petite société », raconte Alexandrine Giraud, reste unie pendant toute la durée de l’emprisonnement, « conserv[ant] entre elles une plus grande intimité qu’avec les autres prisonnières, comme si déjà elle pressentait qu’une même destinée l’attendait, et qu’elle ne se séparerait plus » (p. I-228). De fait, ces quatre femmes sont transférées ensemble à la prison Saint-Joseph. La description que livre l’autrice de la pièce dans laquelle est enfermée sa tante montre un état de saleté qui atteint même le plafond :
Enfin, les portes de Saint-Joseph s’ouvrirent pour moi, et je trouvai ces dames renfermées au fond d’une grande cour, dans un corps de logis qui consistait en deux chambres fort vastes, isolées de tout autre bâtiment. Elles étaient sans fenêtres ; une petite grille au milieu de la porte livrait un étroit passage à l’air et au jour. Dans l’une de ces chambres, il y avait des lits pour les personnes en état de les payer, les autres furent entassées dans la seconde, sur de la paille. Ma tante, afin d’éviter le partage de sa couche, choisit un des trois lits de sangle de la chambre ; mais pour compenser l’avantage de coucher seules, les trois dames qui les avaient choisis eurent la plus mauvaise place : leurs lits furent mis sous une énorme cheminée que l’on boucha tant bien que mal avec de la paille, ce qui n’empêcha pas le froid et l’humidité de pénétrer jusqu’à elles. Les infirmités de ma tante s’en accrurent beaucoup, et depuis lors ses douleurs de rhumatisme se portèrent à la tête, où elle éprouva de grandes souffrances. Il y avait quinze lits dans cette chambre, point de feu pour en renouveler l’air. Les chaufferettes devinrent encore une fois l’unique ressource des prisonnières. Chaque soir, on les renfermait chez elles ; chaque matin, on ouvrait leur porte, et elles pouvaient errer à leur gré dans la cour environnée de murs très élevés. La chambre de ces dames m’offrait un spectacle que je n’ai vu que là : c’était un noir plafond, formé par d’innombrables toiles d’araignées. Ces ouvrières laborieuses avaient travaillé beaucoup d’années sans doute dans le silence et l’humidité de cette sombre habitation, espèce de cachot malsain. Ajoutant chaque jour à leurs travaux héréditaires, il en était résulté une tente qui, s’abaissant à plus de la moitié de la chambre comme une voûte renversée, interceptait l’air et semblait un triste linceul prêt à nous ensevelir. On ne pouvait lever les yeux sans dégoût. La solidité de cette tente d’un nouveau genre attestait le nombre et la grosseur des ouvrières qui l’habitaient. Ces dames firent des représentations et sollicitèrent vainement le geôlier pour qu’il fît nettoyer leur chambre ; il n’y consentit que lorsqu’elles offrirent d’en faire les frais. Aussitôt, quelques criminels qu’elles payèrent fort cher, vinrent déloger ces nombreuses compagnes, qu’on livra aux flammes au milieu de la cour, ainsi que leurs travaux centenaires. (p. I-250-I-251)
Marie Anne Giraud est consciente de s’être sacrifiée pour sauver son frère ; elle sait aussi que le sort de sa nièce dépend du soin qu’elle mettra à ne pas se mettre en avant, à ne pas s’échapper, et à ne rien réclamer pour elle. Décidée à focaliser l’attention pour protéger le reste de la famille, c’est elle qui paye le prix fort de l’engagement militaire d’Étienne Giraud des Écherolles pendant le siège.
Après un temps indéterminé, Marie Anne Giraud est emmenée à l’Hôtel de Ville, antichambre de la mort :
[…] Le tribunal révolutionnaire siégeait dans ce bel édifice, dont les vastes caveaux servaient de prison passagère à ceux qu’il appelait à comparaître devant lui. Ces mots étaient presque à eux seuls un arrêt de mort ; car ces juges sanguinaires, avides de supplices, ne trouvaient que des coupables, et, sans la nécessité ou des craintes peut-être qui leur faisaient tenir à conserver une apparence de justice, jamais ils n’eussent proclamé l’innocence d’un seul. (p. I-261)
Elle est transférée dans la salle dite du « Commerce », au premier étage, de laquelle on pouvait, « de la fenêtre, dominer toute la place des Terreaux, terminée par la guillotine » (p. I-264).
Comme ses trois compagnes, elle y est sommairement jugée, en même temps que quarante autres femmes, le 19 pluviôse an II (7 février 1794) 97 : elle est accusée d’être la « sœur d’un chef des rebelles avec lequel pendant tout le siège elle recevait des contre-révolutionnaires et demeurant avec son frère avec lequel elle correspond étant fugitif 98 ». Jugée coupable, elle est guillotinée le 22 pluviôse an II, après une nuit de prières, avec huit autres femmes et un prêtre 99 . Comme toutes les femmes condamnées à mort, elle échappe à la fusillade ou aux canonnades 100 , réservée aux hommes.
Marie Anne Giraud avait eu 60 ans en septembre.
Physiquement, on ne sait que peu de choses sur Marie Anne Giraud, sinon qu’elle souffrait d’un fort embonpoint qui la gênait dans ses mouvements au point de ne pouvoir se baisser (p. I-167) et la ralentissait dans sa marche. Alors qu’elles doivent, après le siège, changer de lieu et quitter le refuge à Vaise, sa nièce raconte combien elle est « mauvaise marcheuse » :
[…] Beaucoup d’embonpoint, un très petit pied, d’énormes talons étaient autant d’obstacles à vaincre. N’ayant pas l’habitude de faire de l’exercice, elle souffrit beaucoup dans ce court trajet [d’une demi-lieue], qui fut fort long pour elle, et que l’ardeur du soleil rendit plus pénible encore. (p. I-60)
La grand-tante : Antoinette Martiale Melon (« Mademoiselle Melon »)
Cette grand-tante joue un rôle important dans le récit. C’est elle qui recueille Alexandrine Giraud pendant presque un an quand la jeune fille revient de Lyon, au printemps 1794, après la mort de sa tante. Elle jouit d’une « fortune considérable » (p. II-45), d’après l’autrice, et vit seule – c’est-à-dire qu’elle reste non mariée : une personne de son rang ne peut se passer d’une nombreuse domesticité, et ne vit jamais seule, pour le pire et le meilleur. Ses rapports avec cette domesticité font d’ailleurs tout le sel de ses jours dans le tableau très précis qu’en fait sa petite-nièce, à qui rien n’échappe de la complexité des relations sociales.
Baptisée à Saint-Martin-de-Nevers le 20 septembre 1717, dame de Thaix, Vendonne, Martigny et Cossay, Antoinette Martiale Melon, comme Marie Anne Giraud dont elle est la cousine, ne se mariera jamais.
Elle a deux sœurs : Marie Étiennette Cyprienne Félicité Melon, née en 1716, mariée avec Rapine de Saxi, et Pierrette Anne Elisabeth Edmée, née en 1718, qui elle aussi a choisi de ne pas se marier, et décèdera en 1769 101 .
L’autrice de Quelques années de ma vie n’a jamais rencontré Mlle Melon du temps où elle vivait chez Marie Anne Giraud, sa tante, à Moulins, avant la Révolution. C’est une femme qui, de l’avis même d’Alexandrine Giraud, est d’un autre temps, et entend bien y rester. Protégée, peut-être exploitée, par son homme d’affaires, elle vit retirée, tout le temps de la période, sur ses terres nivernaises, dans la petite commune de Thaix, au domaine dit de l’Ombre, occupant l’une des ailes déjà bâties d’un château resté à l’état de projet. Elle s’y loge dans la seule aile déjà construite, avec « deux de ses femmes ; le reste fut dispersé dans les vastes dépendances de ce futur château » (p. II-21), interdite de retour dans sa maison de Nevers réquisitionnée par le Comité révolutionnaire du département de la Nièvre.
[…] Mademoiselle Melon vivait donc assez tristement, mais en sécurité quand tout souffrait ou mourait autour d’elle ; ne recevant aucune gazette, ne voyant personne, elle ne connaissait plus le monde d’alors. (p. II-22)
Les liens de solidarité exigent le retour du bien qu’on vous a fait. Mlle Melon a passé plusieurs années de sa jeunesse près de la grand-mère paternelle d’Alexandrine 102 « et se crut obligée à s’en montrer reconnaissante envers sa petite-fille » (p. II-24). Elle se manifeste donc auprès d’Alexandrine Giraud, qui connaît à peine son nom, pour la faire venir auprès d’elle. Son homme d’affaires, M. Bonvent, réussit, non sans mal, à obtenir l’autorisation du Comité de Moulins pour que la jeune fille se rende chez cette parente dont l’âge avancé, la solitude et le mauvais état de santé exigent une compagnie de confiance. Sa petite-nièce, s’attendant à retrouver une tante aussi maternante que celle qu’elle a perdue, arrive pleine d’espérance et de préjugés avantageux pour la vieille femme :
Je la trouvai à sa toilette. Elle était assise sur un tabouret assez bas, pendant que sa femme de chambre crêpait fort serré un petit toupet dont les cheveux très blancs étaient relevés en arrière. Rien n’était moins avantageux que ce moment. Elle avait le front large, les yeux ronds et rouges, le nez gros et ouvert, les bras et les mains énormes, le corps un peu courbé. Elle me dit d’une voix très aiguë : — Bonjour, Mademoiselle des Écherolles, et me fit asseoir devant elle. — Mon illusion avait dispar[u], je me sentais interdite et je m’assis timidement, répondant de même aux questions qu’elle voulut bien m’adresser. (p. II-29)
Comme souvent, l’autrice dresse un portrait élogieux, admiratif, des femmes de son entourage. Mlle Melon n’échappe pas à cette règle : c’est une femme « charitable, compatissante, cherchant de tout son pouvoir à soulager les maux d’autrui, douée d’un cœur généreux et bon » (p. II-46). Elle ne manque cependant pas de défauts qui sont décrits avec acuité, et non sans humour :
Mademoiselle Melon avait beaucoup d’esprit et d’originalité dans les idées ; à une mémoire prodigieuse elle joignait une instruction peu ordinaire ; elle avait une grande connaissance de la société de son temps ; mais elle ignorait le monde du nôtre, et ne concevait rien à la révolution. Lorsqu’elle apprit que le Comité s’était emparé de sa maison [de Nevers], elle jeta feu et flamme ; et chaque fois qu’elle y pensait, de nouvelles fureurs s’emparaient d’elle. Il n’y a pas de doute que ses discours ne l’eussent fait périr, si, comme je l’ai déjà dit, M. Bonvent n’eût toujours trouvé le moyen d’empêcher ma tante de partir. Elle en parlait chaque jour, sans l’effectuer jamais ; l’habitude achevant de la captiver, elle resta définitivement à la campagne. A quatre-vingts ans, on est long à faire ses préparatifs ; il lui parut plus commode de gourmander du coin de son feu les auteurs de tant de désordres. (p. II-33)
Antoinette Martiale Melon vit au rythme de ses fantaisies : « tout ce qui l’entourait devait céder à la puissance de ses habitudes » (p. II-46). Elle doit néanmoins jouer avec la réalité pour obtenir ce qu’elle souhaite de ses domestiques. Ainsi, plutôt que d’imposer l’heure qui lui convient pour se faire servir ses repas, elle préfère briser le ressort de toutes les pendules de la maison et demeurer la seule à donner l’heure avec sa montre qu’elle règle à sa convenance. Enfantillage qui lui permet d’« éviter toute discussion sur ce point » (p. II-35). Elle agit de même avec ses médecins qui, « inquiets de son énorme appétit », lui interdisent de souper : « elle croyait satisfaire à leur ordonnance en ne se mettant pas à table, et mangeait à sa faim, ce qui veut dire copieusement » (p. II-38).
C’est une femme qui connaît sa place autant que ses libertés, habituée à être servie et à organiser son temps selon son humeur ; elle entend les faire respecter, même au détriment d’une santé qui lui a, quoi qu’en disent les esculapes, permis d’atteindre l’âge vénérable de 80 ans. Il faut ajouter qu’il est attendu de tous les commensaux la même servitude. Alexandrine Giraud, sa parente, plus jeune qu’elle et invitée de surcroît, n’échappe pas à cette règle. Si elle bénéficie d’une place de choix, juste au-dessous de la maîtresse des lieux, elle n’en est pas moins tenue de faire tout son possible pour lui plaire, devancer ses besoins, au moins pour « racheter », par son exactitude à remplir ses devoirs, la générosité de l’accueil de sa parente – une générosité tout à fait sommaire, sur le plan matériel, mais qui permet à la jeune fille de trouver un refuge à une période aussi douloureuse que périlleuse pour elle – :
[…] blâmer m’eût semblé de l’ingratitude, je n’avais même pas le mérite de repousser mes réflexions, je n’en faisais point. Je croyais que toutes les femmes de quatre-vingts ans vivaient ainsi, il me paraissait donc juste de m’y conformer. (p. II-37)
Même le curé (assermenté) rend des visites journalières, pour distraire Mlle Melon et « compenser ainsi tout le bien qu’il en recevait » (ibid.). Peu appréciée, crainte (« Dès qu’elle paraissait à sa porte [de la cuisine], tout fuyait au loin », p. II-39), elle est aussi le jouet de l’influence que tentent d’exercer les personnes qui ont accès à elle, au premier rang desquelles son homme d’affaires et sa femme de chambre.
Elle est, dans cette demeure, la seule de son rang, ce qui lui laisse une autonomie certaine dans ses décisions ; mais elle vit aussi aux dépens des personnes qui la servent – lesquelles, d’après le tableau qu’en dresse l’autrice, disposent d’une certaine latitude ou, dirait-on aujourd’hui, d’agentivité. Dans le cas de Mlle Melon, la dépendance de cette femme de plus de 80 ans est d’autant plus accentuée que son éloignement des pratiques et idées du nouveau monde la force à s’isoler, et la met d’autant plus entre les mains de sa domesticité, ici entendue au sens large, incluant celui qui est au sommet de cette hiérarchie inférieure, M. Bonvent.
De fait, l’homme d’affaires semble, toujours d’après la nièce de Mlle Melon, avoir beaucoup d’influence sur la vision du monde et les intérêts économiques de la vieille dame. Il est le « véritable maître de la maison », jouissant de la terre « sans jamais en rendre compte à mademoiselle Melon, qui heureusement touchait elle-même le revenu du reste de ses biens, et qui crut faire un bon marché en obtenant de lui qu’il payât une partie des frais de son ménage » (p. II-41). La vieille dame n’est cependant pas dupe, puisque de vives discussions l’opposent à son gérant ; mais « le serviteur, habitué au pouvoir, refusait d’obéir, et ne se rendant plus à ses ordres, il vivait ouvertement en révolte » (p. II-42), plaçant la jeune fille en situation délicate, à l’interface entre les deux parties.
Un autre exemple permettra de juger des rapports de force qui, quotidiennement, s’exercent dans cette communauté, celui du coût du chauffage au bois : une lutte toujours renouvelée s’exerce à l’Ombre, entre les désirs d’économie, voire de parcimonie de la maîtresse des lieux, qui écarte les bûches du foyer quand elle pénètre dans la cuisine, et ceux d’une certaine Nannette, « la reine de céans », qui les replace afin de chauffer la pièce et cuire les repas (p. II-40). Alexandrine Giraud n’en est pas dupe, qui remarque que « sortant peu de son appartement », sa tante « n’était maîtresse que chez elle, et ne pouvait s’apercevoir des désordres domestiques dont elle ignorait la plus grande partie » (p. II-41).
La fin du séjour d’Alexandrine pâtit de l’emprise d’une autre personne : celle de Babet, la femme de chambre, qui voit dans l’affection de la vieille dame pour sa petite-nièce une concurrente à écarter. Ce qu’elle parvient à obtenir, à force de stratagèmes dont la jeune fille n’apprendra l’étendue que beaucoup plus tard. Fataliste, elle ne s’en émeut pas :
[…] je n’aurais jamais pu lutter avec avantage contre un pouvoir sous lequel ma tante elle-même courbait la tête, et quand elle m’exprima combien il lui était désagréable d’avoir chez elle une jeune personne qui ne lui convenait pas, je compris qu’il fallait partir et j’en pris sur-le-champ la résolution. (p. II-126)
Le départ n’est pas si difficile : la jeune femme de 16 ans s’ennuie à l’Ombre, se languit même des soins de sa bonne, et si elle subit sans broncher la variabilité et l’imprévisibilité des humeurs de sa tante, elle part sans regrets. Toujours encline à l’édification, elle en retire, plusieurs années plus tard, une leçon : « ces contrariétés étaient sans doute bonnes pour moi, en froissant ma volonté, mais je ne le savais pas » (p. II-39).
Ayant réussi à mettre fin aux maltraitances exercées par cette « servante-maîtresse », en la faisant chasser par son neveu, Mlle Melon « passa les dernières années de sa vie paisiblement » (p. II-127). Elle décède le 5 ou 6 frimaire de l’an X (26/27 novembre 1801). Son neveu hérite de la terre de l’Ombre qu’il revend en 1805 (voir les informations qui accompagnent l’arbre généalogique).
Les domestiques 103
L’histoire des domestiques et de la servitude a montré les marges de manœuvre que toute personne au service tente, avec plus ou moins de succès, de s’aménager : plus on est dans l’intimité de la personne servie, plus on doit se conformer à certaines règles, et plus on peut bénéficier de privilèges 104 . L’analyse que livre l’autrice des relations entre Mlle Melon et les gens qui sont à son service est à cet égard exemplaire. Même si le récit ne fait pas toujours apparaître ce degré de complexité, il mentionne régulièrement un grand nombre de personnes qui, par leur état, font partie de la famille élargie de leurs maîtres et maîtresses.
Marianne Lagoute
Marianne Lagoute, femme de chambre de Mme des Echerolles 105 . Nous n’en apprendrons pas plus sur elle : l’autrice ne la mentionne pas.
Saapa (ou Sappat)
Peut-être s’agit-il de Pierre Jean Sappat, décédé à l’hospice de Moulins à l’âge de 77 ans le 26 vendémiaire l’an VI 106 (17 octobre 1797). Il est dit, sur cet acte de décès, natif de Sainte-Colombe dans l’Yonne et fils de Pierre et d’Anne Pouleau [Pouillot ?], ce qui plaide pour une adoption.
L’autrice dresse le portrait d’un homme « [i]mbu des principes nouveaux » qui regardait sa famille « comme des monstres » (p. I-29-30). Non content d’embrasser la cause nouvelle, et de trahir ainsi la confiance de maîtres qui ne l’ont jamais traité en serviteur ordinaire, du fait de la noblesse de son origine, il a déjà montré des signes de son avilissement en refusant la main tendue par la grand-mère d’Alexandrine Giraud lorsqu’elle propose de le faire rentrer dans ses droits, lui l’enfant abandonné. C’est, d’après l’autrice, le signe que « la servitude » a « avili » son « ame » (p. I-29), sans doute moins en raison de sa fréquentation assidue de l’armée que parce que le contact avec une famille d’adoption qui, ayant trahi ses engagements moraux en dilapidant les deniers confiés pour son éducation, ne peut qu’être de la plus grande bassesse.
« Babet », aux Écherolles
C’est elle qui s’occupe d’Odille, la sœur d’Alexandrine Giraud, jusqu’à sa mort en 1796. Elle reste aux Écherolles quand toute la famille, sauf Odille, fuit Moulins. Lorsque le domaine est vendu, « Babet » (dont on n’a pas retrouvé le nom de famille), suit Alexandrine à Lyon en 1797.
« Ma bonne »
Cette femme est le plus souvent nommée « ma bonne ». Favorable à la Révolution dans les premières années, « [l]a haine qu’elle portait aux abus lui avait fait voir le bonheur de sa patrie dans les changements qui s’opéraient alors » (p. II-3). Très vite cependant, « revenue d’une erreur qui avait pris sa source dans son amour pour la justice, elle avait maudit les révolutionnaires et leurs excès. Redevenue ce qu’elle devait être, elle sentit avec la même violence la haine qu’ils méritaient » (p. II-4).
C’est elle qui envoie, sous couvert d’anonymat, une somme d’argent à Alexandrine Giraud lorsque celle-ci est hébergée chez Mlle Melon : la pensant dans le besoin, elle a sollicité la faveur d’être gardienne des scellés mis aux Écherolles, afin de lui en faire « passer le salaire » (p. II-48).
Il semble qu’elle soit cette « madame Duvernai », nommée plus tard dans le texte quand l’autrice la retrouve à Moulins (p. II-156). Lorsque la jeune fille ne peut plus subvenir à ses besoins, Mme Duvernai se met au service de Mme Guichard, puis de M. Fellot, l’une et l’autre demeurant à Vaise. Elle reste dans cette dernière famille jusqu’à sa mort. On n’a pas retrouvé son acte de décès à Vaise, ce qui peut s’expliquer : les femmes sont le plus souvent répertoriées, dans les actes de l’état civil, par leur nom de naissance. Or on ne connaît pas celui de Mme Duvernai, si « Duvernai » est son nom d’épouse. On pourrait s’étonner qu’une femme mariée se soit fait embaucher comme bonne, mais elle peut avoir été veuve très jeune et, sans moyen de subsistance, s’être mise au service d’une famille riche des environs [p. ] .
François Vernière
Jardinier aux Écherolles, il est né en 1766 à Cusset. C’est lui qui déclare le décès d’Odille Giraud en 1796 107 .
Cantat et Saint-Jean dit « Marigni »
Cantat est présente aux côtés d’Alexandrine Giraud depuis son enfance et jusqu’aux années lyonnaises. On ignore son prénom. On a fait l’hypothèse qu’elle a pu être recrutée dans l’entourage de la famille, aux alentours des Écherolles. Or deux filles naissent avec le nom de Cantat, à Saint-Loup : Catherine en 1768 et Claudine en 1770 108 . Il n’est pas impossible que l’aînée des deux, Catherine, ait été mise au service de Mme Giraud des Echerolles vers l’âge de 12 ou 13 ans, c’est-à-dire vers 1780, alors qu’Alexandrine vient de naître. Si c’est elle, elle a onze ans de plus qu’elle. L’hypothèse que Catherine soit « Cantat » est renforcée par le fait que sa marraine, Catherine Gueret, est originaire de Saint-Gérand-de-Vaux, un lieu tout aussi proche que Saint-Loup, où sera enterré la mère d’Alexandrine Giraud.
Domestique de Marie-Anne Giraud des Écherolles, Saint-Jean suivra la nièce de sa maîtresse à Moulins après la mort de cette dernière. En date du 25 pluviôse an III (13 février 1795), les Archives départementales de l’Allier font mention d’un certain « citoyen Marigny, qui a été pendant vingt ans au service de “la fille Giraud Des Écherolles, condamnée” [Marie-Anne Des Écherolles] », et qui lui réclame « “trois années de gages, à raison de 300 l., faisant entrer dans ce prix la somme de 150 l. pour le bénéfice que lui rapportaient chaque année les parties de jeux qui se faisaient dans la maison de ladite Giraud” 109 ».
Après le siège, alors que l’argent manque pour le payer, Saint-Jean travaille aux démolitions de la place Bellecour (p. I-175-I-176). Avec Cantat, il « ruse » pour détourner sa jeune maîtresse de son projet de rejoindre son père en Suisse. Les deux comparses l’effraient de « la manière injurieuse dont plusieurs femmes avaient été traitées à la frontière » (p. I-297), argument qui la fait immédiatement renoncer à son plan.
Les démêlés de ces deux domestiques, qui se querellent sans cesse, placent souvent la jeune fille en situation difficile : « Saint-Jean ne voulait pas faire les emplettes, et Cantat ne voulait pas faire la cuisine. » (p. I-152) La relation d’Alexandrine Giraud avec ces deux personnes est complexe, faite à la fois de la déférence qu’elle ressent par une sorte d’« habitude d’enfance » et d’« éloignement invincible » (p. I-300) à mesure qu’elle perd confiance en elle et lui. Elle n’a que 14 ans, elle ne peut se déplacer dans Lyon sans leur protection, et n’imaginerait pas se passer de leurs soins et services. Mais seule à la tête de la maisonnée, désormais, elle est responsable de leur subsistance et de leur logement : elle doit non seulement les nourrir mais également subvenir aux besoins du gardien Forêt, qu’on a mis là pour veiller sur les scellés, ainsi qu’à ceux de son épouse.
Pierre Barnioux, dit « Brugnon »
Domestique du père d’Alexandrine Giraud, il est né en 1764 à Serbannes, une petite commune de l’Allier à une soixantaine de kilomètres au sud de Moulins. Il porte les armes pendant le siège, avant d’être inscrit comme charretier dans les équipages d’artillerie par M. de Gueriot (p. I-172) et entre, ensuite, au service de M. de Montlezun, officier d’artillerie.
Il s’appelle, en réalité, Pierre Barnioux. Il est le fils de Joseph Bargniaux 110 , agriculteur à Serbannes, et de Catherine Roumand. Le nom qui lui est attribué dans le texte, Brugnon, n’est pas une erreur de mémoire. On retrouve, sur un acte notarié, le patronyme de Pierre Brignon barré, avec une note indiquant qu’il s’agit en réalité d’un certain Pierre Barnioux 111 . Il y a donc soit une manière de prononcer qui diffère de la manière dont on lit « Barnioux », soit de sa part un souhait de se faire appeler ou surnommer Brugnon ou Brignon.
Il se marie à Lyon, à l’âge de 34 ans, le 30 vendémiaire an VII (21 octobre 1798) avec Claire Charlotte Macon, « fille utile » de Marguerite Chirat, née à Chasselay, âgée de 36 ans. L’acte de mariage le dit « rentier », domicilié « rue [Saint-]Dominique » 112 .
Nannette
Cuisinière au domaine de l’Ombre, dans la commune de Thaix, « Nannette » est au service de Mlle Melon 113 . Il nous a été impossible d’identifier son nom de famille.
Étienne Bonvent
M. Bonvent, homme d’affaires de Mlle Melon, est probablement Étienne Bonvent, né en 1752 à Thaix. Cet Étienne, si c’est lui, est le fils d’un régisseur, François Bonvent, et de Marie Anne Robin, également née à Thaix. Il se mariera à Thaix le 4 juillet 1805 avec Gabrielle Ballet (1774-1860), et décédera quelques jours après, le 9 juillet 114 . On retrouve son nom en 1795, assesseur du juge désigné par les assemblées primaires en l’an III 115 .
« Babet », à l’Ombre
Femme de chambre au service de Mlle Melon, il semble qu’elle exerce une forte emprise sur la vieille dame en cherchant à éloigner sa petite-nièce du domicile 116 .
« Coquette »
Rarement évoquée, la petite chienne d’Alexandrine joue pourtant un rôle jugé fondamental, après l’exécution de sa tante :
[…] Ce fut la première joie que j’éprouvai, et je fus sincèrement touchée de l’attention qui me la fit goûter. La joie de cette sincère amie ne fut pas moindre que la mienne. Elle m’aimait, elle était mon unique bien, elle m’était fidèle ! Il faut avoir été dépouillée de tout, comme je l’étais alors, pour sentir le prix de ses caresses : c’était un fil qui me rattachait à ce que j’avais été, à tout ce que j’avais eu. Mon père et ma tante l’avaient aimée aussi et l’avaient caressée. Je croyais voir et sentir sur elle les douces traces de leurs mains si chères ; je croyais même l’en voir reconnaissante encore. Que de souvenirs m’étaient rendus avec elle ! Sa présence me parlait de tout ce que je n’avais plus. Pleurant à sa vue, elle parut me comprendre, et je ne me sentis plus aussi seule. (p. I-301-I-302)
Les familles alliées : le cas des Chazière, à « Fontaine »
Nous ne pouvons évoquer la totalité des familles qui ont tendu la main à Alexandrine Giraud au cours de la période révolutionnaire. Nous avons fait le choix de privilégier le cas d’une famille de « paysans » 117 d’une petite commune au nord de Lyon, dont l’aide fut cruciale. Elle est intéressante parce qu’elle ne fait pas partie des réseaux habituels de la solidarité, qui ressortissent plutôt de la parenté, même lointaine. Ici, la famille Chazière n’est en aucune manière reliée à celle des Giraud des Écherolles ; ni familialement, ni par des relations de dépendance. Les descriptions fines qu’en offre l’autrice non seulement révèlent des soutiens inattendus (les paysans du pourtour lyonnais étant plutôt considérés comme hostiles aux aristocrates), mais démontrent l’importance des femmes, des enfants même très jeunes et des « imbéciles » dans ces réseaux clandestins.
La famille Chazière est cette famille qui accueille Étienne Giraud des Écherolles, puis sa fille, après le siège de Lyon. Cette dernière y passera trois semaines après l’exécution de sa tante, et en gardera un souvenir ému. Elle est composée de Madeleine, dont l’autrice brosse un portrait flatteur, de Mme Chazière et de son époux – un homme bon mais influençable, « ivrogne et poltron » (p. I-201) –, de la benjamine Driette (ou Driete) alors âgée de 10 ans 118 et d’un parent pauvre, « Pierre l’imbécile ».
La première personne de cette famille dont il est question dans le récit est « la mère Chazières ». Il s’agit de Jeanne Gagneux, femme Chazière, nourrice de son état 119 : c’est elle qui vient chercher Alexandrine à la prison des Recluses, où la jeune fille est en visite auprès de sa tante, pour la mener secrètement auprès de son père, réfugié dans cette famille à Fontaines. Elle est accompagnée d’une petite fille, Driette (Dorothée) et d’un âne.
Le village de Saint-Martin de Fontaines, réunion des paroisses de Saint-Louis de Fontaines-sur-Saône et de Notre-Dame de Fontaines de la commune de Cailloux-sur-Fontaines en 1789, a pris pour nom, après la prise de Lyon, Brutus-la-Fontaine 120 . L’autrice ne le nomme jamais autrement que « Fontaine ». Brutus-la-Fontaine se situe à quelques kilomètres au nord de Lyon ; suffisamment près, à vol d’oiseau, pour que Dubois-Crancé y installe une batterie, au moment du siège, à l’emplacement de la section des Ruelles, dont relèvent les Chazière 121 . Sa partie industrieuse (en partie tournée vers la fabrique d’indiennes, dont on reparle plus loin) se trouve sur les bords de Saône, et une autre partie, plus rurale et assez étendue, remonte jusqu’aux frontières avec le département de l’Ain. La maison des Chazière est fort opportunément située dans cette partie rurale, à quelques kilomètres à peine de la frontière départementale, au lieu-dit des Ruelles – « La Ruelle », sur la carte ci-dessous : on y distingue un hameau, au nord, qu’une route relie à la frontière, qui est peut-être le lieu d’habitation des Chazière. C’est cette situation stratégique qui permet à Étienne Giraud des Écherolles de se mettre à l’abri dans l’Ain à chaque fois qu’une visite domiciliaire s’annonce au village :
[…] Quant à mon père, dès que l’on soupçonnait une visite domiciliaire dans le village, il s’échappait par le jardin, et, suivant un petit sentier écarté qui le conduisait hors du département du Rhône, il allait chez le meunier qui déjà lui avait sauvé la vie, attendre que le danger fût passé. (p. I-198)

ADR, 1Fi159, 3PI357.
Comme souvent attentive à trouver des qualités aux femmes et aux enfants, l’autrice reconnaît à la benjamine, Driette, un rôle politique dans la protection des fugitifs :
[…] sentinelle avancée, [elle] prévenait les surprises et mettait l’alarme au camp. Driette, comme la nommait sa mère si tendrement, légère comme un oiseau, en avait le regard fin et perçant. Alerte et joyeuse, elle semblait jouer toujours, et cependant sa vigilance n’était jamais en défaut. Elle connaissait tous les secrets ; de sa discrétion dépendait la vie de beaucoup de personnes. Douée d’une sagacité au-dessus de son âge, elle raisonnait, prévoyait avec une prudence pleine de maturité. Ces qualités étaient d’autant plus précieuses, que très souvent il n’était pas possible de l’instruire d’avance de ce qu’elle avait à faire, ni de se concerter avec elle sur des faits qui naissaient inopinément, et cependant il fallait agir d’accord. (p. I-213)
Mais le personnage le plus important du récit d’Alexandrine Giraud est incontestablement Madeleine. Née le 11 novembre 1768, elle a 25 ans au moment de leur rencontre 123 . Elle est la véritable cheffe d’orchestre du réseau de solidarité qui s’organise au domicile de ses parents :
Madeleine avait un esprit fort au-dessus de son sexe et de son état. Son extérieur gracieux, souvent timide ; sa figure riante et douce, cachaient un caractère ferme et décidé ; son génie se développait avec les difficultés, et ne reculait devant aucun obstacle. Maîtresse de tous les secrets, c’était d’après ses avis que les personnes cachées chez ses parents dirigeaient leurs démarches. Douée d’un tact exquis et de la prudence de l’âge mûr, elle marquait elle-même jusqu’à quel point on devait se fier à son père, connaissant ce que son esprit craintif et borné pouvait supporter et comprendre. (p. I-201)
Le récit livre d’autres exemples des risques qu’elle prend, mais aussi de la solidité et de la fiabilité de ses sources d’information : c’est ainsi qu’elle est « [t]oujours prévenue à temps des visites domiciliaires qui se faisaient dans le village » (p. I-296). C’est elle aussi qu’on envoie en mission pour récupérer des papiers sous scellés, témoignant peut-être, ici, de la plus grande facilité, pour les femmes, de circuler dans les espaces publics à ce moment-là 124 :
[…] Un Monsieur, caché je crois chez sa sœur, tenait à ravoir des papiers importants restés dans son secrétaire, qui se trouvait sous les scellés ; il ne s’agissait de rien moins que d’aller secrètement les en retirer. Il lui dépeignit exactement la situation et la distribution de sa maison, et lui remettant la clé d’un escalier dérobé qui communiquait par une porte secrète à l’appartement séquestré, il lui dit : — Vous monterez sans bruit, vous entrerez de même dans ma chambre, et, après avoir enlevé les papiers de mon secrétaire, vous reviendrez doucement et sans avoir été entendue par le gardien des scellés. […]
Madeleine […] accepta sans hésiter ; mais […] elle rencontra des difficultés insurmontables et fut obligée de renoncer à son entreprise. Le moindre danger qu’elle présentait à Madeleine était de passer pour une voleuse. En y réfléchissant, on s’étonne de l’exigeance de l’un et du dévouement de l’autre. (p. I-312-I-313)
La supériorité d’intelligence et de culture que l’autrice prête à Madeleine lui viendrait en partie de sa fréquentation d’un jeune Allemand propriétaire d’une manufacture d’indiennes à Fontaines qui, s’étant épris d’elle et pensant en faire son épouse, cherche à « l’élever jusqu’au rang qu’il occupait » (p. I-205). On ignore la raison pour laquelle Madeleine a dû faire le sacrifice de cette relation, même si on peut faire l’hypothèse d’une intervention de la famille protestante à la perspective d’un mariage avec une catholique 125 . En tout état de cause, meurtrie par l’échec de cette idylle, et de l’avis de l’autrice, bien supérieure aux hommes de son entourage, Madeleine refuse toutes les propositions qui se présentent par la suite. Elle s’attache d’abord à Mlle de Sauriac puis, après la mort de celle-ci, à Alexandrine qu’elle prend sous sa protection.
La famille Giraud des Écherolles n’est en effet pas la seule à bénéficier de la protection des Chazière. Mlle de Sauriac, M. Alexandre, et d’autres peut-être que le récit ne nomme pas, trouvent refuge dans cette maison 126 . On ignore les motivations de la famille. L’autrice évoque une haute moralité, un sens du sacrifice, une foi qui l’emportent sur les considérations politiques. Est-ce suffisant pour justifier les risques pris ? On ne répondra pas à cette question. De même, on ne pourra affirmer qu’il existe un lien entre les services rendus par la jeune Madeleine aux victimes du pouvoir jacobin et sa mort, le 4 thermidor de l’an II (22 juillet 1794) 127 : « [i]nsultée aux portes de la ville, l’effroi qu’elle en éprouva termina une vie qu’elle avait consacrée à secourir les infortunes. » (p. I-313) Nos recherches sur les causes de cette agression n’ont jusqu’à présent donné aucun résultat. Il est certain que le village connaissait le rôle politique joué par la famille : le père était notamment la risée des hommes au cabaret en raison de son obéissance à Mlle de Sauriac, la jeune femme « aristocrate et dévote » (p. I-201) que le couple avait accepté d’héberger. Madeleine a-t-elle été prise à partie en raison de l’aide fournie à ceux qui fuient les poursuites après le siège ? La date de sa mort se situe quelques jours avant la chute de Robespierre et du parti des Jacobins ; la date des insultes subies, quelques jours ou quelques semaines avant, nous est inconnue ; mais l’une et l’autre invitent à prendre au sérieux l’hypothèse d’une cause politique. « Les paysans des environs de Lyon étaient majoritairement peu enclins à faire montre de solidarité envers les Lyonnais fugitifs 128 », observe Pierre-Baptiste Guillemot : même si la répression du siège a laissé place, à partir du printemps, à une politique de réconciliation, il est possible que la famille ait payé le prix de sa marginalité politique. On peut penser également que la frayeur mortelle ressentie par Madeleine a été provoquée par des violences sexuelles. Bien sûr, si c’est le cas, l’autrice n’en dit rien. Nulle femme bien éduquée, à l’époque, ne peut faire allusion à une agression sexuelle, même à mots couverts, sans porter atteinte à l’honneur de la femme qui la subit. Cette honte attachée aux victimes de violences sexuelles pourrait aussi expliquer le mystère qui entoure ces « insultes » dans le texte de l’autrice 129 .
La dédicataire : Maria Giraud des Écherolles (1811-1854)
Maria est la fille de Joseph Marie Étienne (né en 1775 à Moulins) 130 et de Maria Luisa Luciana de Leygonie (née en 1789 à Séville). Elle se prénomme Henrike Maria Anadore Odilie Johanne Stéphanie, née en 1811 131 , trois mois après le mariage de ses parents en mai à Vérone 132 .
L’enfance de Maria, raconte l’autrice de Quelques années de ma vie, est confiée à sa tante alors qu’elle est dame d’honneur de la duchesse de Wurtemberg. Pourquoi et à quel âge la petite fille rejoint-elle sa tante de l’autre côté du Rhin ? Nous ne disposons pas, à ce jour, d’éléments permettant de répondre à cette question. On peut simplement faire une hypothèse sur la date de son « adoption » : on a déjà mentionné le fait que les parents de Maria séjournent en Allemagne en 1813, au moment de la naissance de leur fils Louis 133 . Il est possible que ce soit l’époque à laquelle, au moment de retourner en France, le couple confie à sa tante la petite fille, alors âgée de 2 ans.
Contextes
Contexte de rédaction
Du vivant de l’autrice, deux éditions de Quelques années de ma vie sont publiées : la première en 1843, la seconde en 1845. Dans l’une comme dans l’autre, le récit est suivi, à la fin de chacun des deux tomes, d’un ensemble de « Notes et pièces justificatives ». L’édition de 1845, la plus complète, comporte en outre des « Notes supplémentaires », à la fin du tome II 134 .
Si les dates de publication ne posent pas de problème, il n’en va pas de même de la date de rédaction des Mémoires d’Alexandrine des Écherolles. En l’absence de témoignage précis, nous en sommes réduits aux conjectures, à partir des éléments fournis par le texte lui-même. L’autrice, dans la Préface, suggère que la rédaction est (de beaucoup) antérieure à la publication : évoquant « ces feuilles », elle déclare ainsi que « la plus grande partie est écrite depuis longues années ». (p. I-ii). Elle signale plus loin : « J’ai laissé cet écrit tel que je le traçai alors. » (n. *, p. I-iv) Reste donc à préciser le temps de l’écriture (« depuis de longues années ») et les passages du texte concernés (« la plus grande partie »). D’autant que l’on peut lire aussi, à propos de Félicité de Bellecise, ce commentaire de l’autrice : « Les détails ne m’en furent connus que long-temps après, car alors chacun faisant sa propre histoire, n’avait ni le temps ni la possibilité de s’occuper de celle des autres. » (p. I-157)
L’examen du texte permet, sinon d’apporter toutes les précisions attendues, du moins d’identifier le moment en amont duquel certains développements n’ont pas pu être écrits. C’est notamment le cas des références citées dans les « Notes et pièces justificatives » : Alexandrine des Écherolles évoque, par exemple (tome II, note se rapportant à la « page 169 »), Mme Malet, d’abord lectrice de la reine de Westphalie, puis gouvernante des filles de Louis-Philippe, laquelle est nommée à cette fonction pendant les Cent Jours, en 1815 135 . Dans une autre note du tome II, relative à la « page 98 », l’autrice évoque « un voyage fait en 1818 ». La documentation réunie pour constituer la note qui porte sur la « page 288 » du tome I indique enfin que le texte de cette note est écrit après la date de publication, en 1824, des Mémoires pour servir à l’histoire de la ville de Lyon de l’abbé Guillon de Montléon qui sont non seulement mis à contribution mais dont des extraits sont longuement cités.
Si l’on considère le texte dans son ensemble, les portions les plus récentes sont donc écrites au plus tôt en 1824. Il n’est toutefois pas interdit de penser que les « Notes et pièces justificatives » ont pu être rédigées après le récit qui occupe l’essentiel du texte, lequel aurait en effet pu être écrit de « longues années » auparavant, en tout état de cause après qu’Alexandrine Giraud est préposée à l’éducation des enfants de la « duchesse Louis de Wurtemberg », en 1807. Un indice ténu est cependant fourni à la fin du texte lorsque, au cours de l’évocation du ballet des médecins venus apprécier la santé mentale de « Mlle d’A… », en 1806, l’autrice situe le présent de l’écriture (« à l’heure qu’il est ») « plus de trente années écoulées depuis cette époque » (p. II-192). En l’absence d’informations précises sur la genèse de l’ouvrage, il est difficile d’en dire davantage.
Contexte historique
On ne refera pas, ici, l’histoire de la Révolution, ni même celle de Lyon. On se contentera de situer quelques événements que décrit l’autrice lorsque celle-ci reste trop elliptique : on n’oubliera pas ceux qu’elle invisibilise, mais notre parti n’est pas d’entrer dans un luxe de détails qui probablement ont échappé à la petite fille qu’elle était, et/ou qui n’ont pas paru importants à l’autrice quand elle reprend la plume bien des années plus tard. Quel est le point de vue d’une actrice ordinaire sur des événements tels que la prise de la Bastille et la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen, que l’on considère comme les plus marquants, les plus symboliques, et dont elle ne fait absolument jamais mention ? Alors qu’elle écrit à des années de ces événements, qu’elle a lu et s’est documentée, le choix de ne pas contextualiser davantage, de ne pas établir de liens entre ce qui se passe à Paris et son quotidien, c’est-à-dire de s’en tenir au point de vue de la petite fille 136 , nous oblige. C’est au plus près de ce qu’elle vit sur l’instant, et de ce qu’elle juge bon d’en rappeler dans l’ouvrage publié en 1843, que nous choisissons, à notre tour, de nous tenir.
L’avant/après 10-Août
Lorsque le récit débute, après les présentations d’usage, Étienne Giraud des Écherolles vient de céder aux fortes pressions exercées sur lui pour rejoindre la garde nationale de la capitale de l’Allier, et de sceller son destin ainsi que celui de sa famille. La manière dont l’autrice conte cet engrenage en une série de phrases aussi brèves que les décisions sont vite prises avec, au cœur du paragraphe, une vision prémonitoire de sa tante qui donne en quelque sorte le coup d’envoi de l’entrée dans le drame, mérite une longue citation. Sans indiquer de date précise, l’autrice évoque la peur qui menace, les « Brigands », la « terreur » qui s’est emparée de la population tout entière, et pousse à s’armer :
[…] On s’assemble, on nomme des officiers pour conduire les citoyens : voilà la garde nationale établie. On veut un chef, et mon père est choisi. Il se promenait sur le cours : il est entouré, proclamé colonel. Il refuse ; on s’obstine, on le presse, et, après avoir hésité quelque temps, il se rend et accepte. Ma tante n’en fut point satisfaite. Je me rappelle qu’elle l’engageait à refuser ce dangereux honneur. Il n’était plus temps, des larmes s’échappèrent de ses yeux lorsqu’elle le vit reconduire chez lui par une foule nombreuse, et qu’une garde d’honneur fut placée à sa porte. Il y rentra, ne s’appartenant plus, devenu homme public, l’intérêt de ses enfants était secondaire, tout fut suspendu, plus de voyage, plus de projets ; nous restâmes. (p. I-12)
On peut dater cette nomination du printemps 1790 quand des émeutes antiféodales commencent, dans l’Allier, à être perçues comme de véritables menaces pour l’élite. Ce phénomène qu’on a appelé la « Grande Peur » a d’abord uni les paysans, les bourgeois et les nobles, en particulier, parmi ces derniers, ceux qui avaient de longue date servi dans l’armée, comme Étienne Giraud des Écherolles 137 . On a parlé de « verticalité des solidarités 138 », à ce moment de la Révolution. On peut aussi évoquer, à la suite de la très jeune fille qui observe son père, et de la jeune femme qui, à des années de distance, a désormais le recul nécessaire sur ces événements et ce qui s’en est suivi, la partition entre l’homme privé et l’homme public. La Révolution pousse les hommes, les femmes, les enfants dans l’espace public qui vient de s’inventer : l’événement va bientôt enrôler le monde, que celui-ci le souhaite ou non, à son corps défendant ou pas, dans une roue de la fortune dont personne ne sortira indemne. C’est ainsi, du moins, qu’Alexandrine Giraud, dans l’extrait cité plus haut, présente les choses, semble les vivre à l’époque, et les revivre à des années de distance : « [mon père] y rentra, ne s’appartenant plus, devenu homme public, l’intérêt de ses enfants était secondaire, tout fut suspendu ». (p. I-12) Peut-on mieux résumer le sentiment d’un engrenage, d’une perte irrémédiable, de la fin d’un monde, pour l’enfant à peine entrée dans l’adolescence ? Pour celle dont la principale perception de ce « monde » se résumait jusque-là, déclare-t-elle plus haut, à l’ennui des « longues visites pendant lesquelles, assise, ou bien droite et silencieuse, je comptais les vitres et les fleurs de la tapisserie pour me distraire » (p. I-8) dans les salons de Moulins, ou au confort d’être servie par des domestiques fidélisés ?
Échos assourdis de Paris
Le fracas de l’événement parisien reste à bonne distance : l’autrice fait rarement mention de ce qui se déroule pendant les premières années. Les États généraux transformés en Assemblée nationale, la prise de la Bastille, la Déclaration des Droits de l’Homme, rien de ce qui marque, pour nous aujourd’hui, la première année de la Révolution ne parvient aux oreilles de la petite fille de dix ans : « L’âge où j’étais ne me permet pas de me rappeler les détails politiques de l’époque, détails qui du reste se trouvaient au-dessus de ma portée » (p. I-15).
Le seul souvenir, rapporté dans le récit, qui soit lié à un événement parisien, et qui soit national tout à la fois, est celui de la Fête de la Fédération, en juillet 1790, à laquelle son père et son frère se rendent. Il est intéressant de remarquer, ici, que la jeune femme qui écrit à des années de distance, et s’est instruite entre-temps de tout ce que la petite fille ignorait, ne prend aucune peine pour décrire le projet révolutionnaire autrement que comme un choc emportant tout sur son passage. C’est le chaos qui préside à sa représentation de la période : un désordre inouï, incompréhensible, mû par une sauvagerie que rien, à ses yeux, ne permet de justifier ; un mouvement général, désordonné, que les hommes de son entourage, les anciens chefs armés, beaux capitaines balafrés se pavanant dans les rues de Paris, ne parviennent pas à endiguer. Des foules « éperdues », des rumeurs « absurdes », un goût de vengeance, « l’épouvante » partout, des « contes bizarres », un peuple qui porte son père aux nues, puis bientôt le rejette, le hait, le poursuit et l’exclut. L’incompréhension est partout, dans les yeux de l’enfant, et n’a pas cessé même des années plus tard. Telle est, sans doute, pour une partie de cette élite qui n’est pas parisienne, la représentation des premières années révolutionnaires : le passage soudain, brutal, d’une promesse d’égalité qu’elle ne prend même pas la peine de mentionner, qu’elle a à peine vue passer, à un déferlement de violence, d’irrationalité, et peut-être, même si l’autrice ne prononce pas le mot, pas encore du moins, de folie.
Un autre mot qu’elle ne prononce presque jamais, en tout cas dans les premières pages de son récit, c’est celui d’injustice. Celle qu’elle voit, celle qu’elle rapporte, c’est celle qu’elle subit – et elle arrive plus tard. Celle que vit le peuple, contre laquelle les députés de l’Assemblée votent des lois, instaurent la souveraineté populaire, déclarent l’égalité des droits, abolissent les privilèges, mettent fin au droit d’aînesse, la petite fille et l’autrice, sa porte-parole, y restent aveugles et sourdes.
Paris semble dérouler au loin ses combats, l’écho qui en arrive ne parvient pas aux oreilles de l’enfant : de la fuite du roi à Varennes, en juin 1791, il ne sera rien dit. Si cette fuite introduit des changements dans le lien qui unit le peuple et son roi, Alexandrine Giraud n’y est pas sensible. De même, si la fusillade du Champ-de-Mars, en juillet, bouleverse les équilibres politiques au sein de l’Assemblée, cela ne l’affecte en rien : ni Danton, ni Marat, n’émergent des personnalités qui dictent leur agenda à cette enfant, sa famille et son entourage. Si elle connaît peut-être leurs noms, ils lui importent moins que ceux qu’elle va bientôt croiser sur son chemin : Dubois-Crancé, Fouché, Chalier aussi, sont les hommes qui incarnent la Révolution. Le seul qu’elle évoque, et qui n’ait pas un lien direct avec sa vie, c’est Robespierre. De là où elle est, observant son père, sa tante – le premier, qui paye le prix de sa fermeté, de « ses efforts pour maintenir la paix » (p. I-15) et de sa bravoure ; la seconde, omnisciente, d’une prévoyante visionnaire –, elle n’aperçoit que les manipulations dont le peuple, réduit à une « foule », serait l’objet : jamais actrice vraiment, cette masse informe est le jouet de la rumeur et de la médisance de ceux qui, dans l’ombre, tirent les ficelles pour leur propre intérêt. « On » répandit des bruits alarmants de disette fomentée par des accapareurs, et le peuple « qui croit tout vit partout des ennemis » (p. I-13) 139 . Quant aux autres, les « mieux nés de la ville », les jeunes gens issus des « meilleures familles », ils sont toujours mus par de nobles élans et les intentions les plus généreuses : soit qu’ils choisissent, dans un élan d’enthousiasme et de loyauté au roi, de céder à la « fureur » qu’est devenue l’émigration, soit qu’ils cherchent, plus sages ou moins inexpérimentés, comme son père, à rétablir la tranquillité générale (p. I-16 et I-19).
Tout comme les événements marquants des premières années de la Révolution, les grandes lois, les bouleversements institutionnels restent loin du paysage qu’aperçoit la petite fille et que retrace sa porte-parole. Hormis la mort du roi, qui viendra plus tard, il semble que rien de décisif n’ait été voté par les députés réunis en Assemblée ou en Convention. Et s’il est un texte important, ce n’est pas celui de la Constitution de 1791 que l’autrice ne cite jamais. Si un ensemble de lois bouleverse sa vie, ce n’est pas celui-là, qui instaure le mariage civil, un droit de vote et d’éligibilité élargi, une assemblée constituante, mais ceux qui obligent les évêques et les curés à prêter serment, et les récalcitrants à entrer dans la clandestinité : la constitution civile du clergé et les décrets sur le serment obligatoire 140 . Si une catégorie de la population subit une injustice intolérable, qu’elle déplore et combat à chaque instant, c’est celle des prêtres. Voilà ceux qui ne méritaient pas la persécution dont ils sont l’objet et qu’elle n’explique jamais, ne s’explique sans doute pas plus : aux yeux de la jeune adolescente qui, à 13 ans, fait sa communion dans la précipitation, en mai 1792 (p. I-17) c’est-à-dire quelques jours seulement avant les mesures de radicalisation à l’endroit des prêtres « insermentés », dits « réfractaires », le camp du bien s’affronte au camp du mal sur cet unique terrain. Son jugement, tout au long du livre, sur les « intrus » (p. I-18) qui poussent l’audace jusqu’à porter le bonnet rouge en guise de mitre, qui ont cédé à cette injonction du pouvoir en place en jurant fidélité à la Nation, à la Loi et à la Constitution, sera toujours sans merci. Plus inflexible que la vieille Mlle Melon, l’enfant qui avait réussi à arracher à son père la promesse d’une éducation au couvent, qui plus tard avouera à son frère que son rêve a toujours été de devenir une « sœur grise » (p. II-152-II-153), ne semble voir les effets de la Révolution, du moins dans les premiers temps, qu’à travers le prisme de la lutte anticléricale. D’autres s’ajouteront, mais celui-ci ne perdra jamais son éclat.
10-Août
En août 1792, Étienne Giraud des Écherolles est emprisonné (p. I-20) 141 . Libéré après deux semaines de détention (p. I-35), grâce à l’intervention d’amis encore puissants, il est instamment invité à quitter Moulins et se voit délivrer un passeport à cet effet (p. I-[39]). Bientôt rejoint par sa fille et sa sœur, le trio cherche à rejoindre Lyon. « Le sang avait coulé dans Paris » (p. I-41), rapporte l’autrice, sans en dire plus sur les raisons de cet ultime sujet d’alarme. Il s’agit du 10 août 1792, journée fameuse, moment de bascule, dans les annales de l’histoire de la Révolution, mais réduite à « des bruits sourds, des rumeurs lointaines » (p. I-41) qui parviennent à la famille, à Roanne sur la route pour Lyon, sans l’instruire. On peut dater de manière approximative le moment où elle atteint Roanne, puisqu’on sait que Chalier, aperçu sur la route et auquel pour une fois le texte fait les honneurs d’une description assez détaillée, rejoint Lyon à la toute fin du mois d’août. On mesure alors le temps que mettent les nouvelles pour se diffuser puisque c’est quand elle est à Roanne, déclare l’autrice, que « la journée du 10 août retentit dans toute la France » (p. I-42). Peut-être tout simplement par la voix de Chalier lui-même qui, dit-elle, « profita de son rapide passage à Roanne pour y prêcher les doctrines nouvelles ; monté sur l’impériale de la diligence, pérorant de la voix et du geste, il appelait le peuple à la connaissance des bienfaits du 10 août » (p. I-42). On n’en saura pas plus sur les « bienfaits » de cette journée qui, dans l’esprit de l’enfant, ne font qu’exacerber l’écart entre sa conception du bien et celle clamée et incarnée par cet « énergumène », ce « jacobin forcené » dont la « bouche vomissait l’imprécation et le blasph[è]me ; une lave sanglante coulait de ses lèvres impies, et portait son ardeur dans la foule agitée » (p. I-42). Pour autant, si l’autrice se permet une telle description de l’homme, elle ne va pas plus loin sur le terrain du commentaire politique, en tout cas pas à ce moment du récit. Commentaire inutile, peut-être, pour elle qui juge le silence plus puissant que toute mémoire, fût-elle de l’ordre du blâme. Le 10 août 1792 qui a vu l’attaque du château des Tuileries, le roi contraint de rejoindre l’Assemblée sous bonne escorte et, dans la foulée, suspendu par un vote sous la pression des sections parisiennes victorieuses, et dont Chalier comme d’autres a bien compris l’importance symbolique, n’est donc pas autre chose qu’une aberration supplémentaire. « Mort au tyran » (p. I-42), crie Chalier avant de continuer sa route à bride abattue vers Lyon. C’est cette scène-là qui, d’après l’autrice, suffit à faire prendre conscience à son père que Roanne, pas plus que Moulins, n’est un lieu sûr, et qu’il faut s’empresser à son tour de rejoindre la ville, son anonymat, tout comme d’autres familles déjà en route 142 .
Lorsque la famille Giraud des Écherolles arrive à Lyon, lors de la troisième semaine du mois d’août 1792 (p. I-43), la ville est sur le point de vivre l’un des événements les plus traumatiques de la période, le premier d’une longue série, de ceux qui vont avoir des effets durables dans les mémoires et dans les décisions suivantes 143 . Logée dans l’Hôtel de Milan sur la place des Terreaux, elle aperçoit les officiers du Royal Pologne 144 passer sous ses fenêtres (p. I-44), entre le 23 et le 27 août 145 . Le bruit avait couru que les officiers nobles de ce régiment, « en stationnement depuis peu dans la ville et sur le point de la quitter déjà », explique Côme Simien, avaient l’intention de « rejoindre le royaume sarde ennemi, afin de s’engager, avec leurs soldats, aux côtés de son roi et du comte d’Artois (alors à Turin), contre la France révolutionnaire » 146 . Pour cette raison, ils avaient été mis en état d’arrestation et accompagnés, en plusieurs groupes et sous bonne garde, jusqu’à la forteresse de Pierre-Scize, Bastille lyonnaise surplombant la Saône.

Huile sur toile, 90 x 124 cm. [En ligne]
Dans les jours qui ont suivi, la famille Giraud des Écherolles a finalement trouvé à se loger, faute d’une autorisation de séjour dans la ville de Lyon, dans le faubourg de Vaise, municipalité distincte sur les bords du même fleuve 147 : c’est de cet emplacement que la jeune femme assiste, médusée, au massacre des hommes du régiment. Le contraste entre l’innocence de l’enfance qu’Alexandrine Giraud retrouve un instant en compagnie de la fille de leurs voisins, et la sauvagerie des bruits qui leur parviennent, est saisissant :
[…] Le 9 septembre, voulant jouir d’un temps assez doux, nous nous étions réunies plus tôt que de coutume dans le jardin, et nous sautions gaiement sous les beaux arbres qui en faisaient l’ornement, lorsque nos jeux furent tout-à-coup interrompus. La consternation se peignit sur toutes les figures, des cris sauvages se firent entendre, des bruits de peuple vinrent mugir jusqu’à nous comme une tempête furieuse, et portèrent l’effroi dans nos ames. (p. I-47-I-48)
Le massacre du 9 septembre 1792
Sur le déroulement de cet épisode tragique, nous renvoyons d’abord à la littérature bien documentée sur le sujet 148 , ainsi qu’à la description que l’autrice fait du rôle joué par le maire Louis Vitet, dans les pages qui suivent cette entrée en matière. Elle est fidèle, quoiqu’à certains égards plus détaillée, au récit qu’on en a fait 149 . Mais elle diverge aussi sur certains points, que l’historiographie n’a pas cru bon de retenir. Pourtant, elle tient le détail de son récit d’un témoin bien placé : le gouverneur de la forteresse, M. de Bellecize.
Sur les massacres du 9 septembre, deux points nous retiendront : d’abord, le décalage entre ce que l’autrice de Quelques années de ma vie en dit et ce que l’histoire en a retenu. Non pour départager le vrai du faux, mais pour souligner les oublis d’une historiographie masculine qui tend, dès l’époque et pour toute une partie des deux siècles à venir, à invisibiliser le rôle des femmes, et en particulier de l’une d’entre elles, dans cet événement 150 . Ensuite, la coïncidence de ce massacre avec d’autres, plus fameux et qui ont durablement marqué l’histoire française, au même moment à Paris. Non pour relativiser l’événement lyonnais, ni pour l’inscrire dans une quelconque influence parisienne qui dédouanerait la foule lyonnaise d’une partie de sa responsabilité, mais parce que nous prenons au sérieux la thèse de l’unique historien qui a fourni une monographie sur l’événement. Pour Côme Simien, en effet, il faut inscrire le 9 septembre dans un contexte, une « préparation mentale collective 151 » qui nous semble intéressante pour éclairer en partie pourquoi la jeune fille de 13 ans, déjà peu sensibilisée par son entourage aux ressorts économiques et sociaux du surgissement de la violence, ne peut voir le massacre autrement que comme « une tempête furieuse » (p. I-48), alors qu’elle vient d’arriver dans la ville et n’a pas la plus petite idée de cette « préparation mentale », encore moins de ses causes.
Un récit occulté
Sur les prémisses du massacre, Côme Simien livre le détail des différentes arrestations, heure par heure, échelonnées entre le 23 et le 25 août, et qu’on a déjà évoquées, puis le déroulé de la journée du dimanche 9 septembre. À la suite d’une cérémonie du serment organisée en grande pompe par la municipalité sur le Champ-de-Mars, aux Brotteaux, un attroupement d’hommes armés s’est formé dans le quartier de Port du Temple ; ce groupe a pris le chemin de la forteresse afin d’en extraire les officiers du Royal Pologne, soupçonnés d’avoir été placés là, aux portes de la ville, pour leur permettre de mieux échapper à la justice. Prévenu de cette procession menaçante, Louis Vitet se serait précipité vers la forteresse, aurait réussi à persuader les cent cinquante femmes rassemblées là, munies de piques, de quitter les lieux, avant d’atteindre la cour principale et le gros des troupes. D’après le récit qu’il en fait, il était sur le point de parvenir à rétablir le calme quand il est appelé à une autre porte, également assaillie par les émeutiers ; les événements auraient basculé à ce moment-là.
Le récit qu’en fait l’autrice de Quelques années de ma vie diffère sur la présence du maire, qu’elle situe dès le matin, auprès du gouverneur, afin de lui exprimer ses craintes de voir le peuple s’en prendre aux officiers. Toujours selon celle qui tient ce témoignage du gouverneur lui-même, ce dernier aurait assuré qu’avec quelques pièces de canon, il répondrait du château : « Le maire promit tout et n’envoya rien. » (p. I-49)
Dans l’après-midi, selon les récits qui sur ce point convergent, la foule parvenue à destination menace le gouverneur de pénétrer dans la forteresse si on ne lui remet pas les prisonniers. Selon le récit de l’autrice, seule à mentionner ce fait, le gardien des lieux, âgé, handicapé (il est perclus de goutte), semble ne pas avoir la force de se présenter ; c’est donc sa fille qui « répondit à ce dangereux appel » (p. I-49).
Mademoiselle de Bellecise, jeune personne douée d’un grand courage, parut seule, et déclara d’une voix haute et ferme qu’elle ne remettrait les clés qu’à celui qui avait le droit de les demander. Le silence qu’on avait fait pour l’écouter se prolongea par l’étonnement que produisit sur cette foule irritée la tranquille énergie d’une faible femme. Bientôt la demande des clés se renouvelant, elle s’avança pour les remettre elle-même au maire qui se trouvait présent. Ces clés, glissant de sa main, tombent à terre ; elle les ramasse avec le plus grand sang-froid, et les plaçant dans celle de M. Vitet, elle lui représente les devoirs dont il se charge, la sainteté du dépôt qu’elle lui confie, l’appui qu’il doit aux malheureux… S’en rappela-t-il ? (p. I-49-I-50)
Ce serait donc Louis Vitet qui aurait ouvert les portes du château. Le récit, ici, diffère singulièrement de celui que lui-même en fait. On ne s’en étonnera pas, sans pour autant en tirer de conclusion : si ce sont là des faits réels, comment pouvait-il reconnaître qu’il avait cédé devant la foule ? Il était à tout le moins prudent de douter de la véracité de sa version. Pourtant on a prêté à son récit une valeur de témoignage crédible. En revanche, des tentatives d’intervention de la fille du gouverneur, on n’a rien dit, ramenant son récit au mieux à de l’anecdotique, au pire à de la fiction. Le tri qu’effectue Côme Simien dans l’historiographie, afin de livrer un compte rendu documenté de l’événement, met de côté les contemporains suspects du fait de leur parti pris (Guillon, Maurille, Nolhac, Linsolas) ; Quelque années de ma vie est rangé, lui, du côté des sources qui peuvent être « utilisé[e]s pour quelques renseignements secondaires 152 ». L’autrice, qui se situe pourtant résolument du côté des contemporains suspects, se trouve ramenée à un témoignage qui ne livrerait que quelques renseignements secondaires. Alors qu’elle décrit finement, au contraire, presque chaque seconde de l’événement, la voici doublement secondarisée : en nombre et en valeur.
On peut légitimement considérer comme de peu d’importance qu’une personne tente en vain de faire barrage à la foule : bien d’autres scènes dans ce genre ont eu lieu, que l’historien·ne néglige de rapporter quand il ou elle n’y trouve pas de signification. En revanche, que la fille du gouverneur ait choisi de ne donner les clés de la forteresse qu’au maire, et que celui-ci ait ouvert la porte à la foule, est un élément non négligeable au regard de la responsabilité de l’élu. Ce qui nous intéresse dans cette « anecdote » est moins l’héroïsme de la jeune femme, aussi remarquable soit-il, ou les coups et blessures qu’elle a reçus à l’occasion (p. I-51-I-52), que la négligence des historiens (il faut bien parler, ici, au masculin) à l’égard du témoignage que rapporte l’autrice de Quelques années de ma vie. Même si l’on doute de sa véracité, il mérite d’être signalé, comme une autre version de l’histoire, ni plus ni moins crédible que celle qu’en donnent les principaux intéressés 153 .
Une « préparation mentale collective » ?
Nous voyons un autre intérêt de nous arrêter quelques pages sur cet épisode de l’entrée de Lyon dans une série de violences politiques qui vont durablement marquer la mémoire. Nous voyons un autre intérêt de nous arrêter quelques pages sur cet épisode de l’entrée de Lyon dans une série de violences politiques qui vont durablement marquer la mémoire.
Lyon est à l’époque de la Révolution une ville singulière dans le paysage national. D’abord, elle est la deuxième plus grande ville de France, qui compte 150 000 habitant·es 154 . Elle est surtout la seule qui présente une proportion d’artisans et de métiers dédiés à la fabrique de produits manufacturés. La moitié de la population travaille en particulier dans les métiers du fil de soie (bas, étoffes, du tissage à la teinte en passant par la confection, broderie mais aussi tirages d’or et d’argent…) 155 : elle se répartit en catégories très inégales, de l’ouvrier qui peine à survivre même en période de forte croissance au négociant fort à l’aise, en passant par les maîtres ouvriers au statut socio-économique intermédiaire et fragile 156 . En 1789, cette industrie de la « Grande fabrique de soie » est en crise depuis le traité de commerce conclu par Calonne, qui permet aux produits britanniques d’entrer en concurrence avec la soierie lyonnaise. Les années qui ont précédé l’entrée en Révolution ont donc déjà fortement amoindri l’activité. À partir de 1792, la dénonciation des inégalités sociales, des « riches insatiables 157 », incite les plus fortunés à éviter les signes ostentatoires de leur richesse. La guerre, qui vient frapper un marché majoritairement tourné vers l’étranger 158 , accentue la perte de croissance de la « Grande fabrique » lyonnaise. Le chômage s’accroît. En août 1792, la section de Saint-Georges dénonce les fabricants qui « ont totalement mis les ouvriers sans travail 159 ».
Se nourrir devient une lutte quotidienne, dans un environnement qui voit la valeur de l’assignat se dégrader, le blé manquer et la rumeur contre de prétendus accapareurs, ou un complot étranger, monter 160 . Ajoutons deux autres éléments qui ont contribué à alimenter la colère pendant l’été qui précède le massacre de septembre 1792 : aux alentours, certaines administrations, notamment le long de la Saône, inquiètes de voir leurs marchés se vider, captent sur leur passage les marchandises destinées à Lyon, contribuant à l’augmentation du prix du blé, mais également à l’insécurité alimentaire de la ville désormais déclarée en état de disette 161 . Dans ce contexte, les « Chalier » du Club central réclament la perquisition des magasins, la réquisition des grains et farines et la taxation des denrées de première nécessité, donnant une vigueur nouvelle à l’idée d’un droit à la subsistance. Il s’agit d’un contexte, d’un ensemble de pré-conditions, explique Côme Simien, ce ne peut être, à soit seul, un déclencheur de la furie qui se déchaîne : elle s’explique par d’autres facteurs, tels que l’exacerbation des tensions politiques et religieuses pendant cet été, ou des férocités impunies ayant pu contribuer à un sentiment d’impunité 162 .
Ce contexte socio-économique nous éclaire cependant sur ce que, une fois de plus, l’autrice ne voit pas sur le moment et refuse de prendre en considération des dizaines d’années après dans son récit de l’événement. Alors qu’elle est toute prête à considérer la responsabilité des « radicaux » dans la montée de la violence, à adopter l’optique strictement idéologique à laquelle certes on ne peut dénier sa pertinence, tout ce qui peut aider à expliquer les prises de position des « Chalier » lui reste inconnu, ou sans fondement. Bien entendu, les tensions grandissantes entre la partie radicale de la municipalité, incarnée par la personne de Chalier, engagé dans un combat à mort contre les riches (et soutenu par une population de plus en plus politisée par les sociétés populaires), et le département, beaucoup plus modéré, ont mis le feu aux poudres. Mais ces tensions n’auraient pas joué un tel rôle si elles avaient uniquement pris appui sur des idées, sans lien avec une réalité, en l’occurrence la peur de manquer ; et cette autre réalité, qui n’a pu que nourrir le ressentiment : le spectacle de celles et ceux qui ont les moyens de se bien et suffisamment nourrir, et dont fait partie, évidemment, la famille de l’autrice. Lorsqu’elle croise Chalier de retour de Paris, à Roanne, la jeune Alexandrine, médusée, n’a pas vu qu’un enragé clamant sa haine des riches ; des années plus tard, l’autrice de Quelques années de ma vie ne voit toujours pas, dans cet homme qui vient d’être réhabilité par l’Assemblée elle-même, celui qui porte les intérêts des classes populaires frappées depuis des années par la crise socio-économique.
Le massacre du 9 septembre joue un rôle considérable dans l’imaginaire des catégories persécutées, bien entendu, mais il sert aussi de fer de lance dans la lutte de partis qui s’enclenche quelques mois après, et a elle aussi des répercussions sur la ville et ses habitant·es. En effet, selon Côme Simien, les officiers du ci-devant Royal Pologne, qui ont été massacrés, deviennent « les otages d’une bataille politique entre modérés et radicaux 163 » dont l’acmé se situe dix mois plus tard, au moment du procès de Chalier : les premiers l’accusent d’être le principal responsable de cette barbarie et justifient que le chef des radicaux soit condamné ; pour les seconds, c’est au contraire par cette « salutaire terreur » que l’épouvante fut jetée dans « l’âme des méchants » et « paralysa leurs noirs projets » 164 .
De ces dix mois qui suivent ces massacres, l’autrice ne décrit guère les détails de cette tension grandissante entre le département et la municipalité. Point d’orgue de la période, à ses yeux : l’exécution de Louis XVI, le 21 janvier 1793, qui aurait enseveli la ville « sous un crêpe funèbre » (p. I-67), faisant craindre le pire aux partisans d’un retour à la monarchie. À Lyon, les « visites domiciliaires » jettent la terreur dans les familles 165 ; Brugnon, le domestique de son père, s’est inscrit à la section et rapporte chaque soir, pendant les bombardements, la « sanguinaire éloquence » (p. I-87) qu’il y a entendue, suscitant bien souvent les rires de son auditoire nerveux, inquiet mais sûr de son bon droit et de sa supériorité intellectuelle.
29 mai 1793
La mort du roi ouvrait une ère sanglante, hâtée par les vœux des Jacobins. Ils multiplièrent leurs réunions secrètes ; une activité extraordinaire régnait parmi eux, et, malgré le mystère dont ils s’entouraient, des bruits sinistres sourdaient de toutes parts ; on se sentait pressé par un invisible ennemi, et des menaces atteignaient les plus braves. Enfin on eut connaissance qu’ils tramaient la perte d’une grande partie des habitants de la ville ; aussitôt les Lyonnais se levèrent en masse pour se défendre. La journée du 29 mai (1793) ouvrit une noble carrière à leurs courages. Croisade sainte, où ils marchèrent à la conquête de leur vie et de leur liberté. (p. I-69-I-70)
Le récit qu’en fait l’autrice de Quelques années de ma vie est rapide, présentant la journée du 29 mai 1793 comme une saine et nécessaire réaction des partisans de la liberté aux menées de Chalier. Menées résumées à la rumeur selon laquelle il avait le plan d’installer des canons de part et d’autre du pont Morand pour y exécuter toutes les personnes ne soutenant pas la République : aristocrates, modérés, riches, neutres, égoïstes, dévots, parents d’émigrés, etc.
Alexandrine des Écherolles, qui s’en tient à rapporter les violences plutôt que leur contexte, ne dit pas que la tension politique s’accroissait, depuis l’élection du nouveau maire, Nivière-Chol, en novembre 1792. Ce dernier avait démissionné en février, alors que le « Club central » demandait la création d’un tribunal révolutionnaire. Réélu contre Chalier, « preuve », selon Valérie Trillat, « que les assembles de sections sont dominées par les modérés » 166 , il avait refusé son mandat et la fonction avait échu au jacobin Bertrand, un proche de Chalier, le 8 mars 1793. Ce dernier avait pris des mesures d’exception : la création d’une boulangerie municipale, la taxation des vivres, l’enrôlement de volontaires. Le « Club central » avait renchéri en demandant l’établissement d’un maximum des grains et en obtenant la création d’un tribunal révolutionnaire, la permanence de la guillotine et le remplacement de la garde nationale, jugée trop bourgeoise, par une armée révolutionnaire financée par une contribution forcée des plus riches.
Le 29 mai au matin, 26 sections (sur 32) s’étaient réunies en assemblée et avaient décidé de renverser la municipalité, en jurant, explique Édouard Herriot, « de maintenir la Liberté, l’Égalité, la République une et indivisible et la représentation nationale », « de sauver la ville ou d’attendre la mort à leur poste 167 ». Les sections lyonnaises refusaient le pouvoir de Chalier et son programme social de « jacobinisation forcée » ; d’autres mettent en avant la mise en cause par Chalier du « syncrétisme professionnel », base et condition sine qua non du négoce ; ce serait, selon Pierre-Baptiste Guillemot, l’une des explications de cette mobilisation populaire autour des sections réfractaires 168 . Pour d’autres, comme l’historien marxiste Takashi Koï, c’est la peur du partage forcé des propriétés et des biens qui enclenche la réaction des sections 169 .
Le rôle des sections
Les clubs de sections avaient été créés en août 1790, en réaction aux deux clubs à la composition sociale beaucoup plus élitiste : la Société des Amis de la Révolution et la Société des Amis de la Constitution, plus bourgeoises et légitimistes, n’admettant par exemple que les citoyens actifs. Louis Vitet, au nom du directoire du District s’était inquiété auprès de l’Assemblée nationale de la création de ces 31 clubs lyonnais, désormais ouverts aux citoyens passifs, qui quadrillaient la ville et rassemblaient plusieurs milliers de Lyonnais ; en novembre 1792, le même écrivait à Roland que la fraction robespierriste du Club central allait désormais commander en souverain, et qu’il fallait s’attendre à voir renaître les troubles les plus grands, le désordre, la violation « des propriétés et peut-être des sûretés individuelles 170 ». La taxation des denrées, réclamée par les femmes en septembre, un tarif minimum voire la nationalisation pour les biens de première nécessité, l’idée que la propriété individuelle est moins importante que le droit du peuple à l’existence, la taxation des plus riches sont autant de mesures évoquées ou débattues dans les sections, dans une période où l’assignat perd tous les jours un peu plus de sa valeur et où le prix du froment ne cesse d’augmenter. Le 6 février, il est décidé de créer « un tribunal extraordinaire, de s’emparer de l’Hôtel de Ville et de procéder immédiatement aux exécutions 171 », ce qui entraîne la démission du maire et l’élection d’une nouvelle municipalité, jacobine cette fois. Le 25 mars, Chalier participe à la rédaction d’une tribune envoyée à la Convention. Elle justifie le maximum des grains en ces termes :
Le propriétaire, à la table duquel le nectar de la fortune pétille dans des coupes d’or, l’accapareur vieilli dans l’infâme trafic de la subsistance du peuple, sans doute s’élèveront contre cette mesure de l’intérêt ; mais les sans-culottes la scelleront de leur sang […]. [Le peuple] est aux prises avec le besoin ; peut-il donc, dans un morne silence, voir sa propriété, son existence, indignement lacérées, devenue la proie d’une troupe de voraces scélérats ? Peut-il ne pas se dresser aux approches de la mort, que la hausse toujours croissante des subsistances appelle sur sa tête ? Peut-il rester assis, attendre les fers que [les] calamités publiques, combinées par ses ennemis, préparent à sa liberté ? Non 172 .
Les sections soutiennent cette motion. La Convention, le 4 mai, arrête le maximum du prix des grains que le département de Rhône-et-Loire applique dans les semaines qui suivent. Autre mesure en passe d’être appliquée lorsque l’insurrection éclate : la taxation forcée des plus riches, afin de soutenir la levée en masse des volontaires partant aux frontières, et la subsistance des femmes et des enfants laissés sans soutien. À mesure que les Chalier passent ces décrets, tentent de prévenir ou de guérir l’opposition par les visites domiciliaires, la tension monte entre la Municipalité et les sections.
La section de Port Saint Paul s’exprimera très clairement sur son positionnement et son refus de suivre Chalier : la Municipalité, déclare-t-elle, a perdu sa confiance par ses « actes arbitraires », « par la dénonciation et l’arrestation de plusieurs de ses membres pour cause criminelle », « par ses arrêtés incendiaires », notamment celui par lequel elle a ordonné la mise en vigueur du décret sur la taxation des riches pour les frais de l’armée révolutionnaire, « par son refus constant de rendre des comptes », « par la violation de domicile de jour et de nuit », ou encore par « son adhésion à l’établissement d’un Tribunal révolutionnaire et à la permanence de l’instrument de mort [la guillotine] 173 ».
De cela, de la misère grandissante, de l’augmentation du prix des denrées, Alexandrine des Écherolles ne dit jamais un mot. Les lui a-t-on cachées à l’époque ? Cherche-t-elle à ne rapporter que ce dont elle a été témoin ou dont on lui a fait le récit à ce moment-là ? Il lui arrive souvent de se justifier ainsi : « [v]oyant les effets sans connaître les causes, jeune et simple témoin, je me borne à raconter ce que j’ai vu ou entendu. » (p. I-71) Plus loin :
Je crois devoir rappeler encore que je raconte simplement ce que j’ai vu ou entendu, sans pénétrer dans les dédales d’une politique au-dessus de mon âge. Le seul mérite de ce récit est d’être vrai. Je dis les effets dont j’ignore les causes. Sans prévoyance pour l’avenir, sans prudence, fruit du passé, l’enfance ne vit qu’au présent. (p. I-82)
C’est ainsi que, le plus souvent, son récit est parsemé de détails qu’on ne trouve pas dans d’autres récits, et que le spectacle de la violence, des émotions ressenties enfant, prend le pas sur les facteurs explicatifs. L’autrice n’est cependant pas toujours d’une rigueur absolue dans l’application de cette règle : elle se permet des jugements, sur Chalier par exemple. Mais sur les raisons pour lesquelles la tension monte à nouveau dans les mois qui suivent le massacre des officiers du ci-devant Royal-Pologne, sur les motifs qui opposent les tenants du maximum, de la taxation des plus riches et ceux qu’elle situe du côté de la liberté – motifs qu’elle ne pouvait ignorer, ayant lui l’histoire de Lyon par Guillon 174 –, elle choisit de se taire.
Le 29 mai, 23 sections s’assemblent pour marcher contre la Municipalité : l’hôtel de Ville est bientôt assailli par la foule ; il y a plus de 40 morts 175 au cours des combats aux alentours, qui donnent la victoire aux sections « modérées ». Les « Chalier » sont arrêtés et leur chef, jugé et exécuté le 16 juillet 1793 sur la place des Terreaux. On suit assez bien, dans le récit de l’autrice, le déroulement des combats non par un témoin – elle n’y était pas en personne –, mais une synthèse des témoignages qu’elle a recueillis à l’époque, et peut-être après. Cette synthèse offre un point de vue, évidemment situé mais qui mêle, dans un mélange détonant, la reconnaissance, la valorisation des actes de violence, mais aussi la réprobation et le dégoût. Certes, les sections ont, selon elle, libéré Lyon du joug des Jacobins, mais la « populace » s’est montrée féroce jusqu’à la monstruosité :
Les femmes de ces monstres suivaient les colonnes, comme ces loups dévorants, avides de cadavres, qui se montrent après une bataille ; ces femmes-monstres elles-mêmes, dignes de leurs époux, achevaient les blessés avec une cruauté inouïe. [En note : Un jeune homme voyant tomber son ami à côté de lui, le prit sur ses épaules, pour ne pas le laisser exposé aux outrages de cette populace cruelle. Il en fut aperçu par une de ces femmes. Furieuse qu’un blessé lui échappe, d’un coup de poignard, elle fend le ventre de celui qui le porte, et les achève tous deux.] (p. I-72)
La chute de Chalier
Sur la chute de Chalier, l’autrice ne s’interroge pas : il va de soi pour elle qu’un pouvoir aussi attentatoire aux libertés (d’être fortuné) ne pouvait que tomber. L’historien Takashi Koï considère lui aussi que le discours haineux vis-à-vis des riches avait fait se répandre une peur dans tout l’espace social, au moins jusqu’à la petite et moyenne bourgeoisie qui pouvait se demander si elle ne serait pas, tôt ou tard, taxée à l’instar des plus riches. Mais l’historien avance également des raisons d’une part plus structurelles, liées à la spécificité de la Fabrique, qu’Alexandrine Giraud ne peut qu’ignorer, d’autre part plus conjoncturelles, telles que l’échec des politiques destinées à ravitailler la ville, échec dont là non plus elle n’est sans doute pas tenue informée par son entourage : « les ouvriers en soie et les autres petites bourgeoisies artisanales et traditionnelles ont peut-être préféré les mesures rolandines qui visèrent à la résurrection de la Grande Fabrique et au dénouement de la crise du chômage, sans réorganiser les nouveaux liens sociaux à Lyon 176 . » L’imbrication des rapports de pouvoir, dans la Fabrique, l’indétermination du statut des ouvriers en soie, qui possèdent un atelier, un métier et emploient parfois des compagnons et des apprentis, tout en étant soumis aux négociants et aux lois d’un marché non régulé, n’aide pas à se situer socialement : ne formant pas encore un prolétariat dénué de tout moyen de production, ils ne se définissent pas comme une classe sociale opprimée, ni ne se situent pas aisément dans l’opposition, proposée par Chalier, entre les riches et les pauvres. Une autre explication tient à l’échec de la politique de Chalier contre la disette : « Le 8 mai, la Municipalité est obligée d’annoncer que la Ville est à la veille de manquer de subsistances 177 » ; quelques semaines plus tard, juste avant de faire tomber la Municipalité, la population subit « les approvisionnements exigés pour l’armée des Alpes » : « Ainsi, “les Chalier” n’ont pas encore assuré les subsistances pour le peuple » 178 .
Les comités de surveillance des sections sortent renouvelés de la journée et de la soirée du 29 mai. Des élections sont organisées pendant tout le mois de juin. C’est aussi à ce moment que des sections décident de modifier leur nom (Port Saint-Paul devient la Concorde, par exemple). Les administrations du Département et des Districts restent en place, mais la Municipalité est totalement remplacée. Une Commission populaire républicaine et de salut public est mise en place, constituée des 207 députés du Département. Les présidents se succèdent à sa tête ; ses membres jurent de « maintenir la liberté, l’égalité, l’unité et l’indivisibilité de la République, l’intégralité et l’inviolabilité de la Convention Nationale, la soumission aux lois, la sûreté des personnes et des propriétés et de mourir plutôt que de violer ce serment 179 ». Cette commission s’adjoint bientôt les administrations du Département, du District et de la Municipalité de Lyon, et, le 3 août, prend le nom de Comité général de surveillance et de salut public du département de Rhône-et-Loire. La Commission populaire réunie au Comité général va devenir une pièce maîtresse de la résistance au siège 180 .
Cependant, les commissaires à l’armée des Alpes, Albitte et Dubois-Crancé, se montrent inquiets. Ils dénoncent une ville qui a violé les lois de la République, méconnu la représentation nationale, et égorgé le peuple 181 . Les efforts en sens inverse des commissaires Rouyer et Brunel demeurent vains 182 alors que, rappelle Valérie Trillat, « les Lyonnais ne cessent de proclamer leur anti-fédéralisme et d’afficher leur républicanisme 183 », notamment par l’acceptation de la nouvelle Constitution 184 , fin juillet, et la célébration des fêtes patriotiques. Au cours de la célébration du 14 juillet, le maire provisoire déclare :
L’abîme où nous sommes a été creusé par des hommes ambitieux et pervers. […] Ces hommes de boue et de sang voudraient vous détacher de vos frères des villes. […] jurons de maintenir la liberté, l’égalité, la République une et indivisible. Jurons enfin de ne poser les armes que lorsque le règne des lois sera affermi 185 .
Mais, aux yeux de la Convention, plusieurs « incidents » attestent de la mauvaise volonté de la ville. Et le procès de Chalier, suivi de son exécution le 16 juillet 186 , atteste de cette Contre-Révolution qui se déroule au nom de la liberté 187 : dès que s’ouvre le procès, « la rupture entre Lyon et Paris semble inévitable 188 ». En réalité, les choses s’enclenchent de manière irréversible bien avant.
Dès le 2 juin, Albitte et Dubois-Crancé avaient requis Kellermann, général à l’armée des Alpes, de faire marcher sur Lyon dix bataillons d’infanterie, deux escadrons de cavalerie et l’artillerie de siège et de bataille 189 . Les sections étaient parfaitement informées de ces préparatifs, et réclamaient à la Municipalité les moyens de faire face à une attaque aux portes et sur les hauteurs de la ville 190 . Le 4 juillet, la Commission populaire, qui venait d’auditionner Birotteau, député girondin en fuite tenant un discours « incendiaire » et « totalement irresponsable » sur le despotisme parisien, s’était déclarée en état de rébellion ouverte contre la Convention 191 . S’ensuivrait toute une série de prises de libertés avec la légalité, dont celle d’imposer l’autorité de la Commission populaire sur les assemblées élues, de mettre en circulation un papier monnaie extraordinaire, de lever une force armée… : en somme, explique Michel Biard, « Lyon a pendant plusieurs mois été dirigée par des autorités extraordinaires et s’arrogeant des pouvoirs au nom de cet état de “rébellion” vite attribué à la ville par un décret de la Convention 192 ».
En effet, le 12 juillet, la Convention nationale a adopté un décret déclarant la ville en état de rébellion, et décidé l’envoi d’une force armée contre Lyon, ordonnant aux étrangers à la ville de quitter les lieux dans les trois jours 193 . Et c’est à cette période, en juillet 1793, qu’Étienne François Giraud des Écherolles, le père d’Alexandrine, a été sollicité pour prendre la tête de l’armée qui se formait pour la défense de Lyon 194 . On sait que, s’étant jugé trop âgé pour une telle responsabilité, il a décliné cette proposition 195 (p. I-82-I-83), préférant se contenter d’une participation à la défense des portes de Saint-Just et de Saint-Irénée 196 (p. I-92).
Louis François Perrin de Précy (1742-1820) est finalement sollicité, peut-être, écrit Pierre-Baptiste Guillemot, en raison de ses soutiens « particulièrement influents au sein des administrations lyonnaises 197 ». Il est nommé le 8 juillet et prête serment lors de la fête de la Fédération, le 14 juillet, promettant de « faire triompher la cause de la liberté et de l’égalité », de « faire respecter les personnes et les propriétés, pour maintenir la République une et indivisible, pour résister à l’oppression et terrasser l’anarchie » 198 . Il s’entoure principalement d’ex-nobles dont une partie ont émigré et dont les convictions royalistes ne sont un mystère pour personne, mais qui sont, aussi, pour la plupart, d’anciens chefs militaires.
La question s’est posée, à l’époque et depuis, d’un commandement confié à un aristocrate 199 . D’une manière plus générale, on s’est interrogé sur l’existence d’un « réseau 200 » royaliste dans le Lyon de 1793. Selon Pierre-Baptiste Guillemot, si les royalistes voient d’un bon œil cette insurrection, ils n’en furent pas pour autant les meneurs : leur place, dans les événements lyonnais de mai 1793, demeure « assez marginale 201 ». Cependant, l’historien montre bien la proximité géographique entre les membres du « réseau », avec Bellecour comme épicentre ; leur socialisation scolaire dans un même collège, dit de Juilly ; enfin, parfois, leur appartenance à la franc-maçonnerie. Mais il ne trouve pas de documents permettant d’attester que, entre ces personnes, il y ait eu un projet politique autre que la défense de la ville. On sait par l’autrice que son père détruira un grand nombre de papiers lorsque la ville tombe (p. I-114). Il est possible mais improbable qu’absolument tous les documents prouvant l’existence d’un projet politique aient été détruits.
La ville ne dispose pas d’une armée départementale. Le 13 juillet, cette levée est décrétée : elle doit réunir 9 600 hommes, dont 7 200 fournis par la ville de Lyon. D’après Édouard Herriot, « l’appât d’une solde régulière, en ce temps de misère et de chômage, a provoqué beaucoup d’enrôlements 202 ». Seulement 3 000 hommes rejoignent les casernes 203 , et l’objectif de 7 200 Lyonnais enrôlés ne sera jamais atteint 204 . Pendant tout le siège, Précy multipliera les appels aux bonnes volontés, puis les menaces, puis les exigences pour que tout homme de moins de 50 ans fasse son devoir sous peine d’être « regardé comme un lâche, ou traité comme ennemi 205 ». Quel âge ont-ils ? Un arrêté fixe à 16 ans l’âge minimal, à 60 ans l’âge maximal pour s’enrôler 206 : ils sont casernés et en réquisition permanente. Lyon possède deux fonderies de canons, une fabrique de poudre, l’arsenal dispose de plus de 100 000 cartouches, presque 12 000 boulets, 2 000 obus, quelques centaines de fusils 207 . Saint-Étienne possède également un arsenal et fabrique des armes, qui seront régulièrement acheminées à Lyon. La ville n’en manquera pas moins d’armes tout au long du siège 208 .
On entame des travaux de fortification, notamment dans le faubourg de Vaise ; on hérisse la Croix Rousse de canons ; on dresse des redoutes à Perrache et au débouché du pont Morand, sur la rive gauche du Rhône. Tout au long de la période, et jusqu’à la fin du siège, on recrutera et on manquera d’ouvriers 209 .
Certaines sections, comme celle de la Juiverie, décident de ne pas envoyer d’hommes. Dans la section de Saint-Nizier au contraire, on assiste à un mouvement spontané d’enrôlement. Une cinquantaine de communes, du Département et d’ailleurs, qui envoient des lettres d’encouragement aux sections, se prononcent en faveur de l’insurrection 210 .
Le 4 août, le Comité de salut public ordonne : « marchez sur Lyon ; portez-y toutes les forces qui sont à votre disposition 211 ». Le 6 août, Dubois-Crancé et Gauthier répondent qu’ils attaqueront le 8 au matin, avec les 20 000 hommes dont ils disposent 212 . Le 8 août, l’armée fait feu sur la ville.
Le siège de Lyon
Le siège de Lyon débute ainsi le 8 août avec les premiers échanges de tirs, et se termine par la reddition de la ville le 9 octobre.
Lyon est alors, comme bien d’autres villes françaises, une cité close sur l’essentiel de son pourtour. On y pénètre par des portes gardées, ou par les deux ponts sur le Rhône qui ouvrent la ville à l’Est : celui de la Guillotière et celui, plus récent, à péage, construit par l’architecte Antoine Morand en 1773, qui relie la presqu’île aux Brotteaux, un quartier à peine bâti où les Lyonnais·es vont se distraire le dimanche. Cette enceinte est moins défensive que destinée à prélever des impôts sur toutes les marchandises qui pénètrent dans la ville.
La description du siège que fournit l’autrice fournit est, d’abord, une description de l’intérieur bien sûr : elle paraît, cette fois, plus proche de ce qu’il se passe dans les rues. On devine que l’enfant protégée jusque-là du spectacle de la misère et du malheur s’y confronte cette fois de plein fouet. Ce qu’elle rapporte est, dans sa chronologie, d’une exactitude qui force l’admiration – et pose, une fois de plus, la question de ses sources et/ou de l’étendue de sa mémoire. De l’explosion de l’Arsenal, de la route de Moulins restée libre et permettant l’approvisionnement, des incendies des maisons, des femmes de toutes conditions qui font passer les seaux d’eau pour éteindre les incendies, de l’hôpital bombardé, du manque de ravitaillement, du pain « détestable », de la relative aisance du faubourg de Sainte-Foy approvisionné par les paysans du voisinage, de sa quête d’aumônes pour aider les indigents de Saint-Irénée, des désertions qui se multiplient, de l’esprit de découragement qui gagne, de l’imagination épouvantée, de l’approche de la mort : de tout cela il est question dans son récit, que l’on peut considérer comme un témoignage d’une exactitude redoutable, même s’il reste partiel et partial.
Partiel, car l’autrice ne révèle que peu de choses sur les combats. Soucieuse de raconter ce qu’elle voit à hauteur d’enfant, elle s’en tient à la description de son excitation d’abord, puis de ses craintes, de ses frayeurs, du spectacle que représente parfois, pour elle, telle explosion particulièrement spectaculaire, de l’attitude enfantine de tel voisin venu se réfugier dans l’appartement de sa tante et qui se cache derrière les rideaux de mousseline « comme sous un bouclier d’airain » (p. I-88). Des personnes engagées dans les combats, dont elle avait fait des portraits saisissants pour la journée du 29 mai, on ne saura rien 213 . Du couvre-feu qui interdit « aux femmes, aux enfants, aux vieillards hors d’état de porter les armes, d’être hors de leur domicile après que le canon d’alarme aura été tiré 214 », elle semble ne rien savoir. De l’interdiction absolue, sous peine de mort, d’arborer la cocarde blanche, elle ne dit mot 215 . Des intrusions dans les domiciles des habitant·es qui ont quitté la ville, afin d’y saisir des matelas, des combustibles, des comestibles, du vin, non plus 216 . Des perquisitions dans les boutiques, pas davantage. De l’ordre réitéré d’empoisonner les chiens, par la Municipalité qui voit en eux des consommateurs de subsistances précieuses, rien non plus 217 . De l’instauration de deux catégories de pain, le pain national et la miche de pain blanc, de l’interdiction de fabriquer des pâtisseries pour ne pas faire monter le prix du beurre et des œufs, du rationnement du pain, de la délivrance de cartes de pain, Alexandrine des Écherolles ne fait pas mention, du moins pas tant qu’elle est encore sous la responsabilité de sa tante 218 . De la nécessité de couper tous les arbres, sauf les fruitiers, pour fournir du combustible aux boulangeries, la petite fille ignore tout 219 . Des « certificats d’incendie » accordant des secours, notamment un logement (insalubre) aux familles victimes du feu, elle ne sait sans doute pas grand-chose 220 .
Partial, à plusieurs égards, d’abord parce que l’autrice laisse penser que toute la ville est décidée à défendre Lyon : « [u]n seul cœur battait dans toutes les poitrines, un sentiment unique inspirait les hommes et les femmes : résister à la tyrannie. » (p. I-84). Ce n’est qu’une partie de la vérité, ce qu’elle admet un peu plus loin. D’après Valérie Trillat, les autorités peinent dès le début à mobiliser toute la population dans la construction des redoutes, par exemple, et, tout au long du siège, elles vont rester persuadées que les ennemis de l’intérieur se réunissent pour « former de fausses patrouilles, […] chercher à faciliter l’entrée » des ennemis, pour « poignarder, voler, assassiner », pour allumer des incendies et par là, guider les tirs ennemis 221 . À mesure que le siège durcit les conditions de vie, les désertions se font plus nombreuses, amenant Précy mi-septembre à placarder un appel désespéré aux bonnes volontés : « la ville n’a besoin que de gens utiles, elle est en danger, il ne doit exister qu’un seul cri : sauvons-là, ou périssons tous 222 . » Les administrations sont également désertées, dès la fin juillet il manque des députés et nombre d’officiers municipaux, ce qui amène Valérie Trillat à conclure : « La ville est donc administrée par un petit groupe d’hommes qui ne peut résister longtemps alors que la population a capitulé et refuse de poursuivre le combat 223 . »
Ensuite, le récit est partial par la mise en scène simpliste et jamais vraiment justifiée, comme on l’a déjà observé, du camp du bien contre le camp du mal : si un seul cœur bat dans la ville, il s’agit pour l’autrice de Quelques années de ma vie du cœur des « bien pensants 224 ». Les autres, ceux qui travaillent « dans l’ombre à faire échouer les plans conçus pour le salut de Lyon » (p. I-85), portent un nom : ce sont la « populace », la « grande multitude d’ouvriers en soie qui manquaient d’ouvrage », en un mot les « canuts » (p. I-85). La Municipalité et le Département sont emplis de ces « faux frères », qui surpassent en nombre celui des patriotes lyonnais (p. I-85-I-86) : ils forment une « espèce pauvre et corrompue » et « n’avaient rien à perdre et tout à gagner. Chacun d’eux, voyant sa fortune dans le trouble général, devenait l’ennemi de tous ceux qui voulaient rétablir l’ordre. Ils firent naître la disette prématurée qu’on ressentit bientôt dans la ville » (p. I-86). Non contents de saper la défense, ils jouent le rôle d’espions : « pénétrant le secret des résolutions du conseil, ils les faisaient connaître aux assiégeants », si efficacement que l’autrice en conclut que « [l]’armée qui nous assiégeait était moins dangereuse pour nous, que cette foule de gens hostiles qui tramaient nuit et jour des trahisons nouvelles » (p. I-86). Il est bien sûr indéniable que sur la « colline qui travaille », vivaient des partisans de la Convention ; mais de là à considérer que tous les canuts ont œuvré contre, quand on sait que, dès le 5 juin, 900 hommes de Cuire-La Croix-Rousse sont annoncés en état de porter les armes et que, par sa situation avantageuse, la commune sera utile à la défense de la ville, qu’un mois plus tard une députation offre 3 000 livres à la Commission populaire pour financer la défense, on peut difficilement amalgamer, comme le fait l’autrice, « les canuts » et le parti de la Convention 225 .
Après deux mois d’« escarmouches 226 », la jeune femme assiste, le 29 septembre, à l’un des combats les plus meurtriers de l’inexorable capitulation de la ville, et à la chute de « la position maîtresse 227 » que représentait Sainte-Foy. Le 8 octobre, la redoute de Saint-Just, celle que défend Étienne Giraud des Écherolles, tombe ; dès la veille, des commissaires des sections et des bataillons s’étaient réunis à Saint-Nizier pour implorer la fin des hostilités 228 , mettant Précy en fureur. Mais le général comprend, aussi, que l’heure de la retraite est venue et s’organise en conséquence 229 . Le 9 au matin, un convoi de presque 1 500 personnes, dont la moitié sont des femmes et des enfants, s’enfuit par Vaise, mené par Précy. Le récit d’Alexandrine en rend compte de manière précise :
M. de Précy ayant reconnu toute l’impossibilité de défendre plus long-temps la ville, résolut de la quitter, espérant probablement assurer le salut des citoyens paisibles, en éloignant de leur sein les individus qui avaient pris une part active à la révolte. Il engagea donc tous ceux qui avaient porté les armes à le suivre, pour échapper ensemble à la vengeance d’un ennemi dont tout faisait présumer la cruauté.
Deux colonnes nombreuses sortirent de la ville ; la première dut son salut à l’épais brouillard qui couvrait la Saône dont elle côtoyait silencieusement la rive gauche. Elle passa de même au-dessous de la Duchère. Toutes les précautions possibles avaient été prises pour éviter le moindre bruit, elle eut le bonheur de traverser les postes ennemis, en échappant à leur vigilance. Parvenue à un certain éloignement, la colonne se dispersant à l’instant, chacun chercha de son côté à pourvoir à sa sûreté personnelle, et beaucoup y parvinrent. (p. I-106-I-107)
Trop peu mobile, en raison notamment des malades, le deuxième convoi sera pris à revers et, à Saint-Rambert, 500 personnes seront laissées derrière, mortes, blessées ou prisonnières 230 .
À la Convention, les représentants annoncent que leur entrée dans la ville a été saluée par des acclamations, aux cris de « Vive la République, Vive la Montagne, périssent à jamais la royauté et le fédéralisme 231 ».
Assurément partiel, également partial à certains égards, le récit de l’autrice n’en apporte pas moins des informations que l’on ne trouve nulle part ailleurs sur le siège de Lyon. Les femmes sont souvent citées ; elles sont plus que d’autres sous le regard de l’enfant, qui semble garder en mémoire plus particulièrement ce qu’elle observe et ce qu’elle admire, ce qui la touche peut-être aussi :
[…] Les dames les plus délicates assistaient aux exercices à feu, à l’essai des canons. Rien ne paraissait les effrayer ou les surprendre. Ne connaissant qu’un seul danger, elles n’avaient qu’une seule pensée : le salut de tous. Elles y travaillaient de tout leur pouvoir. Identifiées avec le parti qu’elles prennent, les femmes ne font qu’un avec lui ; elles en acceptent généreusement toutes les conséquences, et [ja]mais elles n’ont failli à l’épreuve. (p. I-84-I-85)
Ainsi, l’épisode mettant en scène Mlle de Bellescize qui part secourir sa sœur, se voit refoulée à la barrière, et revient armée de deux pistolets, habillée en homme, réussissant à se faire passer pour un jeune adolescent, sur lequel on reviendra plus loin 232 . La visite minutieuse de l’hôpital de la Charité, qu’elle nous fait faire également, décrit la situation des enfants et de leur unique nourrice :
La salle des enfants trouvés en contenait beaucoup qui manquaient de nourrices, le siége ayant empêché les femmes de la campagne de venir les chercher. La seule nourrice qui fût dans l’hôpital, s’était dévouée à l’un de ces petits malheureux dont l’extrême faiblesse exigeait des soins sans partage. Une seule vache échappée à la proscription générale soutenait les autres. (p. I-109)
C’est aussi elle qui rappelle combien le deuxième convoi emmené par Précy subit des pertes considérables, peut-être du fait d’une mobilité réduite en raison du grand nombre de femmes, mais aussi d’enfants :
[…] La seconde colonne partit trop tard, le brouillard était un peu tombé, l’éveil était donné. Enveloppée par l’ennemi, elle fut mise en pièce. Il y eut un grand nombre de morts, le reste fut fait prisonnier, fort peu s’échappèrent. Beaucoup de femmes, qui peut-être contribuèrent à la perte de la colonne en la rendant lourde et embarrassée, partagèrent le sort des époux qu’elles n’avaient pas voulu quitter ; plusieurs périrent au milieu du carnage, d’autres furent jetées dans les prisons de la ville. Je vis plus tard un enfant d’un an, qui, porté par sa bonne à la suite de madame de Combelle, sa mère, avait reçu à cette journée meurtrière un coup de sabre qui lui partageait la figure. (p. I-107)
L’expérience de la mort quotidienne à laquelle on s’habitue est également présente dans le texte d’Alexandrine des Écherolles. Elle montre progressivement l’endurcissement de la jeune fille, de la curiosité excitée à l’indifférence pour sa propre vie et celle des autres. Un épisode lui paraît à cet égard emblématique de l’état d’esprit dans lequel se trouvaient les assiégé·es au bout de deux mois :
[…] En rentrant à notre hôtel, je faillis périr d’un éclat de bombe ; je l’entends siffler, je me baisse ; il frappe la muraille à l’endroit où j’étais appuyée, tout cela fut rapide comme la pensée. Ce genre de péril se renouvelait à chaque minute, et finissait par inspirer une insouciance du danger qui ne peut s’expliquer que par la faculté donnée à l’homme de s’habituer à tout. Nous sortions malgré ces dangers continuels, et je me rappelle qu’étant un jour chez madame Posuel de Verno, qui demeurait dans une des façades de Bellecourt, on vint lui dire qu’une bombe venait de mettre le feu à une maison voisine qui lui appartenait. — Y a-t-il du monde pour l’éteindre ? — Oui, Madame. — C’est bon... — Et, se retournant vers nous, elle continua la conversation. On apprenait à toute minute la mort de ses connaissances, emportées à droite ou à gauche par les bombes et leurs éclats. On était dans un tourbillon, dans un cercle d’accidents si pressés, si hâtés, qu’on vivait à la minute, sans avoir le temps de réfléchir. La mort ravageait à côté de vous, sous vos yeux ; elle planait sur vos têtes ; on sentait sa pression, on la voyait venir, et l’on ne cherchait point à l’éviter, se laissant aller au temps tel qu’il était. (p. I-109-I-110)
Le retour à la vie normale est signifié du point de vue de la jeune fille qui, ayant trouvé un abri pour la nuit du 8 octobre dans le logement du gardien de l’Arsenal, voit passer, le matin, sous sa fenêtre, un « objet nouveau » : « un homme poussant une brouette chargée de beurre et de volailles » (p. I-111). La description du quotidien, dans l’ordinaire qui revient par les victuailles comme dans l’indifférence à l’horreur, est l’un des apports irremplaçables du récit du siège par l’autrice.
Ainsi pour elle, nulle scène de violence pour clore le siège, nulle apothéose d’un combat perdu, ou du spectacle des troupes fuyant devant l’ennemi. Un homme qui passe avec sa brouette, le centre de la ville qui ne s’était encore aperçu de rien, ni de la chute des uns ni de la victoire des autres, l’ordre et la tranquillité et pourtant, conclut-elle, la « force » qui l’emporte « sur la justice » (p. I-112).
La répression
Comme le rappelle Michel Biard, « Lyon risque peu en ce début d’automne d’avoir droit à quelque indulgence 233 » de la part de la Convention : l’été 1793 est celui pendant lequel les « Vendéens » ont bousculé les forces envoyées contre eux tandis que les armées de la République sont en difficulté sur tous les fronts extérieurs. En outre, la crainte d’une jonction des forces « fédéralistes » entre Marseille et Lyon, précise l’historien, a fait craindre le pire.
Par décret du 12 octobre, une commission extraordinaire de cinq membres est constituée pour juger militairement les contre-révolutionnaires, et décide en son article 3 que
[l]a ville de Lyon sera détruite. Tout ce qui fut habité par le riche sera démoli. Il ne restera que la maison du pauvre, les habitations des patriotes égorgés ou proscrits, les édifices spécialement employés à l’industrie, et les monuments consacrés à l’humanité et à l’instruction publique 234 .
L’article 4 précise : « Le nom de Lyon sera effacé du tableau des villes de la République. » « La réunion des maisons conservées portera désormais le nom de “Ville affranchie” ». Et l’article 5 prévoit que sera élevée, sur les ruines de Lyon, une colonne qui attestera « à la postérité les crimes et la punition des royalistes de cette ville », avec cette inscription :
Lyon fit la guerre à la Liberté ;
Lyon n’est plus.
Le dix-huitième jour du premier mois,
L’an deuxième de la République française,
Une et indivisible.
Lyon ayant été identifiée comme un « repaire de contre-révolutionnaires », la justice pourra être rendue « révolutionnairement », sans procès autre qu’expéditif et avec deux solutions : l’acquittement ou la mort, « les peines de détention étant en nombre restreint » 235 .
Une commission militaire avait un statut bien défini depuis le décret du 9 octobre 1792 236 : elle devait se borner au constat d’identité et à l’examen des faits constitutifs du « crime ».
Outre la Commission militaire, deux autres commissions sont mises en place pour juger les « contre-révolutionnaires » : la Commission de justice populaire et la Commission temporaire.
La Commission militaire
La Commission militaire a siégé pendant l’été 1793 au camp des assiégeants pour juger les Lyonnais·es pris·es les armes à la main. Le 8 octobre, cette commission, dite Commission militaire de Commune-Affranchie, autorisée par Couthon, vient siéger au Palais 237 . Elle officie jusqu’au 28 novembre, tient une trentaine de séances, et juge 176 personnes dont 106 seront condamnées à mort. Les premières condamnations ne dépassent pas trois par jour. Le plus souvent, les condamnations sont individuelles. On trouve, sur ces listes, Charles-Gaspard de Clermont-Tonnerre, le 27 vendémiaire (13 octobre 1793) ; Jean-Jacques Milanais, le 7 brumaire (28 octobre), Cudel Montcolomb, le neveu du général de Précy, le 12 brumaire (2 novembre). Au bout d’un mois, le 21 brumaire (11 novembre), quatre personnes sont condamnées 238 . Le 25 brumaire (15 novembre), ce sont 13 hommes qui sont exécutés, et dans les jours qui suivent, on ne descend plus en dessous du nombre de dix, jusqu’au 8 frimaire (28 novembre) inclus. Les jugements de cette commission s’arrêtent ce jour-là : elle aura condamné en tout et pour tout une centaine de personnes 239 .
La Commission de justice populaire 240
La Commission de Justice populaire, créée le 11 octobre par un arrêté de Couthon et Maignet, est présidée par Dorfeuille. Elle est divisée en deux sections, l’une siégeant à Feurs et l’autre au prétoire de la prison de Roanne : elle tiendra 27 séances jusqu’au 10 frimaire (30 novembre), jugera 149 personnes, en condamnera 104 à mort 241 . Cette commission ne commandite aucune fusillade, contrairement à la première. On peut ajouter qu’elle ne condamne aucune femme, contrairement à celle qui suivra, et, au total, un nombre limité de personnes au regard de l’hécatombe que mettra en place la suivante 242 . Mais, elle est pourtant considérée comme la plus sévère : elle prononce, dans 75,3% des cas, une condamnation à mort 243 . Couthon, qui la préside, constatant que, malgré cette répression, l’esprit public était perdu dans cette « malheureuse cité », que les patriotes y étaient « dans une minorité si effrayante 244 », écrit à la Convention qu’il lui faut quarante hommes républicains pour leur confier les fonctions administratives et judiciaires qu’on ne pouvait donner à des Lyonnais. Quarante membres du Club des Jacobins ont ainsi pris la route de Lyon pour former l’esprit public de « Commune-Affranchie ».
La Commission temporaire ou Commission révolutionnaire
À la fin du mois d’octobre, Fouché et Collot d’Herbois sont envoyés sur place pour « régénérer » la ville. Ils créent, le 20 brumaire (10 novembre), la Commission de surveillance républicaine, qui à son tour forme ce qu’on a appelé la Commission temporaire. Elle est présidée par Marino, dont l’autrice parle assez souvent dans son texte. Le 7 frimaire (27 novembre), une « Commission révolutionnaire » de cinq membres est établie, avec à sa tête Parein. On la connaît aussi sous le nom de « Tribunal des sept ». C’est elle qui fait traduire les prisonniers pour y subir un dernier interrogatoire et, comme l’explique Michel Biard, « à l’issue de celui-ci deux sentences principales s’offrent au choix des juges, souvent annoncées d’un simple geste signifiant l’une ou l’autre : les détenus reconnus innocents sont immédiatement élargis, les coupables condamnés à la peine capitale 245 ». Cette commission siège tous les jours dans la salle du Consulat de l’Hôtel de Ville. La Commission révolutionnaire condamne à mort, le 14 frimaire (4 décembre), 60 hommes. Suivent des jugements et des condamnations presque tous les jours, dont, le lendemain 15 frimaire, 208 rebelles condamnés à mort par fusillade. Chaque jour, note Michel Biard, « plusieurs dizaines de condamnés sont individuellement passés par les armes aux Brotteaux ou guillotinés à Bellecour ou aux Terreaux […] le plus souvent entre 20 et 40 mises à mort quotidiennes. Rien qu’en frimaire, quelque 580 prisonniers sont exécutés 246 ».
La première femme condamnée est Marie Lolière, le 23 frimaire (13 décembre). Elle inaugure une série de condamnations de femmes qui va croissant : le 28 frimaire (18 décembre), ce sont deux femmes qui sont guillotinées ; le 2 nivôse (22 décembre), une femme ; le 4 nivôse (24 décembre) une femme, Marie Adrian ; le 8 nivôse (28 décembre), une femme ; le 25 nivôse (14 janvier), une femme ; le 14 pluviôse (3 janvier 1794), une femme ; le 18 pluviôse (6 février), une femme ; et le, 22 pluviôse (10 février), douze femmes dont la tante d’Alexandrine Giraud. Suivent une femme le 29 pluviôse (17 février), deux le 6 ventôse (24 février), trois le 9 ventôse (27 février), une le 24 ventôse (14 mars), deux le 2 germinal (22 mars), cinq le 3 germinal (23 mars) et six le 16 germinal (5 avril) 247 . Au total, quarante-et-une femmes sont condamnées à mort pendant cette période par cette seule commission, 3 en frimaire, 4 en nivôse, 15 en pluviôse, 6 en ventôse et 13 en germinal 248 .
C’est cette commission qui inaugure une méthode particulièrement barbare, qui détone même au regard de la tradition des fusillades : un arrêté du 3 frimaire (23 novembre) précise que les condamnés seront « Tous enchaînés et placés en plusieurs lignes, sur lesquelles un nombre déterminé de canons chargés à mitraille sera tiré, et à quelque distance desquelles seront placés des pelotons de républicains pour fusiller de suite ceux qui survivront à la décharge du canon 249 ».
Des femmes se sont indignées et ont été 10 000 à signer une pétition pour obtenir la grâce des condamné·es. Une manifestation s’est rendue près de la maison où résident les représentants du peuple en mission ; bien en vain : le rassemblement a été dispersé, quelques femmes ont été arrêtées et exposées devant la guillotine 250 .
Cette commission condamne 90% des 1900 condamné·es à mort de la période, d’après les chiffres de Takushi Koï.
Melville Glover décrit la salle qui accueille le tribunal, la disposition des meubles, le temps consacré à chaque interrogatoire :
[…] Le plafond peint par Blanchet était orné d’amours et de grâces dont les joyeux ébats contrastaient singulièrement avec la triste scène dont ils étaient les témoins muets. La salle était partagée par une longue table sur laquelle on comptait huit flambeaux. D’un côté, étaient assis les redoutables juges vêtus d’un uniforme militaire avec épaulettes ; une poignée de sabre en acier poli étincelait à leur côté, et un ruban tricolore portait suspendue à leur cou une petite hache très-brillante. Le greffier Berlié était assis à l’une des extrémités où il fut bientôt remplacé par Bréchet. Le secrétaire Larné avait sa place à une petite table en face des juges, et la salle entière était entourée d’une barrière à hauteur d’appui, contenant le public qui n’était ordinairement composé que de soldats de l’armée révolutionnaire ou de patriotes éprouvés.
Les accusés, renfermés dans une salle voisine, étaient appelés par groupes de deux ou trois, et venaient, dans le vestibule de la salle consulaire, attendre qu’on les introduisît. On les faisait asseoir sur un petit banc scellé dans le mur ; mais le stationnement n’était pas long ; car on a calculé qu’en moyenne, chaque quart-d’heure, on jugeait sept prisonniers et parfois plus 251 .
Deux caves formaient les prisons dans lesquelles les personnes interrogées étaient conduites : celle destinée aux mises en liberté était occupée par le corps-de-garde, l’autre formait l’angle de la place des Terreaux et de la rue Lafon (voir sur la carte ci-dessous, le cercle bleu), et actuelle rue Joseph Serlin.
La guillotine est placée à l’entrée de la rue de la Cage, à 25 mètres de la rue Saint-Pierre, vers l’entrée actuelle, explique Glover, du passage des Terreaux (cercle rouge sur le plan ci-dessus) 252 . Les fusillades ont lieu aux Terreaux d’abord, « mais les balles pénétrant dans les fenêtres voisines et dans les caves 253 », le procédé fut abandonné. On utilise le canon aux Brotteaux, pour la première fois, le 4 novembre, ou les fusils. Les soldats sont chargés d’achever les blessés, ce qui manque provoquer une révolte un mois plus tard 254 . La dernière fusillade a lieu le 23 pluviôse (11 février 1794), à la suite de laquelle on n’utilise plus que la guillotine 255 . La commission siège pour la dernière fois le 17 germinal (6 avril), pour condamner le bourreau Jean Ripet et son aide, Jean Bernard, responsables de l’exécution de Joseph Chalier.
D’après les comptes établis par Melville Glover, il y a eu autant de condamnations à mort que de mises en liberté, à deux personnes près. Ajoutons que les femmes ont représenté une infime minorité, avec moins de 3% des condamné·es à mort. Selon Michel Biard, si seulement 3% des hommes qui ont comparu sont envoyés en captivité, c’est le cas d’un tiers des femmes ; un homme sur deux a été condamné à mort, et une femme sur cinq 256 . Deux déséquilibres qu’il n’explique pas.
Bien des mesures envisagées ne seront pas prises, dont celle qui aurait consisté à « licencier » les habitant·es de Lyon, à les « répandre avec précaution sur la surface de la République 257 », faute de pouvoir les républicaniser, et à les remplacer par d’autres. L’autre est celle qui avait envisagé de raser la ville : elle se traduira, malgré la volonté de Fouché et Collot d’Herbois d’accélérer les travaux, par la destruction des fortifications, dont la forteresse de Pierre-Scize, et des « bâtiments menaçants pour la sécurité publique 258 ». Au début de 1794, seulement une trentaine de maisons ont subi le décret de la Convention ; dans les années qui suivront, les crédits et la main d’œuvre réservés à la destruction serviront surtout à construire une route importante, détruire les remparts, et à opérer une vaste « opération d’urbanisme 259 » selon les mots de Michel Biard.
Le récit d’Alexandrine des Écherolles n’entre pas dans ces détails. Quelque temps après la reddition de la ville, en novembre 1793, Marie Anne Giraud, qui refuse de livrer son frère, est arrêtée et, après une nuit passée dans l’une des salles de sa section (du Change), est envoyée à la prison des Recluses (p. I-138-I-139). Elle fait partie de ces femmes qu’évoque plus haut l’historien Michel Biard, dix fois plus souvent envoyées en prison que les hommes, lesquels étaient soit libérés, soit condamnés. Par sa nièce, on découvre les conditions de vie de ces femmes, entassées par dizaines dans une seule pièce à l’atmosphère « fétide », sans moyen pour se chauffer qu’une « misérable chaufferette » (p. I-166) avec laquelle les femmes réchauffent aussi leurs aliments.
Son récit est suffisamment précis, pour qu’il ne soit pas nécessaire, ici, de le contextualiser davantage. On suit la jeune fille de 14 ans jusqu’au jugement de sa tante, et l’exécution de cette femme le 22 pluviôse an II (10 février 1794). Marie Anne Giraud fait partie du groupe le plus nombreux de femmes guillotinées en un seul jour : elles sont douze, avec un « ci-devant curé 260 ». Célibataire, elle fait aussi partie du fort contingent de femmes dont ce statut même est plus souvent en ligne de mire des tribunaux que celui de femme mariée 261 .
La Terreur blanche
Le 9 thermidor (27 juillet 1794) ne vient pas mettre un terme aux représailles et contre-représailles ouvertes par le siège et la répression des « contre-révolutionnaires ». L’an III ouvre une troisième période, celle de la chasse aux « Mathevons ». À cette chasse, la liste imprimée des dénonciateurs, dénonciatrices et dénoncé·es, publiée au printemps 1795 262 , ne viendra qu’apporter plus d’intensité : un « véritable bréviaire de la vengeance pour que le sang réponde au sang 263 », conclut Michel Biard.
Contexte administratif
Lyon et ses districts, cantons et sections
Le corps municipal est élu au suffrage censitaire ; il est composé d’un maire, d’un procureur de la commune, de vingt officiers municipaux et de 42 notables élus. La première élection a eu lieu le 7 février 1790, à la suite de la fuite du consul, Imbert-Colomès. Sont élus Vitet et Chalier. Le maire est Palerme de Savy, qui démissionne quelques mois plus tard, en décembre. Lui succède Louis Vitet, qui n’a la faveur ni du Département, ni des députés de la Constituante, mais qui est reconduit aux élections suivantes, un an plus tard (avec un taux de participation de moins de 20%).
Districts
Lyon est également le siège du district de Lyon-Ville, qui regroupe la ville et ses faubourgs (Vaise, Croix-Rousse, Guillotière) : il forme l’un des six districts du Département avec celui de Lyon-Campagne, de Villefranche, de Roanne, de Montbrison et de Saint-Étienne. Chaque district est constitué d’un conseil et d’un directoire, le premier de douze membres, le second de quatre membres, tous élus.
Sections
La ville est également divisée en sections 264 . Une affiche intitulée « Les sections de la ville de Lyon », adressée « Aux Habitants du Département & de toutes les Municipalités voisines » 265 , présente, à la suite d’un discours daté du 2 juin 1793, la liste de 34 sections :
| La Convention. | Duvigneau, Président ; Alex. Morel & Levasseur, Secretaires. |
| St.-Vincent 1re. | […] Rast, président ; Albert, vice-président ; Charvin & Perricaud, secretaires |
| Place Confort. | Goguillot, vice-président. |
| Le Change. | Denis Delorme, vice-président ; Roch, secretaire. |
| Rue Terraille. | Badger, vice-président ; Berliez, vice-secretaire. |
| Rue Thomassin. | Pitiot, président ; A. Moyer, secretaire. |
| Rue Belle-cordiere, ou la Réunion. | Dumarest, président. |
| La Juiverie. | Gounet, président ; Leroy, secretaire. |
| St.-George. | Parrin, vice-président. |
| Rue Neuve. | Milliet, faisant les fonctions de président ; Finielz, secretaire. |
| Rue Buisson. | Jacques Prat, président ; C. A. Lauriol, vice-secretaire. |
| Port-du-Temple. | Paganucci, président ; |
| Porte-Froc. | Montviol, vice-président. |
| Brutus. | Corset, président ; Chavance, secretaire-adjoint. |
| Guillaume Tell. | Vincent, vice-président ; Voron, secretaire-suppléant. |
| Rue Tupin. | Roux, vice-président ; Charbonnier, secretaire. |
| Bordeaux, ci-devant rue de l’Hôpital. | Maradan, vice-président ; Cornus, vice-secretaire. |
| Le Gourguillon. | Tranchant, vice-président ; J. Toulieux, secretaire. |
| La Fédération 1re. | Mongez, vice-président. |
| La Fédération 2me, ou Marseille. | Barou, vice-président. |
| La Croizette. | Dubost, président ; Gulliard, secretaire. |
| St.-Vincent 2me, ou de Scevola. | Glas, président ; Genet-Bronze, secretaire. |
| La Grande-Côte 1re. | F. Carret, vice-président ; Chasseriau, secretaire. |
| La Grande-Côte 2me. | J. M. Gaujelin, vice-président ; Gayet cadet, secretaire-adjoint. |
| La Concorde, ci-devant Port St.-Paul. | Billet, président ; Mondet, secretaire. |
| Bon-Rencontre. | Louis Boisson, président ; Revol, président du Comité de surveillance ; Rochette, secretaire. |
| Place Neuve. | Riviere, vice-président ; Chartre, secretaire. |
| L’Egalité. | Jean Gilibert ainé, vice-président ; Duport le jeune, secretaire. |
| La Liberté. | Courvoisier, vice-président ; Estanstant, secretaire. |
| Pierre-Scize. | Fichet ainé, président ; Vincent, secretaire. |
| Thionville, ci-devant Plat-d’argent. | F. Ray, vice-président ; Polingue, vice-secretaire. |
| Rousseau. | Caminet, vice-président. |
| La Guillotiere 1re. | Feuillet, président. |
| La Guillotiere 2me. | Henri Moreau, secretaire. |
Sociétés populaires
Les sociétés populaires sont au nombre de 31, qui à elles toutes comptent plusieurs milliers d’adhérents, d’après le compte établi soigneusement par l’historien japonais Takashi Koï 266 .
Le département de Rhône-et-Loire
La loi du 14 septembre 1789 a créé les communes. Le 15 janvier 1790 est créé le département de Rhône-et-Loire, dont Lyon devient la capitale.
Le Département est administré par un conseil de 36 membres élus, et un directoire de huit hommes désignés.

AML, 2S/26.
De multiples tensions entre administrations municipales et départementales vont jouer un rôle important dans les événements révolutionnaires.
Côté Municipalité, quand Imbert-Colomès émigre, en février 1790, les élections mettent en présence Roland de la Platière, Vitet, Chalier, mais c’est un autre qui l’emporte : Palerme de Savy, qui devient premier maire de Lyon. Celui-ci démissionne en décembre, il sera remplacé par des proches de Roland : Vitet, puis Nivière-Chol.
Côté Département, il est dominé par le négoce et les propriétaires fonciers, ou des royalistes constitutionnels. L’élection de maires proches de Roland, patriotes et révolutionnaires convaincus, ouvre une ère d’affrontements avec le Département. Chalier, que le directoire avait suspendu en raison de visites domiciliaires répétées qui avaient provoqué des plaintes, se rend à Paris, en revient triomphalement (et passe sous les yeux d’Alexandrine Giraud au niveau de Roanne, p. I-42), et devient président du tribunal de district en août 1792 : ses partisans intègrent la municipalité. Nivière-Chol lance souscription de 3 millions de livres auprès des citoyens les plus fortunés, poussant la bourgeoisie à se rallier aux éléments royalistes.
Les lieux d’habitation, les trajets entre l’Allier, le Rhône et la Nièvre
Alexandrine Giraud
Moulins
La famille Giraud des Écherolles vit sur le boulevard Choisy (nom de 1936), dans un « hôtel étroit, qui appartient depuis quelques années à M. Etienne Thonier : c’est l’ancien hôtel Giraud des Écherolles, où siégea, en 1793, le Comité révolutionnaire et où logea Fouché 267 . »
Les auteurs des Fiefs du Bourbonnais précisent que « [l]e port de la Corde devait se trouver au pied même de l’escarpement que dominent les Echerolles et un peu en amont, entre cette hauteur et une ancienne île garnie de peupliers que la rivière, en se rejetant vers l’Ouest, a laissée sur sa rive droite » : « La vieille maison des Echerolles se composait, d’après des gravures du temps, d’un simple rez-de-chaussée, flanqué de deux pavillons, le tout en briques appareillées et construit vraisemblablement durant les dernières années du règne de Louis XIII. Cette ancienne habitation a disparu pour faire place à une confortable demeure édifiée par M. Eugène Collas sur les plans de M. Dadole, […] et il n’en reste qu’une aile des dépendances et une chapelle qui date, sans doute, de l’érection en fief de la terre des Echerolles 268 . »
Lyon et Vaise
Jusqu’au 9 septembre 1792, la famille loge à Vaise, chez femme Seriziat. Il nous a été impossible de situer précisément le logement de Mme Seriziat. On sait que la famille de l’autrice entend distinctement les cris de la foule qui s’empare du « Château de Pierrescise » : elle est donc logée à portée d’oreille, ce qui reste un indice assez flou dans la mesure où la réception du son dépend de sa force.

AML, 1S/103.
On fait l’hypothèse que le logis de Mme Seriziat se trouve du côté du Port de l’Observance, sur les quais de Saône, ou du quartier du Greillon, dans les hauteurs de Vaise.
Au lendemain du massacre des officiers du Royal-Pologne de Pierre Scize, la famille est chassée par la propriétaire des lieux, qui craint de devenir une cible facile si elle continue de loger des aristocrates et des étrangers. Si elle est convaincue que les Marseillais vont passer devant chez elle en remontant vers Paris, c’est qu’elle se situe plutôt sur les quais qui mènent directement à cette route de Paris par le Bourbonnais.
Mme Noailly loge la famille dans une « petite maison de campagne » que son père possède « à une demi-lieue » (p. I-59). Sur la carte du « canton de Vaise », on peut mesurer que la demi-lieue, depuis le Port de l’Observance, dirige vers le chemin de Gorge-de-Loup devant la Pépinière royale. Peut-être la maison est-elle située vers le « Moulin à blé » et le ruisseau de Charavay ? La famille loge sur une « petite colline » (p. I-61), qui fait penser qu’elle est bien sur les contreforts de Gorge-de-Loup.

AML, 3S/118.
Échelle : 10 cm – 10 toises, soit environ 200 m. Une demi-lieue (800 m) représente donc environ 400 toises, soit approximativement le rayon du cercle bleu.
La famille se dirige ensuite dans une auberge de Vaise tenue par le père de Mme Noailly, M. Robin.
La nuit suivante est passée chez M. Coste (p. I-[65]), et la quatrième chez M. Mazuyer, à l’ancien Hôtel des Douanes (p. I-66), qui se situait au sud de la rue de Langile, longée au sud par la rue de Flandre, et la rue de la Saônerie 269 .
C’est là que la famille s’installe pour un an, jusqu’à la fin du mois d’août 1793. On apprend par un Certificat de résidence 270 que cet immeuble appartenait au citoyen Benoît, et qu’il se situait au numéro 67 de la « place de la cy devant douane » ; on sait également, par le récit d’Alexandrine des Écherolles, que leur appartement est situé dans le même bâtiment que celui de Mme Souligné (p. I-126).
Dès le 24 août 1793, lendemain de l’explosion de l’Arsenal, la famille va loger dans le quartier de Sainte-Foy, tout près de la porte Saint-Irénée (p. I-92). Il nous a été impossible de préciser davantage le lieu de leur habitation. On sait simplement que la famille partage le logis avec la famille Seriziat, qui loue sans doute elle aussi, ce qui rend encore plus difficile la recherche de ce lieu. La famille y reste jusqu’au soir de la bataille du 29 septembre 1793, et revient dans son ancien logement (p. I-106). Pour peu de temps, puisque, un peu avant la chute de Lyon, le père choisit de mettre sa famille à l’abri « à l’ancien hôtel de Provence, près de la place Bellecour », une maison « qui touchait à l’hôtel de la Charité » (p. I-108).
Cet Hôtel de Provence était situé place de la Charité, qui débute à l’angle sud-est de la place de Bellecour : il appartenait à l’hôpital de la Charité, dans les bâtiments duquel il était situé. Il s’agit peut-être du rectangle foncé sur la partie nord-ouest du schéma qui figure l’hôpital sur la carte de Lyon ci-dessus, rectangle foncé indiqué par un cercle bleu.
Au soir du 8 octobre 1793, la famille s’installe chez le garde de l’Arsenal, à l’invitation de son épouse, en l’absence du garde parti rejoindre M. Guériot à Grenoble : il s’agit de l’un des trois pavillons de l’Arsenal « échappés à l’incendie » (p. I-111) qui s’est propagé à la suite de son explosion (p. I-90). On identifie bien, sur le plan de 1789, la rue de l’Arsenal dans laquelle devait se trouver ce pavillon.
On voit, sur la carte, que la distance parcourue par Alexandrine avec Cantat, envoyées par le père récupérer des papiers importants est, comme le dit l’autrice, « petite » (p. I-114). On peut imaginer son parcours : même si, dans le dédale des rues du quartier d’Ainay, bien d’autres itinéraires étaient possibles, elle avait plus ou moins 600 mètres à parcourir. Ce n’en était pas moins un parcours au milieu des assiégeants vainqueurs qui montre assez la confiance que son père avait en elle, le courage auquel les circonstances l’obligent, et l’endurcissement qu’elle acquiert par l’expérience du siège et de ses suites.
Au retour de M. Gueriot, il est décidé d’exfiltrer Giraud : « quittant aussitôt l’Arsenal, nous nous rendîmes dans notre premier logement, sur la place de l’Ancienne-Douane », écrit l’autrice (p. I-116).
Après la perquisition qui suit sa dénonciation, la famille s’installe chez Mme Tournouer, sur le quai de Saône, dans une maison qui est plus qu’une auberge, et moins qu’un traiteur : « Sa maison était située, à la porte de la ville, sur le bord de la Saône, près du faubourg de Vaise. Ce n’était pas un vrai traiteur, mais c’était plus qu’un cabaret. » (p. I-127-I-128) Il nous a été impossible de localiser ce lieu.
De là, Giraud est emmené par une batelière de l’autre côté de la porte du Lion, faubourg de Vaise. Il n’y reste pas longtemps : une voisine l’ayant entendu marcher au-dessus de son appartement, il doit repartir en arrière un jour où la porte du Lion était libre, et va loger au couvent des Deux-Amants (p. I-131). Il y reste trois jours, puis se rend chez Mme de la Coste, dans une maison de campagne à « quelque distance de Lyon » (p. I-132), peut-être vers Cailloux-sur-Fontaine 271 .
L’autrice ne le mentionne pas, mais on comprend qu’elle, sa tante et les deux domestiques, « Saint-Jean » alias Marigny et Cantat, logent à nouveau place de la Douane, puisque les scellés sont mis sur l’appartement de Mme Giraud, et que la famille doit apprendre à vivre avec un gardien des scellés, M. Forêt (p. I-136).
Bessaÿ
Selon une attestation retrouvée dans son dossier d’émigration, Alexandrine Giraud réside à Bessaÿ du 19 ventôse an II (9 mars 1794) au 22 fructidor an II (8 septembre 1794), puis du 30 prairial an III (18 juin 1795) au 15 brumaire an IV (6 novembre 1795), puis de nouveau du 29 ventôse an IV (19 mars 1796) au 19 prairial an IV (7 juin 1796) 272 . Bessaÿ, dont le nom est aujourd’hui graphié Bessay, faisait partie des terres appartenant à la famille des Écherolles 273 . Outre son emplacement, matérialisé sur la carte ci-dessous, on a également distingué Saint-Loup et Saint-Gérand-de-Vaux, lieux de baptême et/ou d’inhumation de la famille. On a aussi identifié l’emplacement du château des Écherolles par un cercle rouge.
À l’Ombre, chez Mlle Melon
La terre dite de l’Ombre se situe sur la commune de Thaix, dans la Nièvre. Il subsiste un lieu-dit « château de l’ombre », lieu aujourd’hui assez isolé, à une cinquantaine de kilomètres dans la campagne de Nevers. Alexandrine Giraud y séjourne du 25 fructidor an II (11 septembre 1794) jusqu’au 22 prairial an III (10 juin 1795) 274 . On distingue, sous le disque bleu, l’emplacement du bourg de « Tais » :

AN, CP/NN//*/5.
Lurcy
Alexandrine Giraud réside à Saint-Germain-en-Viry [ou Very], chez Catherine Roy, à Lurcy-sur-Abron, du 30 prairial an IV (18 juin 1795) au 10 nivôse an V (30 décembre 1796) 276 . On a localisé le bourg de Saint-Germain-en-Very (aujourd’hui Saint-Germain-Chassenay) et le village de Lurcy-sur-Abron sous le disque bleu :
Giraud des Écherolles
On trouvera ci-dessous la localisation des villes et bourgades dans lesquelles ont séjourné Alexandrine (en bleu) et son père (en orange) :

BnF, département Cartes et plans, GE C-1985.
En 1797, Giraud vit à Vaise (p. II-89) 278 soit chez Marcellin Fellot, juge de paix à Neuville, plus probablement chez son fils Joseph Louis, notaire à Vaise. On trouve, sur l’Indicateur de Lyon de 1810, son adresse indiquée comme suit : « faubourg de vaize, n. 20 279 ». Joseph Louis Fellot meurt en 1837 au logis dit du Chapeau Rouge 280 , que nous avons indiqué par un ovale bleu sur la carte ci-dessous :

AML, 1S/103.
À une date indéterminée, entre 1797 et 1804, Giraud revient à Lyon et s’installe chez son tailleur, M. Lemaire (p. II-138). Ce dernier habite « place du petit Change N o . 74 » 281 , sans doute la place du Change (identifiée par un cercle bleu sur le plan ci-dessous) :
En 1804, Giraud vit au numéro 58 de la rue Saint-Pierre 282 (actuelle rue Chenavard). La rue est identifiée par un ovale bleu sur le plan ci-dessous :
En 1810, il réside au numéro 154 de la rue Saint-Joseph (actuelle rue Auguste Comte) 283 , sans que l’on sache avec certitude s’il y vit avec ou sans son épouse Catherine Cirlot. La rue Saint-Joseph est identifiée par un ovale bleu sur le plan ci-dessous :
En 1821, la veuve Giraud des Écherolles, « rentière et propriétaire », habite au numéro 3 de la rue de Puzy (dans le prolongement, en direction de la place Carnot, de la rue Saint-Joseph) 284 . Elle est identifiée, sur la carte ci-dessous, par un ovale bleu :

BnF, département Cartes et plans, GE C-2337.
Chronologie du récit
Les Mémoires d’Alexandrine Giraud relatent les événements et déplacements qui ont marqué, comme l’indique leur titre, « quelques années » de sa « vie », entre 1790 et 1807, date de son installation en Allemagne où elle réside jusqu’à la première publication de son texte, en 1843. Bien que le récit comporte quelques anticipations, le plus souvent signalées, son fil narratif est strictement chronologique, conformément aux attendus génériques de ce type de texte. La matière narrative n’est cependant pas traitée selon un rythme uniforme, les épisodes relatifs aux années passées à Lyon, pendant et après l’épisode du siège de 1793, étant significativement plus développés.
Pour rendre compte du chronotope de ce récit, nous avons relevé les indices temporels et spatiaux qui permettent d’en identifier les étapes. Nous avons également fait figurer entre crochets les dates que nous avons pu restituer à partir des allusions ou références : la mention « n. », après le numéro de la page, indique que l’information se trouve dans l’annotation du texte. Soit approximations ou défauts de mémoire de l’autrice, soit incertitudes de la documentation, on constate parfois des divergences entre les repères fournis par l’autrice et ceux que nos recherches nous ont permis de déduire : nous les avons signalées comme telles. Parmi les éléments externes sur lesquels nous avons pris appui, on peut souligner l’importance de la lettre de François Sébastien Tarade « aux citoyens composans L’administration centrale Du Dep[artemen]t de L’allier », du 12 messidor an VI (30 juin 1798), précédemment évoquée à plusieurs reprises dans le présent dossier, qui, alors qu’elle s’apprête à « procéder à La Liquidation des enfans giraud Desecheolles pour Leurs droits sur Les biens De leur mere », fournit « six certificats suivant Les formes vouluës par les loix de [l]a Résidence [d’Alexandrine Giraud] en france sans interruption » et dresse la liste chronologique des endroits où elle se trouvait entre août 1792 et fin décembre 1796 286 .
Le tableau ci-dessous comporte trois colonnes : à gauche, les pages du texte ou de son annotation qui comportent l’indication temporelle ou géographique fournie dans la colonne centrale ; la colonne de droite précise la nature de l’événement concerné.
1790
| p. I-11, n. |
Moulins
[printemps] |
Journée des brigands |
| p. I-13 | [juillet] | Fête de la Fédération ; journée du Champ-de-Mars à Paris ; retour à Moulins de la délégation du département de l’Allier |
| p. I-15 | Démission de Giraud des Écherolles de sa fonction de commandant de la garde nationale de Moulins |
1792
| p. I-17 | [5 avril] | « Jeudi de la Passion » : première communion d’Alexandrine Giraud : elle a « onze ans » (p. I-18) |
| p. I-20 et n. | [23] juin | Mandat d’arrêt contre Giraud des Écherolles |
| p. I-35 | « les premiers jours d’août » | |
| p. I-35, n. | [8 août] | Mise en liberté de Giraud des Écherolles ; la municipalité de Moulins lui délivre un passeport pour Lyon le 10 août |
| p. I-[39] | [10 août] | Départ pour Lyon selon la lettre de F. S. Tarade. Mention des événements du « 10 août » à Paris (p. I-42). Ce départ a lieu « dix-huit mois » avant le retour d’Alexandrine Giraud sur place (p. II-4 et II-15), en mai 1794 (p. II-[1]) |
| p. I-41 | Roanne | |
| p. I-43 et n. |
Lyon
[22 août] |
Arrivée à Lyon selon la lettre de F. S. Tarade. Installation à l’Hôtel de Milan, puis à Vaise « depuis le commencement du mois d’août » (p. II-75) |
| p. I-47 | 9 septembre | Massacre des prisonniers de Pierre-Scize. L’autrice a précédemment évoqué les massacres de septembre à Paris (p. I-30) |
| p. I-63, n. | [septembre] | Prise de Chambéry par les Français |
1793
| p. I-67 | janvier | Mort du roi |
| p. I-70 | 29 mai | |
| p. I-73 | 16 juillet | Exécution de Chalier |
| p. I-87 | 8/9 août | Début des bombardements au cours du siège de Lyon |
| p. I-100 | 29 septembre | |
| p. I-111 | 9 octobre | |
| p. I-119, n. | [6-12 octobre] | Rappel de Dubois-Crancé à la Convention |
| p. I-127 | fin octobre | |
| p. I-139 | novembre | Arrestation de Marie Anne Giraud, tante d’Alexandrine |
| p. I-192, n. | [2 décembre] | Décès de « Mlle de Sauriac » |
| p. I-[245] | [31 décembre] | Exécution de 32 citoyens de Moulins ; voir aussi p. I-313 |
1794
| p. I-274 | [10 février] | Exécution de Marie Anne Giraud ; voir aussi p. I-320 |
| p. I-308, n. | [2 mars] | Départ pour les Écherolles |
| p. II-[1], n. |
Bessay
[9 mars] |
L’autrice écrit cependant qu’« on touchait au mois de mai » |
| p. II-6, n. | [23 mars] | Interrogatoire d’Alexandrine Giraud par Cartier, membre du Comité révolutionnaire de Moulins |
| p. II-19 | [27 juillet] | Mort de Robespierre |
| p. II-24, n. | [5-22 septembre] | Examen, par le Comité révolutionnaire de Moulins, de la demande de départ d’Alexandrine Giraud chez sa grand-tante Mlle Melon : son « transfert dans la commune de Taix » est finalement autorisé (p. II-25) |
| p. II-29 et n. |
Thaix
[11 septembre] |
Arrivée dans le domaine de l’Ombre, selon la lettre de F. S. Tarade |
| p. II-34, n. | [21 novembre] | Alexandrine Giraud se trouve auprès de Mlle Melon |
| p. II-51 | « décembre » | « un mois » chez Mme Grimauld, à une cinquantaine de kilomètres de l’Ombre |
1795
| p. II-59 | 17 janvier | Fête de Mlle Melon |
| p. II-65 | « printemps » | |
| p. II-66 et n. | [10 juin] | Départ d’Alexandrine Giraud et de son père, selon la lettre de F. S. Tarade |
| p. II-68 et n. |
Bessay
[juillet] |
Giraud des Écherolles rentre dans ses biens |
| p. II-70 et n. | [6 novembre] | Départ d’Alexandrine Giraud et de son père, selon la lettre de F. S. Tarade |
| p. II-74 et n. |
Lyon
[10 novembre] |
Arrivée à Lyon après les massacres dans les prisons du mois de mai |
1796
| p. II-76 et n. | [janvier] | Mort de M. Guichard |
| p. II-83 et n. | [4 mars] | Départ d’Alexandrine Giraud pour les Écherolles, selon la lettre de F. S. Tarade |
| p. II-87 et n. |
Bessay
[21 juin] |
Mort d’Odille Giraud. Alexandrine se rend à Lurcy chez Mme Grimauld. Selon la lettre de F. S. Tarade, départ pour Saint-Germain-Chassenay dès le 7 juin et arrivée le 18 juin |
| p. II-89 et n. |
Lurcy
[30 décembre] |
Selon la lettre de F. S. Tarade, Alexandrine Giraud quitte Saint-Germain-Chassenay : elle a passé « quelque temps » (p. II-87) sur place |
1797
| p. II-89 | Moulins | |
| p. II-89 | Lyon | Alexandrine Giraud rejoint son père à Vaise |
| p. II-91 et n. | [4 septembre] | Décret du « 18 fructidor » an V |
| p. II-92 | Départ d’Alexandrine Giraud pour les Écherolles | |
| p. II-96 | Aux Écherolles | |
| p. II-97 | Lurcy | |
| p. II-102 | Thaix |
1798
| p. II-118-II-119 et n. | Mort de Mme Grimauld. Alexandrine Giraud a « dix-huit ans » (p. II-123). Elle quitte l’Ombre (p. II-126) | |
| p. II-127 | Nevers | |
| p. II-129 | Mort de Joséphine Grimauld | |
| p. II-129 | Au Battoué |
1799
| p. II-129 et n. | [11 juillet] | Loi des otages |
| p. II-133, var. 1897 | 13 décembre | Retour de Bonaparte, après le coup d’État du 18 Brumaire (9 novembre 1799) |
| p. II-133 | Moulins | |
| p. II-139 | Noël |
1800
| p. II-140 | Genève | Chambolle à Genève à partir du 15 floréal an VIII (5 mai 1800) |
1800 ou 1801
| p. II-142 |
Au Battoué
« printemps » |
|
| p. II-150 | « vers l’automne » | |
| p. II-154 | Auxonne |
1801
| p. II-155 | « hiver » | Expédition à Saint-Domingue (p. II-153 et n.) |
1802
| p. II-181 et n. | [2 novembre] | Décès de Sophie Françoise Pélagie Janon de Souligné |
1802 ou 1803
| p. II-155 | « printemps » | Radiation de Giraud des Écherolles de la liste des émigrés |
1803
| p. II-162 et n. | [août] | Brevet pour les vélocifères |
| p. II-163 | « bien des mois s’écoulèrent » |
1804
| p. II-165 | Giraud des Écherolles a 74 ans | |
| p. II-166 et n. | [5 mars] | Remariage de Giraud des Écherolles avec Mlle Cirlot |
| p. II-167 | Lyon | |
| p. II-172 | Moulins | |
| p. [II-177] et n. |
Paris
[juin] |
Guerre entre la Russie et l’empire perse |
1804 ou 1805
| p. II-181 | « automne » |
1806
| p. II-182, n. | [8 septembre] | Entrée d’Alexandrine Giraud à la garde de « Mlle d’A… » |
1807
| p. II-214, n. 1 |
Louisbourg
10 mai |
Arrivée d’Alexandrine Giraud à Louisbourg |
1842
| Épître dédicatoire, I-n.p. | Kirchheim-Unter-Teck |
Annexe : condamnations à mort des femmes par la Commission révolutionnaire de Lyon
Marie-Anne Giraud fait partie des quarante-et-une femmes qui, d’après nos recherches dans les imprimés et les manuscrits, ont été condamnées à être guillotinées par la Commission révolutionnaire de Lyon. On trouvera ci-dessous quelques informations sur chacune d’entre elles empruntées à deux sources, au sein de courtes notices disposées de la manière suivante : d’une part, le titre, dont nous avons conservé la graphie, qui a été donné au jugement dans lequel leur nom apparaît, d’après le recueil manuscrit conservé dans les fonds des Archives départementales du Rhône (ADR, 42L27) ; d’autre part, les indications fournies dans l’imprimé intitulé Liste générale des contre-révolutionnaires mis à mort à Commune-affranchie, publié en 1794 287 . Lorsque plusieurs femmes sont concernées par un même jugement, leurs notices se succèdent dans l’ordre dans lequel elles figurent sur le document manuscrit de ce jugement.
23 frimaire, jugement de la Commission Révolutionnaire […] contre la Nommé loliere femme Cochet qui a été guillotiné, no 11
« Loliere, (Marie) femme de Sebastien Cochet, de 27 ans, native de Beaujeu, dem[eurant] à Lyon place Grenouille ; papetiere. » (p. 75)
28 frimaire, jugement de la Commission Révolutionnaire […] Contre 50. Rebels a la loi dont 42 ont été fusiliers, 8. guillotinés dont 2 femme, no 16
- « Pontaut, (Marguerite) de 54 ans, native de Lyon, y dem[eurant] rue de l’Arbre-sec ; rentiere. » (p. 99)
- « Berruyer, (Françoise) veuve d’Alexis Gagnaire, âgée de 33 ans, nat[ive] de Lyon, y dem[eurant] pl[ace] St. Nizier ; rentiere. » (p. 12)
2 nivôse, jugement de la Commission Révolutionnaire […] Contre 23 Rebels qui ont été guillotiné, no 20
« Milet, (Charlotte) femme de Tridon de Rey [Deray], âgée de 36 ans, native de Bar-sur-Seine, dép[artement] de la Côte-d’or, dem[eurant] à Lyon rue de Flandre. » (p. 84)
4 nivôse, Jugement de la Commission Révolutionnaire qui Condamne a Mort 15 Rebeles dont une femme par la Guillotinne, no 22
« Adrian, (Marie) âgée de 17 ans, native de Lyon, y dem[eurant] place Confort ; tailleuse, a servi en qualité de cannonier pendant le siege, étant déguisée en homme. » (p. [3])
8 nivôse, jugement de la Com[missi]on Révolutionnaire […] qui juge amort 46 Rebels dont 43 fusiliers 3. guillotiné dont une femme, no 26
« Siblin femme Nicolet, (Françoise) de 36 ans, native de Chazelle, département de l’Isere, dem[eurant] à Lyon rue Merciere : dégraisseuse. » (p. 114)
25 nivôse, jugement de la Commission Révolutionnaire […] Contre 12 Rebels condamné a Mort par la guillotine, no 38
« Rochard, (Anne) femme de Claude Sonnerie, de 41 ans, native d’Odenas, district de Villefranche, dem[eurant] à Lyon rue des Hébergeries : vinaigriere. » (p. 115)
14 pluviôse, jugement de la Commission Révolutionnaire […] qui juge a Mort 41. Rebels dont onze par la guillotine, no 50
« Pupier, (Anne) femme Légallerie, de 38 ans, native de Montbrison, y dem[eurant] : ex-noble. » (p. 101)
18 pluviôse, jugement de la Commission Révolutionnaire […] qui condamne a Mort 12 Rebels par la guillotine, no 52
« Beaussan, (Louise) âgée de 60 ans, dem[eurant] à Lyon rue du Bœuf ; ci-devant religieuse. » (p. 10)
22 pluviôse, jugement de la commission Révolutionnaire […] qui juge amort 12 femme contre Révolutionnaires et un cidevant Curé Rebel a la loi, no 55
- « Michalet, (Françoise) âgée de 34 ans, native de Roanne, dem[eurant] à Lyon place St. Nizier : march[ande]. » (p. 83)
- « Vavre, (Philiberte) veuve Maupetit, de 61 ans, native de Lyon, demeurant place des Cordeliers : rentiere. » (p. 122)
- « Vernay, (Antoinette) femme de Joseph Courrois [ou Courtois], de 48 ans, native de Lyon, y dem[eurant] rue Noire : revendeuse. » (p. 123)
- « Gouanne, (Marguerite) ci-devant religieuse. » (p. 58) [26 ans, native d’Amplepluy, demeurant au Sauvage (Rhône)]
- « Desplantes, (Marguerite) de 38 ans, nat[ive] de Lyon, y demeurant place de la Fédération ; hôteliere. » (p. 41)
- « Protri, (Jeanne) veuve Duter, de 38 ans, native de Belleville, dem[eurant] à Lyon rue Dubois. » (p. 101)
- « Giraud, (Marie-Anne) âgée de 60 ans, native de Moulins, demeur[ant] à Lyon place du Change ; rentiere, sœur d’un chef des rebelles. » (p. 57)

ADR, 42L27, [Commission révolutionnaire :] Jugements (14 frimaire-24 germinal an II).
- « Hutte, (Antoinette) âgée de 34 ans, native de Lyon, y demeurant Grand’rue ; marchande. » (p. 64)
- « Chataignier, [Jacqueline] âgée de 45 ans, native de Lyon, y demeurant rue de la Vieille-monnoie ; fanatique. » (p. 29)
- « Chataignier, [Élisabeth] âgée de 47 ans ; fanatique. » (p. 29)
- « Chataignier, [Louise] âgée de 46 ans ; fanatique. » (p. 29)
- « Bertaut [Bertaud], (Eléonore) dite Ollier, âgée de 59 ans, native de Lyon, dem[eurant] rue St. Pierre ; libraire. » (p. 12)
29 pluviôse, jugement de la Commission Révolutionnaire […] qui juge amort 23 Rebels dont une femme par la guillotine, no 58
« Bauquis, (Jeanne) âgée de 63 ans, nat[ive] de Lyon, dem[eurant] rue Grenette ; ci-devant religieuse fanatique, recevant chez elle des prêtres réfractaires. » (p. 9)
6 ventôse, jugement de la C[ommissi]on Révol[utionnai]re […] qui juge amort 20 Rebels dont 2 femme par la guillotine, no 60
- Boucharlat, [Philippine] femme de Grégoire-Etienne Ferroussat, âgée de 48 ans, native de Lyon, y demeurant rue St. George. » (p. 17)
- « Guillot, (Françoise) femme de Jerôme Mortier, de 46 ans, native de la Tour-du-pin, dem[eurant] à Lyon rue Juiverie ; jardiniere. » (p. 62)
9 ventôse, jugement de la C[ommissi]on Révolutionnaire […] qui juge amort onze Rebels par la guillotine dont trois femme, no 61
- « Chenet, [Marie-Thérèse] femme de Jean Gacon, âgée de 36 ans, native de Lyon, y dem[eurant] rue S. George ; ouvriere en soie. » (p. 30)
- « Butin, (Pierrette) femme de François Fatay [Falais], âgée de 38 ans, native de Lyon, dem[eurant] rue St. George ; marchande de poisson. » (p. 23)
- « Marmet, (Marie-Anne) femme David, âgée de 42 ans, nat[ive] de Lyon, dem[eurant] rue St. George ; revend[euse]. » (p. 79)
24 ventôse, jugement de la C[ommissi]on Révolutionnaire […] qui juge amort 29 Rebels dont une femme par la guillotine, no 64
« Grozelié, (Marie-Anne) veuve d’André-François-Martin d’Espomet, âgée de 58 ans, native de Chenetel, dem[eurant] à Montbrison ; sans état, ex-nob[le]. » (p. 60)
2 germinal, Jugement de la Commission Révolutionnaire qui Condamne à Mort 13 Rebeles dont 2 femmes, no 71
- « Manessy, (Catherine) veuve de Jean-Bapt[iste] Ponson, âgée de 63 ans, native de Lyon, y demeurant rue Trois-carreaux ; couturiere. » (p. 78)
- « Corbeau, (Marie) âgée de 38 ans, nat[ive] de St. Beton, dép[artement] du Mont-blanc, dem[eurant] à Lyon ; ex-noble, & ex-religieuse de la ci-dev[ant] abbaye de St. Pierre. » (p. 34)
3 germinal, Jugement de la Commission révolutionnaire [formulaire imprimé], [no 72]
- « Chatelot, (Marie-Claire) femme Maubon, âgée de 36 ans, native de Villefranche, demeurant à Montbrison ; rentiere. » (p. 29)
- « Blanc, (Marie) [60 ans,] veuve d’Hector-Joseph Ferrand, nat[ive] de St. Bonnet-le-froid, dem[eurant] à Boën, dép[artement] de la Loire ; rentiere. » (p. 14)
- « Ducrozé, (Marie) veuve de Jean-Baptiste Vaugirard, ex-noble, de 43 ans, nat[ive] de Montbrison, y dem[eurant] ; rentiere. » (p. 43)
- « Moreau, (Félicité-Marguerite-Magdeleine) femme d’Hector Rostaing, ex-noble, de 48 ans, nat[ive] de Buy, dép[artement] de la Drôme, dem[eurant] à Grenoble. » (p. 87)
- « Marmet, (Louise) âgée de 24 ans, nat[ive] de Lyon, y dem[eurant] rue Lanterne ; couturiere. » (p. 79)
16 germinal, Jugement de la Commission Révolutionnaire Qui Condamne a mort 16 Rebeles, no 76
- « Myotte, (Tiénon) de 36 ans, native de Tarare, dem[eurant] à Lyon rue de la ci-dev[ant] Douane ; brodeuse. » (p. 89)
- « Fayol [Fayolle], (Anne-Marie) de 64 ans, native de Lyon, dem[eurant] rue St. Côme ; institutrice. » (p. 49)
- « Chapuis, (Marie) femme de Jacques Peytel, âgée de 24 ans, nat[ive] de Lyon, y dem[eurant] quai du Rhône, section de Bon-rencontre, fabricant de bas. » (p. 28)
- « Vial, (Anne) de 62 ans, native de Lyon, dem[eurant] rue d’Ainai ; ci-devant carmélite. » (p. 123)
- « Lafont, (Marguerite) de 48 ans, native d’Amplepuis, dép[artement] du Rhône, dem[eurant] à Lyon rue Lanterne ; marchande merciere. » (p. 69)
- « Lafont, (Françoise) de 42 ans, native de Lyon, dem[eurant] rue Lanterne ; marchande merciere. » (p. 69)
Commentaire
[À venir]
Réception
[À venir]
Éléments de bibliographie
Éditions
[1843a] Quelques années de ma vie, Moulins, Martial Place, 1843-1844, 2 vol., Tome premier, Moulins, Martial Place, 1843, [4], [i]-v, [1]-328 p. ; Tome second, Moulins, Martial Place, 1844, [1]-231, [2]32 288 p.
Il s’agit de l’édition originale du texte, en deux tomes, respectivement datés de 1843 et 1844. Chaque tome comporte à la fin un ensemble de « Notes et pièces justificatives », qui présentent un vif intérêt : elles sont reprises et complétées dans la « deuxième édition » de 1845 qui, comme on le verra, constitue notre texte de base. Aucune variante significative n’a été relevée dans cette édition.
L’exemplaire consulté, qui provient du fonds des jésuites de Chantilly, conservé à la Bibliothèque municipale de Lyon (BML, SJ V662/53), a été numérisé sur Google Books.
Autre exemplaire consulté : Lyon, Bibliothèque Diderot, 073 668. La page de titre du tome II porte cependant la date de 1843 et l’appel de note dans le texte, page 3 289 , a été restitué, sans doute à la suite d’un retirage de cette page.
[1843b] Quelques années de ma vie, Moulins, Martial Place, 1843, 2 vol., même pagination que 1843a, [4], [i]-v, [1]-328 p. ; [1]-231, [2]32 290 -[2]38 p.
Cette édition, dont les deux tomes sont datés de 1843, présente une disposition identique à 1843a, mais quelques pages ont été refaites : dans le tome I, la graphie d’un nom propre présente une variante 291 ; le numéro d’une page, erroné dans 1843a, a été corrigé 292 ; dans le tome II, certains appels de notes, dans le texte 293 ou avant le texte d’une note infrapaginale 294 , sont présents alors qu’ils manquent dans 1843a, et une note donne à lire un texte complet alors qu’il a été tronqué par un défaut d’impression dans 1843a 295 . À ces différences près, qui n’affectent pas la teneur du texte, aucune variante n’a été relevée par rapport à 1845.
Au vu du caractère très ponctuel des différences observées avec 1843a, on peut émettre l’hypothèse qu’il ne s’agit pas, à proprement parler, d’une édition différente, mais d’un nouveau tirage de 1843a, manifestement destiné à un public choisi, ce dont témoigneraient la « liste des souscripteurs », la plupart d’entre eux et elles de haut rang, voire la présence de gravures (voir ci-dessous), expurgé pour l’occasion des erreurs de composition de 1843a.
L’exemplaire consulté, conservé à la bibliothèque de l’université Harvard (numérisés sur Google Books : tome I ; tome II), comporte une liste d’errata 296 :
ERRATA DU PREMIER VOLUME.
Dédicace, date, Kircheim ; lisez : Kirchheim.
Page ii, ligne 9, mêmes ; lisez : miens.
P. 5, l. 4, les tiennes ; lisez : les tiens.
P. 29, l. 5, qu’il ; lisez : qu’ils.
P. 37, note, La Ganguière ; lisez : La Gauguière.
P. 41, note 2 ; p. 42, l. 5 ; p. 45, l. 6, Nétaucourt ; lisez : Nétancourt.
P. 40, l. 2 ; p. 59, l. 3 et 27 ; p. 62, l. 4 ; p. 66, l. 3 ; p. 93, l. 21 et note, Seriziot ; lisez : Seriziat.
Chap. V, sommaire, cette phrase : Nous retrouvons mon père et les jeunes Piolenc, dépend du sommaire du IVe chap. où se trouve ce récit.
P. 82, notes 2 et 3, Fillot ; lisez : Fellot.
P. 87, l. 4, de événements ; lisez : des événements.
P. 160, l. 7, les recevoir ; lisez : le recevoir.
P. 177, l. 13, amené ; lisez : emmené.
P. 188, l. 14, je me procurais ; lisez : je me procurai.
P. 191, l. 22 ; p. 196, l. 16 ; p. 198, l. 3 ; p. 200, l. 1 et 6 ; p. 202, l. 22 ; p. 203, l. 10 et 24 ; p. 206, l. 20 ; p. 214, l. 8 et 21 ; p. 215, l. 1 ; p. 219, l. 15 ; p. 289, l. 8 ; p. 298, l. 11 ; p. 301, l. 3 ; p. 307, l. 13, Chozières ; lisez : Chazières.
P. 241, l. 1, je t’attends ; lisez : je t’attends.
P. 264, l. 2, le présent seul est terrible ; lisez : le présent seul, et terrible !
P. 268, l. 13, le belle figure ; lisez : la belle, etc.
P. 270, l. 2 et 12 ; p. 271, l. 23, Parcin ; lisez : Parein.
P. 42, l. 8, le trop fameux C. ; lisez : Challier (*), ainsi que dans les pages 50, l. 14 ; 70, l. 13 ; 71, l. 6 ; 73, l. 1 et 14 ; 74, l. 5 ; 82, l. 2 ; 136, l. 5.
(*) Je comprends qu’il est probablement trop tard pour rétablir ce nom où il doit être, mais si cela se pouvait, je demanderais qu’il fût en toutes lettres. Ne point nommer ceux de mon pays est une condescendance due [à] d’honnêtes familles que l’on ne doit pas punir des crimes d’un de leurs membres ; mais Challier, étranger à mon pays (il est Savoisien), s’est acquis une célébrité qui ne souffre aucun voile ; c’est le Robespierre, le Carier de Lyon, il est aussi connu qu’eux. En parlant de ses menées révolutionnaires, de son procès, de son exécution pour laquelle toute la force armée de la ville était sur pied, on sent que cette publicité ne permet aucune réticence, et même que cette phrase : le trop fameux, doit être suivie d’un nom, déjà livré à la connaissance du monde. / (Note de l’auteur 297 .)
On trouve en outre, à la fin du tome II, une « liste des souscripteurs » 298 :
S. A. R. Madame la duchesse douairière Henriette de Wurtemberg, née princesse de Nassau-Weilbourg, à Kirchheim-Unter-Teck (Wurtemberg) 299 : 50 exemplaires.
S. A. I. Madame l’archiduchesse Marie-Dorothée, Palatine de Hongrie, à Bude 300 : 50 ex.
Sa Majesté la Reine de Wurtemberg, à Stuttgart : 50 ex.
S. A. R. Monseigneur le duc Adam de Wurtemberg, à Vienne (Autriche) : 1 ex.
S. A. R. Monseigneur le duc Alexandre de Wurtemberg, général-major, à Gratz, en Styrie : 1 ex.
Sa Majesté l’Impératrice mère, d’Autriche, à Vienne : 6 ex.
S. A. R. Monseigneur le prince Frédéric de Wurtemberg, à Stuttgart : 1 exemplaire.
S. A. I. Madame la grande-duchesse Hélène de Russie : 6 ex.
S. A. R. Madame la duchesse Georges de Saxe-Altenbourg, à Altenbourg : 1 ex.
S. A. R. Madame la Margrave Guillaume de Bade : 1 ex.
S. A. R. Madame la duchesse régnante de Saxe-Altenbourg : 1 ex.
M. le professeur Rost, à Stuttgart : 1 ex.
M. de Scariatin, secrétaire de la légation russe, à Stuttgart : 1 ex.
Madame la baronne de Hauer, à Dresde (Saxe) : 1 ex.
Madame de Rauch, à Heilbroun (Wurtemberg) : 1 ex.
M. le comte de Schasperg, à Stuttgart : 1 ex.
Madame la baronne de Rassler, née comtesse de Sponeck, à Stuttgart : 1 exemplaire.
M. le baron de Ruedt, ministre de Bade, à Stuttgart : 1 ex.
S. A. S. le prince de Langenbourg, à Langenbourg (Wurtemberg) : 1 exemplaire.
S. A. S. Madame la princesse de Langenbourg, née princesse de Leiningen, à Langenbourg : 1 ex.
Madame la baronne de Reischach, née baronne de Rœder, à Stuttgart : 1 exemplaire.
Madame la baronne de Neubron, née comtesse de Walbourg-Wolfegg-Wolfegg, à Glattbach, près Faingen-sur-Ens (Wurtemberg) : 1 ex.
Miss Marguerite Kenedi, à Carlsruhe : 1 ex.
M. Kenedi fils, à Carlsruhe : 1 ex.
M. le comte de Buol, ministre d’Autriche, à Stuttgart : 1 ex.
S. A. S. Monseigneur le duc régnant de Nassau, à Wisbade : 3 ex.
S. A. S. Madame la duchesse de Nassau, à Wisbade : 3 ex.
S. A. R. Madame la princesse Marie de Hanovre, à Hanovre : 1 exemplaire.
Mademoiselle la baronne de Budberg, dame d’honneur de S. A. R. Madame la duchesse régnante de Saxe-Altenbourg : 1 ex.
Mademoiselle la baronne de Friesen, dame d’honneur de S. A. R. Madame la princesse Jean, de Saxe : 1 ex.
M. Ripoud, ex-bibliothécaire de la ville de Moulins : 1 ex.
Madame Limenton de Jaugy, à Moulins : 1 ex.
M. Dufour, artiste, à Moulins : 1 ex.
Madame la comtesse de Mauclerc, née de Beroldingen, à Stuttgart : 1 exemplaire.
Madame la baronne de Troyft, à Stuttgart : 1 ex.
Madame de Holtz, née de Behr, à Stuttgart : 1 ex.
M. le général de Brusselle, à Stuttgart : 1 ex.
S. A. S. le prince de Wurzach (Wurtemberg) : 1 ex.
Mademoiselle Louise de Baer, directrice de l’Institut-Catherine, à Stuttgart : 1 ex.
Madame la baronne de Seckendorf, dame du palais de feu S. M. la Reine douairière de Wurtemberg : 2 ex.
M. le lieutenant-général baron de Rœder, à Louisbourg (Wurtemberg) : 1 ex.
Madame la baronne de Seckendorf, née de Spiegel, à Stuttgart : 1 exemplaire.
Mademoiselle Auguste de Seckendorff, dame d’honneur de S. M. la Reine de Wurtemberg : 1 ex.
Madame la comtesse de Brousselles, née de Hohenseck, à Stuttgart : 1 exemplaire.
Madame de Speth, à Louisbourg : 1 ex.
Madame la baronne de Rœder, née de Seckendorf, à Louisbourg : 1 exemplaire.
M. le comte de Montgelas, secrétaire de la légation bavaroise à Stuttgart : 1 ex.
Madame la comtesse de la Ferrière, à Paris : 1 ex.
Madame la baronne de Coussay, à Paris : 1 ex.
M. le vicomte Foullon de Doué, à Paris : 1 ex.
Mademoiselle Leblanc de Lespinasse, à Nevers : 1 ex.
M. Leblanc de Lespinasse, à Nevers : 1 ex.
Mademoiselle Marie de Waechter, à Stuttgart : 1 ex.
M. le baron de Nellenstein, à Stuttgart : 1 ex.
M. le baron de Kœnig de Mauren, à Stuttgart : 1 ex.
Madame la comtesse de Thurn, grande-maîtresse de S. A. I. Madame l’Archiduchesse Palatine de Hongrie, à Bude : 1 ex.
M. le comte de Wallenstein, chambellan de Monseigneur l’Archiduc Palatin de Hongrie, à Bude : 5 ex.
M. le comte de Festelics, grand-maître de Monseigneur l’Archiduc Palatin, à Bude : 1 ex.
Madame la baronne de Gemmingen-Michelfeld, à Carlsruhe (grand-duché de Bade) : 3 ex.
Miss Jane Kenedi, au cercle de Carlsruhe, grand-duché de Bade : 2 ex.
Madame la baronne d’Eldensheim, grande-maîtresse de Madame la Grande-Duchesse de Bade, à Carlsruhe : 1 ex.
Madame la baronne Amélie de Gemmingen-Gemmingen, à Carlsruhe : 1 exemplaire.
Madame la baronne de Stetten, née de Gemmingen ; à Carlsruhe : 1 exemplaire.
Madame Fuller, à Carlsruhe : 1 ex.
M. le baron de Berkheim père, grand chambellan de S. A. R. Monseigneur le Grand Duc de Bade, à Carlsruhe : 1 ex.
M. le marquis d’Eyragues, ministre de France, à Carlsruhe : 1 ex.
M. Piersoll, à Carlsruhe : 1 ex.
M. le baron de Menneval, secrétaire de la légation française, à Carlsruhe : 1 ex.
Mademoiselle la baronne de Porbeck, dame d’honneur de S. A. R. Madame la Margrave Guillaume de Bade, à Carlsruhe : 1 ex.
M. Schuler, adjudant de S. A. R. Monseigneur le Margrave Maximilien de Bade, à Carlsruhe : 1 ex.
Sir Édouard Disbrow, ministre d’Angleterre, à la Haye (Hollande) : 1 ex.
M. le baron de Bielfeld, adjudant de S. A. I. Monseigneur le Duc régnant de Saxe-Altenbourg, à Altenbourg : 1 ex.
Madame de Spitzemberg, dame du palais de S. M. la Reine de Wurtemberg, à Stuttgart : 1 ex.
Madame la baronne de Gemmingen, dame du palais de S. M. la Reine de Wurtemberg, à Stuttgart : 1 ex.
Madame la baronne de Hugel, née baronne de Gemmingen-Bonfeld, à Stuttgart : 3 ex.
Madame la baronne de Varnbuler, dame d’honneur de S. A. R. Madame la princesse Catherine de Wurtemberg, à Stuttgart : 1 ex.
Mademoiselle de Pabst, dame d’honneur de S. A. R. Madame la princesse d’Orange, à la Haye : 1 ex.
Mademoiselle de Styrum, dame d’honneur de S. A. R. Madame la princesse d’Orange, à la Haye : 1 ex.
M. le baron de Fenningen-d’Eichtersheim, à Mannheim (grand-duché de Bade) : 1 ex.
Madame Gassert, née de Boscale, à Carlsruhe : 1 ex.
Madame la baronne de Weweld, dame d’honneur de S. M. l’Impératrice mère, d’Autriche, à Vienne : 1 ex.
Madame la comtesse Marie de Wurtemberg, à Stuttgart : 3 ex.
S. A. S. Madame la princesse Marie de Hohenlohe-Kirchberg, à Kirchberg (Wurtemberg) : 1 ex.
S. A. S. le prince Henri de Hohenlohe, ambassadeur de S. M. le Roi de Wurtemberg, à la cour de St.-Pétersbourg : 1 ex.
M. le vicomte de Fontenai, ministre de France à la cour de Wurtemberg : 1 ex.
M. le baron de Gemmingen, grand-maître de S. M. la Reine de Wurtemberg : 1 ex.
Mademoiselle Bertha de Bieberstein, à Stuttgart : 1 ex.
Madame la baronne de Berlichingen, née Eschenbourg, à Stuttgart : 1 exemplaire.
M. le baron de Taubenheim : 1 ex.
M. le comte de Degenfeld, secrétaire de la légation wurtembergeoise, à Vienne : 1 ex.
Madame la comtesse de Beroldingen, née de Ritter, dame du palais de S. M. la Reine de Wurtemberg : 1 ex.
Madame la comtesse de Beroldingen, née de Larische-Manich, à Stuttgart : 1 ex.
M. Du Buisson, au château d’Aix, près Moulins : 1 ex.
M. le comte d’Estrée, à Moulins : 1 ex.
M. de Séréville, major à l’ex-garde, à Moulins : 1 ex.
M. Pareto, artiste, à Moulins : 1 ex. (a dessiné le frontispice).
M. Moretti, artiste, à Moulins : 1 ex. (a dessiné les cinq gravures de l’ouvrage).
S. A. S. Madame la princesse Thérèse, duchesse de Saxe-Altenbourg, à Altenbourg : 1 ex.
S. A. S. Madame la princesse Élisabeth, duchesse de Saxe-Altenbourg, à Altenbourg : 1 ex.
S. A. S. Madame la princesse Alexandra de Saxe-Altenbourg : 1 ex.
Madame la baronne de Grimmenstein, dame d’honneur de S. A. R. la duchesse régnante de Saxe-Altenbourg : 1 ex.
M. le comte de Maucler, à Ougney-Douvot, près Baume-les-Dames (Doubs) : 1 ex.
M. le baron de Falcke, conseiller intime du roi de Hanovre, à Hanovre : 1 ex.
M. le baron de Malortie, grand Échanson et Maréchal des voyages de Sa Majesté le roi de Hanovre, à Hanovre : 1 ex.
Madame la comtesse de Tourraine, à Paris : 1 ex.
Madame la comtesse de Mauny, à Paris : 1 ex.
L’exemplaire comporte enfin un frontispice, attribué, dans la « liste des souscripteurs », à « Pareto, artiste, à Moulins », au début du tome I, ainsi que quatre des cinq gravures hors-texte, signées par Moretti, désigné, dans la « liste des souscripteurs », comme un autre artiste de Moulins :
T. I :
p. 80/81 : « Siége et bombardement de Lyon ».
p. 294/295 : « Vue du château des Echerolles ».
T. II :
p. 134/135 : « Moulins. — Vue prise de la Levée ».
p. 160/161 : « Vue du pont de pierre, près du quai de la Saône ».
[1845] Quelques années de ma vie. Deuxième édition, revue et augmentée de notes importantes, Moulins, Martial Place ; Paris, Dumoulin ; Stuttgard, Weise et Stoppani, 1845, 2 tomes en 1 vol., [4], [i]-v, [1]-328 p. ; [1]-240 p.
Cette édition, dite « revue et augmentée de notes importantes », reprend le texte ainsi que les « Notes et pièces justificatives » placées à la fin de chacun des tomes publiés dans les éditions de 1843. Les couvertures de chaque volume ont été changées, mais on trouve, à l’intérieur de l’ouvrage, les pages de titre des éditions de 1843 et, bien que la numérotation des cahiers indique, à intervalles réguliers, qu’il s’agit d’une « 2e édition », la disposition du texte sur chaque page est strictement identique à celle de l’édition de 1843.
L’observation des particularités typographiques, relevées ci-dessus, qui permettent de distinguer 1843a et 1843b, conduit à conclure que cette édition a été constituée à partir de 1843a 301 .
Contrairement à toutes les éditions antérieures, 1845 comporte des « Notes supplémentaires », ajoutées à la suite des « Notes et pièces justificatives », à la fin de tome II :

Alors que jusque-là, comme on l’a signalé, 1845 reprend le 1843a, cette page, ainsi que les suivantes, ont été refaites et renumérotées si bien que l’erreur de pagination signalée dans 1843a 302 a été corrigée.
L’ensemble que forment les « Notes et pièces justificatives » et les « Notes supplémentaires » n’a pas été repris dans toutes les éditions ultérieures, y compris dans celle, récente, de 2020.
L’exemplaire consulté est conservé dans le fonds Coste de la Bibliothèque municipale de Lyon (BML, 354413) : les deux tomes ont fait l’objet d’une unique numérisation sur Google Books. Cet exemplaire est en outre doté d’une liste d’errata 303 :
ERRATA DU PREMIER VOLUME.
Dédicace, date, Kircheim ; lisez : Kirchheim.
Page ii, ligne 9, mêmes ; lisez : miens.
P. [v], l. 4, les tiennes ; lisez : les tiens.
P. 37, note, La Ganguière ; lisez : La Gauguière.
P. 41, note 2 ; p. 42, l. [4] ; p. 45, l. 4, Nétaucourt ; lisez : Nétancourt.
P. 4[6], l. 2 ; p. 59, l. [4] et 27 ; p. 62, l. 4 ; p. 66, l. 3 ; p. 93, l. 21 et note, Seriziot [Seriziol] ; lisez : Seriziat.
Chap. V, sommaire, cette phrase : Nous retrouvons mon père et les jeunes Piolenc, dépend du sommaire du IVe chapitre où se trouve ce récit.
P. 82, note[, l.] 2 et 3, Fillot ; lisez : Fellot.
P. 118, l. 22, Dubois-Craucé ; lisez : Dubois-Crancé.
P. 164, l. 16 ; p. 228, l. 21, Olivier ; lisez : Ollier.
P. 191, l. 22 ; p. 196, l. 16 ; p. 198, l. 3 ; p. 200, l. 1 et 6 ; p. 202, l. 22 ; p. 203, l. 10 et 24 ; p. 206, l. 20 ; p. 214, l. 8 et 21 ; p. 215, l. 1 ; p. 219, l. 15 ; p. 289, l. 8 ; p. 298, l. 1[5] ; p. 301, l. 3 ; p. 307, l. 1[7], Chozières ; lisez : Chazières.
P. 270, l. 2 et 12 ; p. 271, l. 23, Parcin ; lisez Parein.
P. 42, l. 8, le trop fameux C. ; lisez : Challier, ainsi que dans les pages 50, l. 14 ; 70, l. 13 ; 71, l. 6 ; 73, l. 1 et 14 ; 74, l. 5 ; 82, l. 2 ; 136, l. 5.
SECOND VOLUME.
P. 105, l. 2 ; p. 106, l. 21 ; p. 115, sommaire, l. 6 ; p. 129, l. 17 ; p. 135, sommaire, l. 4 ; p. 142, l. 6 ; p. 143, l. 2 ; p. 150, l. 8 ; au lieu de Battoné ; lisez : Battoué.
P. 218. l. 19, au lieu de madame de Chaillot ; lisez : monsieur de Chaillot.
[1879]Une famille noble sous la Terreur, Paris, Plon, 1879, [v]-xvi, [1]-462 p.
Cette « nouvelle édition », posthume, du texte d’Alexandrine des Écherolles, dotée d’un nouveau titre, comporte une préface, datée du « Château de Luanges, près Nevers, mai 1879 », de René de Lespinasse : quoique placée sous l’égide d’un membre de l’École des Chartes, ce qui confère une marque de sérieux philologique à l’entreprise, cette édition semble aussi – d’abord ? – avoir été mise en chantier pour des raisons personnelles : il s’agit d’« un tribut de reconnaissance rendu à la mémoire d’une parente qui a consacré des pages touchantes aux instants qu’elle a passés en Nivernais auprès des [s]iens » (p. vi), et l’on se souvient qu’Alexandrine des Écherolles raconte plusieurs de ses séjours auprès de sa grand-tante Melon, au domaine de l’Ombre, et brosse un portrait très élogieux de sa « cousine », « Mademoiselle Leblanc de Lespinasse » 304 .
Dans cette « Préface de la nouvelle édition », René de Lespinasse construit une grille d’interprétation du texte qui a connu une certaine fortune et que nous avons cherché à mettre en perspectives. Parmi ces idées reçues, les mémoires d’Alexandrine des Écherolles ne sauraient être considérés comme un ouvrage historique à part entière 305 . L’éditeur cherche certes à renouveler l’« intérêt » que l’on peut prendre à un texte qui n’a jusque-là connu qu’une diffusion jugée confidentielle : « publiés une première fois, presque contre le gré de l’auteur », ces mémoires « ont été pour ainsi dire le privilége de la famille et d’un petit nombre de lecteurs » (p. [v]). Mais c’est pour en souligner la valeur personnelle : « peu de personnes se montraient alors décidées à livrer au public les secrets d’une vie de souffrance et de malheurs » (p. [v]). Et, reprenant l’idée, plusieurs fois répétée dans son texte, que son intention est de payer un tribut de reconnaissance aux personnes qui ont aidé sa famille : « Madame des Écherolles possède au plus haut degré le culte du souvenir pour les bontés dont elle a été l’objet pendant ses malheurs. » (p. vi) Et, plus explicitement encore : « Sans aspirer au rôle d’historien, sans rechercher les faits curieux de son temps, elle s’attache à raconter d’une manière aussi simple que véridique les terribles circonstances où sa famille a été engagée, les rigueurs qu’ils eurent tous à subir de la part du gouvernement de la Révolution. » (p. vi-vii)
Bien que le discours de René de Lespinasse ne lui reconnaisse pas un intérêt historique, le récit d’Alexandrine Giraud n’est pour autant pas dépourvu d’enjeux idéologiques. Si l’accent est mis sur la sensibilité qui émane du texte de l’autrice (« Chaque ligne de ses Mémoires reflète les sentiments de son cœur si douloureusement éprouvé », p. vi ; la « nuance de délicatesse dont les femmes seules possèdent le secret », p. x), le préfacier ne dissimule pas la lecture politique qu’il en propose : « on verra ressortir mieux encore le véritable caractère de cette époque tourmentée, où les chefs ne semblent s’être servis du nom du peuple que pour assouvir leurs désirs de haine et de vengeance » (p. vii). Et de stigmatiser des « folies démagogiques » sans « limites » (p. vii) des uns auxquels il oppose les « nobles champions de l’ordre » (p. viii).
Cette « nouvelle édition » rassemble en un seul volume le texte, structuré en 23 chapitres, des deux tomes de l’édition de 1845 qui, comme on le verra, a manifestement été utilisée pour son élaboration : la fin d’un chapitre est déplacée au début du chapitre suivant 306 ; le début d’un chapitre est placé à la fin du chapitre précédent 307 ; à trois reprises, plusieurs chapitres sont regroupés en un seul 308 .
Le tableau ci-dessous résume les redéploiements effectués dans la structuration du texte :
| 1845 | 1879 |
| Tome I | |
| Préface (p. [i]-iii) | Préface (p. [xiii]-xiv) |
| À toi (p. [iv]-v) | À toi (p. [xv]-xvi) |
| Chap. I (p. [1]-9) | Chap. I (p. [1]-8) |
| Chap. II (p. [11]-20) | Chap. II (p. [9]-18) |
| Chap. III (p. [21]-37) | Chap. III (p. [19]-33) |
| Chap. IV (p. [39]-64) | Chap. IV (p. [35]-55) |
| Chap. V (p. [65]-80) | Chap. V (p. [57]-71) |
| Chap. VI (p. [81]-112) | Chap. VI (p. [73]-100) |
| Chap. VII (p. [113]-133) | Chap. VII (p. [101]-118) |
| Chap. VIII (p. [135]-168) | Chap. VIII (p. [119]-150) |
| Chap. IX (p. [169]-198) | Chap. IX (p. [151]-175) |
| Chap. X (p. [199]-232) | Chap. X (p. [177]-206) |
| Chap. XI (p. [233]-243) | Chap. XI (p. [207]-229) |
| Chap. XII (p. [245]-254) | |
| Chap. XIII (p. [255]-261) | |
| Chap. XIV (p. [263]-275) | Chap. XII (p. [231]-248) |
| Chap. XV (p. [277]-285) | |
| Chap. XVI (p. [287]-294) | Chap. XIII (p. [249]-267) |
| Chap. XVII (p. [295]-309) | |
| Notes et pièces justificatives (p. [311]-323) | |
| Tome II | |
| Chap. I (p. [1]-26) | Chap. XIV (p. [269]-290) |
| Chap. II (p. 27]-48) | Chap. XV (p. [291]-309) |
| Chap. III (p. [49]-66) | Chap. XVI (p. [311]-325) |
| Chap. IV (p. [67]-83) | Chap. XVII (p. [327]-340) |
| Chap. V (p. [85]-113) | Chap. XVIII (p. [341]-365) |
| Chap. VI (p. [115]-134) | Chap. XIX (p. [367]-383) |
| Chap. VII (p. [135]-160) | Chap. XX (p. [385]-405) |
| Chap. VIII (p. [161]-176) | Chap. XXI (p. [407]-420) |
| Chap. IX (p. [177]-199) | Chap. XXII (p. [421]-439) |
| Chap. X (p. [201]-220) | Chap. XXIII (p. [441]-457) |
| Notes et pièces justificatives (p. [221]-228) | |
| Notes supplémentaires (p. 228-235) |
Outre la restructuration du texte en un seul ensemble de chapitres sans partition en deux tomes, dont il reste une trace involontairement laissée par l’éditeur de 1879 309 , le texte, fréquemment récrit de manière ponctuelle 310 , a été élagué : en particulier, les deux séries de « Notes et pièces justificatives » ainsi que les « Notes supplémentaires » ne s’y trouvent pas. Certains passages des « Notes et pièces justificatives » mais aussi des « Notes supplémentaires » ont cependant été repris dans le texte ou pour constituer de nouvelles notes en bas de page. Les « Notes supplémentaires » étant, on s’en souvient, uniquement présentes dans la réédition de 1845, on dispose ainsi de la certitude que c’est cette édition qui a été utilisée pour préparer celle de 1879. On trouve enfin un passage du texte et quelques notes dont le contenu ne figure nulle part dans les éditions antérieures. Nous émettons l’hypothèse qu’il s’agit d’interventions de l’éditeur René de Lespinasse : ainsi d’une note dans laquelle Alexandrine des Écherolles est désignée à la 3e personne 311 ; ainsi de précisions supplémentaires sur la famille Lespinasse 312 . Ainsi sans doute aussi d’une note indiquant la date de la nomination de Napoléon en tant que premier consul 313 .
Cette édition, dont l’exemplaire consulté, conservé dans les fonds de la Bibliothèque nationale d’Autriche, a été numérisé sur Google Books, a connu six rééditions chez Plon en 1881, 1892, 1900, 1907 et 1912. L’importance de la diffusion de cette version du texte justifie que nous en ayons relevé les variantes sans toutefois pouvoir garantir qu’elles sont à mettre à l’actif de l’autrice, morte en 1850.
Les Destinées d’une Famille ou fais ce que dois, advienne que pourra, Lille, Maison Saint-Joseph, s.d. [après 1892 314 ].
Par rapport aux éditions antérieurement signalées, l’« Avertissement de l’Éditeur » (p. [7]-8) assigne au texte d’Alexandrine des Écherolles une destination nouvelle, à l’intention de « la jeunesse » (p. 8) : il présente « les qualités maîtresses que désirent les directeurs pour les livres destinés à leurs élèves » (p. 8). À la double mention, déjà rencontrée en particulier sous la plume de René de Lespinasse, dont deux extraits de la « Préface de la nouvelle édition » de 1879 sont cités (p. [7]), de « son mérite littéraire » et de « l’attrait de ses émouvants épisodes », s’ajoute ainsi « un précieux avantage » : le fait que « le recueil de Mlle des Écherolles » est animé d’« un esprit vraiment chrétien » (p. 8). Ce qu’illustre un extrait, sur lequel s’achève l’« Avertissement » (p. 8), du discours adressé par l’autrice à sa nièce dans le texte liminaire 315 qui n’est cependant pas repris dans cette nouvelle édition.
Cette orientation résolument chrétienne, qui tend, du moins dans le discours de « l’Éditeur », à occulter la dimension politique, pourtant centrale dans la grille de lecture de René de Lespinasse, éclaire du reste, comme on le verra, certains des aménagements du texte.
Modifications du texte
Le même « Avertissement de l’Éditeur », après avoir rappelé l’existence des précédentes éditions de 1843 et de 1879, précise que son « édition ne diffère des deux premières que par quelques retouches de style sans importance et de rares suppressions » (p. [7]). Un examen attentif du texte convainc rapidement que ces affirmations sont discutables. On a pu déjà relever ci-dessus, dans la description de l’édition de 1879, que cette édition présente des différences notables par rapport à celle de 1843/1845 316 , en particulier la suppression de la répartition des chapitres en deux tomes, de même que l’omission des « Notes et pièces justificatives » et des « Notes supplémentaires » de 1845 – autant de caractéristiques que l’on retrouve dans la présente édition.
Si l’édition de 1879 a ainsi vraisemblablement servi de base pour l’élaboration de cette nouvelle édition, comme le suggérait déjà la présence, dans l’« Avertissement », de citations de René de Lespinasse « à qui nous devons la publication de “Une Famille noble sous la Terreur” » (p. [7]), et comme le confirme la présence, moyennant quelques variantes ponctuelles, en tête des chapitres, des sommaires publiés en 1879, on constate pourtant que le texte de 1879 a fait l’objet de remaniements beaucoup plus considérables que ne le laisse attendre l’évocation de « quelques retouches de style sans importance et de rares suppressions » (p. [7]).
Ces remaniements affectent en effet d’abord la structure même du volume, à commencer par le péritexte éditorial : sans surprise, on ne trouve ni la première dédicace aux têtes couronnées d’Allemagne, ni l’adresse à la nièce Maria (« A toi ») 317 qui n’étaient pas reprises dans 1879, mais il en va de même de la « Préface » de l’autrice, encore présente dans 1879. Le texte commence donc sans préambule avec le « Chapitre Premier » (p. [9]). Mais ils affectent aussi la structuration en chapitres, qui reprend globalement la répartition du texte dans 1879, à deux exceptions près. En lieu et place des 23 chapitres de 1879, la présente édition n’en comporte que 21, car, à deux reprises, le contenu de deux chapitres a été fusionné : les chapitres XIV et XV de l’édition de 1879 forment le seul chapitre XIV ; les chapitres XXI et XXII de l’édition de 1879 constituent le chapitre XX 318 .
Mais l’examen comparé des éditions indique aussi que, dans la présente édition, le texte de l’autrice a été affecté par des modifications d’ordre microstructurel. Outre l’ajout, à la fin du dernier chapitre, d’une note qui rappelle – ce que ne faisait pas l’édition de 1879 – le décès de l’autrice 319 , le texte a fréquemment été récrit, ce qui était déjà le cas dans l’édition de 1879, comme on peut en prendre la mesure en consultant les quelque quatre cents variantes que nous avons relevées par rapport à l’édition de 1845 qui nous sert de texte de base. On constate de surcroît que des suppressions ont été effectuées qui, contrairement à ce qu’affirme « l’Éditeur » dans l’« Avertissement », ne sont pas « rares ». C’est le cas de certaines des notes de l’autrice 320 ; c’est aussi le cas, dans le texte, de passages de plus ou moins grande ampleur.
Ces suppressions paraissent d’une part procéder d’une réduction d’ordre esthétique qui va dans le sens d’une épure du récit. Ainsi, par exemple, de certains passages de métadiscours, qui ne sont toutefois pas systématiquement éliminés 321 :
[…] Elle [la tante] n’échappa à cette nouvelle torture qu’en parlant des violentes douleurs de rhumatisme dont elle souffrait beaucoup.
Je crois avoir déjà dit que ma tante mangeait avec trois dames, et que le troisième ou quatrième jour, on vivait des économies précédentes. Cet arrangement fut continué, et cette petite société, composée de madame des Plantes, mademoiselle Olivier et mademoiselle Huette, restant unie, conservait entre elles une plus grande intimité qu’avec les autres prisonnières, comme si déjà elle pressentait qu’une même destinée l’attendait, et qu’elle ne se séparerait plus. (éd. 1879, p. 203 322 )
[…] Elle n’échappa à cette nouvelle torture qu’en parlant des violentes douleurs de rhumatisme dont elle souffrait beaucoup.
Elle continuait de manger avec trois dames prisonnières ; cette petite société, composée de Mme des Plantes, Mlle Olivier et Mlle Huette, conservait entre les commensales une plus grande intimité qu’avec les autres prisonnières, comme si déjà elles avaient pressenti qu’une même destinée les attendait. (p. 157 de cette nouvelle édition)
Cet exemple illustre aussi la volonté d’accentuer l’élévation du style (« entre elles » devient « entre les commensales ») et de ramasser l’expression, au prix cependant d’une atténuation de l’effet : l’expression « et qu’elle ne se séparerait plus », supprimée, n’était pas le simple redoublement de l’expression « qu’une même destinée l’attendait » – seule conservée – ; elle explicite la nature de cette « destinée » en convoquant, de manière proleptique, l’image d’une réunion dans la mort commune sur l’échafaud.
Sont encore supprimés des épisodes que l’on peut considérer comme périphériques ou digressifs par rapport à l’intrigue principale, par exemple deux des épisodes relatant l’arrivée et le retour du personnage épisodique anonyme, dénommé « M. Untel », qui intervient à trois reprises dans l’édition de 1879 (p. 353-354, 391-396 et [441]-442 323 ) : les premier et troisième épisodes étant supprimés dans cette nouvelle édition (p. 261 et [312]), ce personnage n’est évoqué qu’une fois, dans l’épisode le plus développé (p. 284-287), mais par cette simplification du récit le caractère inquiétant de ses réapparitions n’est plus perceptible 324 .
Certaines suppressions concernent plusieurs pages. Ainsi de l’évocation de la vie mondaine de la tante lorsqu’elle tenait salon à Moulins, qui intervient pour ainsi dire à contre-temps, au moment de l’évocation de son incarcération dans la prison Saint-Joseph. Alors que, conformément aux éditions précédentes, l’édition de 1879 évoque longuement (p. 224-226 325 ), à la suite de la mention de son goût pour les traits d’esprits (« elle ne sut jamais résister au plaisir de dire un mot spirituel », p. 224), dût-il blesser sa victime, les occupations de la « femme du monde, aimant le monde » (p. 225), qui se livre « sans réserve à la vivacité de son esprit » (p. 224), et le contraste que ce caractère offre avec la retenue et la résignation de celle qui est désormais prisonnière et se devine condamnée, la nouvelle édition ne retient que la brève évocation des traits d’esprit de la salonnière pour en revenir, au prix d’une cheville artificiellement ajoutée au récit (« Je reviens à mon récit sur la prison Saint-Joseph »), à la situation de la tante en prison :
[…] Possédant au plus haut point la repartie fine et vive, maniant la parole avec une facilité sans égale, riche en bons mots qu’elle jetait avec profusion dans l’entraînement des joyeuses causeries de salon, elle y devint une puissance parfois redoutable ; car elle ne sut jamais résister au plaisir de dire un mot spirituel. « J’aime mieux faire des excuses ensuite, disait-elle. Comment l’étouffer ? il est trop joli. » Cependant, les excuses n’adoucissaient pas le mal produit par ce mot : il frappait si juste, il faisait portrait et vouait au ridicule ; enfin ses blessures étaient incurables, et beaucoup ne les lui pardonnèrent jamais. Lorsque le malheur l’eut frappée, elle eut le loisir de rentrer en elle-même et de déplorer les suites de cette fâcheuse habitude.
Je reviens à mon récit sur la prison Saint-Joseph. Chaque jour, à l’approche de l’obscurité, on renfermait ces dames, dont les deux chambres séparées par une épaisse muraille n’avaient aucune communication entre elles. […] (p. 171-172)
On appréciera au passage l’effet produit par la réécriture, à la charnière entre les deux évocations : elle transforme la réflexion morale qui conclut la première dans les éditions antérieures (« C’est ainsi que souvent l’esprit cache le cœur 326 ») en propos d’un didactisme appuyé (« Lorsque le malheur l’eut frappée, elle eut le loisir de rentrer en elle-même et de déplorer les suites de ces fâcheuses habitudes »). La platitude de cette réécriture, sans doute inspirée par un souci d’efficacité, apparaît d’autant plus fortement que, dans le passage supprimé, le discours de l’autrice n’était pourtant pas avare de considérations chrétiennes :
[…] Si je m’arrête sur les détails d’une existence aussi superficielle, c’est pour admirer davantage ce qu’à son tour le malheur fit d’elle aussitôt qu’ayant déchiré les voiles brillants qui lui cachaient à elle-même la beauté de son âme, il la livra à toute la vigueur de cette âme fière et puissante. A peine touchée par l’infortune, elle secoua cette luisante poussière qu’elle avait prise pour de l’or, et sortant de cette tombe, elle ressuscita grande et forte.
[…] Les dégoûts et la gêne d’une pareille captivité ne lui arrachèrent pas une seule plainte : tout lui était bien ; ne désirant rien, ne trouvant rien d’incommode, elle se livrait à son sort, tel que la Providence le lui envoyait 327 .
Plus dommageable encore, la réécriture conduit à prêter à la tante une contrition qui n’est pas exprimée dans le texte : Alexandrine Giraud s’en tient à affirmer que « l’esprit » – le bel esprit – « cache le cœur » sans insinuer d’aucune manière qu’il s’agirait là d’une fâcheuse habitude dont sa tante se serait repentie par la suite. Le discours sur Marie Anne Giraud s’en trouve altéré : l’autrice la dépeint plutôt comme une femme que le salon a incitée à user de sa sagacité et de l’impertinence propres à ce milieu, et que la perte de cet environnement ramène à des considérations plus authentiques, laissant entendre qu’elle n’a jamais cessé d’avoir du « cœur » mais que les circonstances ne l’aidaient pas à en faire usage.
Réécriture et suppressions révèlent encore que, conformément à son orientation didactique – et moralisante, sinon moralisatrice –, le texte de cette nouvelle édition est aussi expurgé. C’est du moins ainsi que l’on peut interpréter certains des remaniements observés.
L’évocation de l’amitié entre Madeleine Chazière et Mlle de Sauriac fournit ainsi l’occasion d’expliquer que les qualités de la conversation de la dernière (malgré le trouble qui affecte son esprit, elle a conservé « l’habitude de s’exprimer comme une personne bien élevée ») influent de manière bénéfique sur l’éducation de la première : « Sa conversation, en familiarisant Madeleine avec des expressions choisies, avait poli son langage, sans en altérer la noble simplicité » voire, selon un ajout de cette nouvelle édition, « avait contribué au développement de ses facultés intellectuelles » (p. 140-141). Il s’agit ainsi d’insister sur les bienfaits de la fréquentation assidue d’une jeune fille de qualité qui dégrossit l’esprit d’une fille de paysans. La nouvelle édition se garde toutefois de reprendre le paragraphe suivant qui indique qu’« Un jeune Allemand, qui possédait une manufacture d’indiennes dans le village, contribua aussi au développement de l’esprit de Madeleine » 328 : sans doute n’est-il pas convenable de rappeler à « la jeunesse » que l’amour donne aussi de l’esprit aux filles.
Plus nettement encore, au cours du récit du retour d’Alexandrine aux Écherolles, lorsque, après avoir été sans succès interrogée par le maire, le comité décide d’enfermer cette jeune personne suspecte non pas en prison mais « au Dépôt », l’autrice juge utile de préciser de quel lieu il s’agit : « Le Dépôt était en effet la prison des femmes de la classe la plus vile, de ces femmes qui [ont] ajouté à leur inconduite des crimes presque authentiques » (p. 208). Les versions antérieures non seulement intensifiaient la dépravation morale de ces femmes, mais elles étaient surtout beaucoup plus explicites : « la prison des femmes prostituées de la classe la plus vile », « à l’inconduite la plus affreuse » 329 .
C’est probablement un même souci des bienséances, quoiqu’il s’exerce à d’autres niveaux, qui conduit à s’en tenir à la mention des « manières respectueuses » (p. 229) que Bonvent, « l’homme d’affaires » (p. 216) de Mlle Melon, a toujours conservées vis-à-vis d’Alexandrine, en omettant de reprendre le passage qui suit : « On lui reprochait du dérèglement dans sa conduite […] je ne puis cacher que, très-souvent, il arrivait ivre à souper 330 ». On peut encore émettre l’hypothèse que c’est le même ordre de considérations qui explique que soient systématiquement supprimées les mentions du remariage du père d’Alexandrine, plus exactement d’un père demandé en mariage par une Mlle de Cirlot d’autant plus entreprenante qu’elle est désireuse, à l’âge de « cinquante ans », d’échapper à l’emprise de sa famille – partant le fait qu’Alexandrine est alors « de trop » et surtout à charge au nouveau mais « modeste ménage ». Ce qui explique que, alors qu’il avait précédemment refusé de voir sa fille « chercher une place », il donne cette fois-ci son consentement 331 . Ne subsiste, dans la nouvelle édition, que cette scène touchante de bienveillance paternelle et de reconnaissance filiale :
Il m’avait promis de me faire venir près de lui dès que sa position serait fixée. Bien des mois s’écoulèrent ; je quittai enfin la Bourgogne et j’arrivai à Lyon par le coche d’eau.
Nos affaires étant réglées à Moulins, je m’établis chez mon père, qui, me voyant sans avenir, reprit toutes ses inquiétudes. « Si je meurs, me dit-il un jour, tu resteras sans ressources ; qu’il me sera pénible de mourir ! » Profitant de cette ouverture, je le priai de me permettre de chercher une place, fût-ce même hors de France. « Ce sacrifice une fois fait, lui dis-je, le bonheur de me savoir du pain vous consolera de mon éloignement, et vos derniers moments ne seront point troublés par l’idée de ma misère. » Je n’oublierai jamais la réponse qu’il me fit après avoir dompté son agitation : « J’y consens, ma fille ; ton bonheur me consolera de ton absence ; un père doit sacrifier ses jouissances personnelles à l’avantage de ses enfants ; et lors même que je devrais pour jamais renoncer à te voir, pars et sois heureuse… » Il pleura, mon vieux père !... (p. 295)
On peut encore comprendre qu’il serait malséant, dans un ouvrage voué à l’édification chrétienne, de mentionner les épisodes au cours desquels intervient le curé assermenté qui rend ses bons offices à Mlle Melon et qu’elle récompense par ses largesses : ils n’ont pas leur place (p. 225, 231, 240 et 272) 332 au début des années 1890, dans une France catholique qui a refermé la parenthèse de la fonctionnarisation des prêtres et s’est efforcée de pacifier les tensions qu’elle a engendrées au sein des membres du clergé.
Sans doute convenait-il enfin, dans un livre destiné à de jeunes « élèves », de passer sous silence certaines infractions à l’ordre du genre : tout en maintenant les différents épisodes qui signalent ou mettent en scène la bravoure militaire masculine, dans une famille qui, on l’a vu, de grand-père en père et de père en fils, aîné comme cadet, voue les hommes à la carrière des armes, la nouvelle édition supprime (p. 176) l’évocation incidente, à l’Hôtel de Ville, au sein de la « foule inquiète » des détenus en attente de leur jugement, de la « fille soldat » 333 . On objectera peut-être que cette suppression relève de la même catégorie, identifiée plus haut, des modifications du texte qui contribuent à l’épure du récit par l’élimination de personnages périphériques. Mais le même ordre de considérations aurait dû conduire à la suppression, par exemple, des évocations du sculpteur Pierre Chinard et de Mme de Saint-Fons 334 , ce qui n’est pourtant pas le cas (p. 176).
Illustrations
Participe de l’attrait de cette édition, notamment pour « la jeunesse », la présence, presque dans chaque chapitre, d’une ou deux gravures, hors-texte ou in-texte 335 . Trois ordres de considérations paraissent expliquer la présence de vingt-sept gravures au total.
Ces illustrations remplissent d’abord majoritairement (12 gravures) une fonction canonique qui consiste à proposer la représentation graphique d’un épisode du récit qui, en termes de dramatisation, s’apparente à une « scène » 336 , systématiquement rapportée, dans la légende qui accompagne l’image, à un passage du texte dûment référencé par une citation et l’indication de la page à laquelle elle se trouve. C’est d’abord le cas de la gravure qui fait office de frontispice :
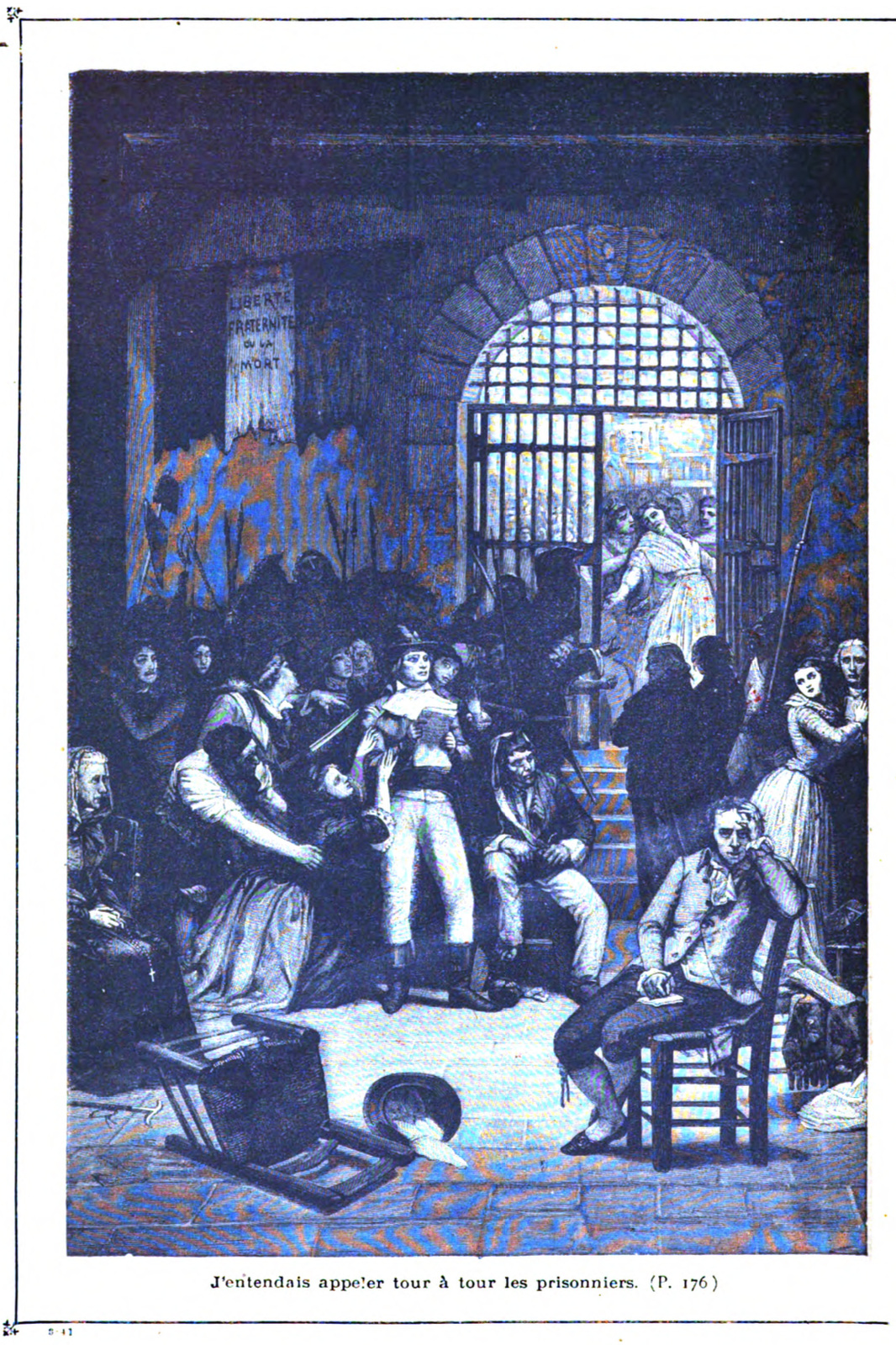
Légende : « J’entendais appeler tour à tour les prisonniers. (P. 176) »
C’est aussi le cas de certaines des gravures qui suivent :

Légende : « La fenêtre garnie d’une grille donnait sur la campagne. (P. 26.) »

Légende : « La Providence lui fit rencontrer un brave roulier. (P. 92.)

Légende : « A l’affaire de la chaussée de Perrache… (P. 77.) »

Légende : « Nous aurions été forcés de rester à la dernière poste. (P. 244) »

Légende : « Il ne s’approchait que des chaumières écartées et solitaires. (P. 142.) »

Légende : « Odile menait la plus triste existence (P. 254.) »

Légende : « Il avait servi parmi les Vendéens… (P. 141.) »

Légende : « Fatiguée de mes infortunes, j’ai gémi, j’ai pleuré. (P. 188.) »

Légende : « Ces réunions secrètes pour entendre la messe rappelaient les persécutions des premiers chrétiens. (P. 265.) »

Légende : « Ces voûtes de verdure nous gardèrent le secret. (P. 266.) »
Par sa légende, la gravure suivante relève de ce type d’illustration :

Légende : « Le Rhone. (P. 55.) »
Elle pourrait cependant relever d’une deuxième fonction des illustrations, non moins canonique et assez fréquemment exploitée (8 gravures), qui consiste à contextualiser le récit en fournissant une représentation des lieux emblématiques dans lesquels il se déroule. Significativement, la légende, dans la plupart des cas, ne fait pas référence à une page précise du récit. Ainsi de la ville de Moulins :
Ainsi encore de la cour de la prison des Recluses, dont la représentation est insérée, dans le texte, au moment où Alexandrine y pénètre pour la première fois :
Ainsi encore de la place Bellecour où se trouve l’Hôtel du Midi dont Mme Desplantes, emprisonnée avec la tante, est propriétaire, comme l’indique la référence. Mais on peut aussi considérer qu’il s’agit d’un lieu fréquemment évoqué dans le récit :

Légende : « LYON. Place Bellecour. (P. 116.) »
C’est à nouveau le cas de Genève, où se rend Alexandrine (chap. XVII) pour consulter le docteur Jurine (qui, dans cette nouvelle édition, n’est pas nommé) :
On en dira autant, à l’articulation des chapitres XVIII et XIX, de la représentation du Rhin, que traverse Alexandrine au cours de son voyage, relaté au chapitre XXI, vers son ultime place de gouvernante des enfants de la duchesse Louis de Wurtemberg :

Légende : « La majestueuse barrière du Rhin… (P. 315.) »
Que penser, en revanche, de la représentation de Saint-Pétersbourg qui correspond, dans l’économie du récit, à la même logique des lieux emblématiques, à cette différence importante près que si Alexandrine envisage d’abord de devenir gouvernante des enfants de la duchesse Louis de Wurtemberg, « alors à Pétersbourg » (p. 296), ce projet n’aboutit pas ? De fait, comme l’indique cet élément du sommaire du chapitre XX : « La guerre m’empêche de partir pour la Russie. »

Légende : « SAINT-PÉTERSBOURG. (P. 297.) »
La question de la pertinence de l’illustration par sa fonction de contextualisation des données de l’intrigue se pose aussi à propos de Lubeck, qui constituait, d’après ce qui est relaté dans le même chapitre XX, une étape du trajet vers Saint-Pétersbourg (« Une fois rendue à Lubeck, il [M. de Lancry] se chargeait du reste des frais jusqu’à mon arrivée à Pétersbourg », p. 296), mais que, pour les mêmes raisons, Alexandrine ne rejoindra jamais :
Cette question se pose encore à propos de la représentation de la ville de Nevers, dans laquelle Mlle Melon a certes une « maison », mais qu’elle n’occupe plus depuis que « le comité révolutionnaire du département de la Nièvre […] trouvait à propos de s’[y] établir » (p. 217).
On entrevoit par là une dernière catégorie de gravures, dont la présence ne se justifie pas par des considérations narratives, mais dont l’apparente gratuité peut s’expliquer par des raisons, sinon idéologiques, du moins pédagogiques au sens large, les illustrations étant susceptibles de servir de support à des leçons de géographie ou d’histoire (7 gravures).
De géographie lorsque se trouve représentée une ville qui n’est qu’incidemment mentionnée dans le récit. Ainsi de Chambéry, qui n’est évoquée qu’à l’occasion de la mention du lieu de destination des « petites Piolenc » (chap. V, p. 50) :
Ainsi d’Amsterdam, qui ne fait pas partie du trajet d’Alexandrine, mais dont il est incidemment question, dans une note, à propos du séjour de son frère aîné en Hollande : « Après avoir séjourné longtemps à Amsterdam, il avait été à Hambourg, d’où il se rendit près de nous. » (n. 1, p. 256) On observera au passage que, gratuité pour gratuité, la ville de Hambourg aurait pu également être représentée.
On peut en dire autant de la ville de Metz, dont la représentation n’est justifiée que par le fait que, dans sa jeunesse, le frère cadet, Chambolle, « fut envoyé à l’école militaire de Metz » (chap. I, p. 13).
D’autres gravures semblent répondre à un intérêt historique. Ainsi de la représentation de la Bastille, qui n’est guère motivée que par la mention incidente, dans le discours prêté à Chalier, de « l’infâme Bastille » qui a été détruite (chap. IV, p. 36) :
On peut en dire autant du portrait très officiel de Louis XVI, revêtu de tous les attributs symboliques de sa fonction de monarque, qui, d’après la page indiquée dans la légende, fait référence à l’évocation de son exécution : « La mort du roi ouvrait une ère sanglante » (chap. V, p. 54).
Le Temple, dernier séjour de la famille royale à Paris, est aussi représenté, mais pour un autre motif : il s’agit du lieu d’enfermement, sur décision de Napoléon Bonaparte, de « M. de la R. », dont le nom ne figure pas dans cette édition, le père de celle qui, comme l’explique une note, va remplacer Alexandrine, après son départ pour l’Allemagne, dans sa fonction de dame de compagnie, à Paris, de Mlle d’A… : « C’était Mlle Élisabeth de la R., dont le père, compromis dans une conspiration contre Napoléon, avait été arrêté et renfermé au Temple. » (chap. XXI, n. 1, p. 314)
Et c’est encore en note que, dans le chapitre XVIII, était évoqué le coup d’État du « 18 Brumaire an VIII (9 novembre 1799) », par lequel Bonaparte a « renversé le Directoire » (n. 1, p. 277), ce qui sert à justifier la présence d’une gravure :
Alors que le livre illustré demeure onéreux, on comprend que les ouvrages destinés aux « élèves » soient aussi conçus pour différents usages pédagogiques.
L’exemplaire consulté (BML, 477136 ; silo moderne) a fait l’objet d’une numérisation sur Google Books.
Cette édition, qui n’a pu être effectuée avec l’aval de l’autrice, n’a pas été prise en compte dans le relevé des variantes. La présentation détaillée de ses caractéristiques suffit à en apprécier la facture et la teneur. Il en va de même pour l’édition suivante.
« Épisodes du siège de Lyon (1793) », Bibliothèque de souvenirs et récits militaires, fasc. 35, t. III, Paris, Henri Gautier, [1897 337 ], p. 257-288.
Il s’agit d’une réédition partielle de 32 pages, signée du nom d’« Alexandrine des Écherolles », du texte de ses mémoires, effectuée « avec autorisation spéciale » de René de Lespinasse et des éditeurs, qui se base sur l’édition de 1879, comme l’indique, à la fin de l’extrait, cet avis du « Gérant » de la publication, Henri Gautier :
Les pages qu’on vient de lire sont extraites, avec autorisation spéciale du publicateur, M. René de Lespinasse, et des éditeurs, de Une famille noble sous la Terreur, par Alexandrine des Écherolles. (1 vol. in-18o, Plon, Nourrit et Cie.) (p. 288)
Conformément à ce qu’annonce le titre donné à cet extrait, « Épisodes du siège de Lyon (1793) », il correspond à une réduction du texte à un ensemble d’épisodes qui, en accord avec l’orientation de la collection, à la fois relatent des « souvenirs » – ils proviennent des mémoires d’Alexandrine des Écherolles – et relèvent des « récits militaires », la matière étant centrée sur le siège de Lyon en 1793.
Structuré en trois temps, qui évoquent successivement la chute de Chalier (I), le siège proprement dit (II) et quelques événements postérieurs à la levée du siège (III), l’extrait est organisé autour de la figure centrale du père d’Alexandrine, Giraud des Écherolles. Sa constitution procède d’un montage, plus ou moins complexe, de passages du texte repris à peu près tels quels : dans les portions prélevées, on n’observe que d’infimes variantes, peu nombreuses et peu signifiantes, erreurs manifestes, différences de ponctuation, suppression de certaines des notes de l’autrice qui ne sont pas essentielles à la compréhension de l’enchaînement du récit. Les emprunts concernent les chapitres V à IX de l’édition de 1879 qui, comme on l’a vu ci-dessus, adoptent, avec une pagination différente, un découpage équivalent à celui de l’édition de 1845 qui sert de texte de base à notre édition, mais ils ne sont pas effectués de manière continue :
Les choix se sont portés sur les différentes péripéties de l’histoire du siège afin de constituer une séquence qui non seulement suit la perspective chronologique du récit de l’autrice mais renforce sa linéarité. Ont ainsi été omis, d’une part, les effets de retour en arrière qui expliquent par exemple pourquoi, alors qu’il vit « dans une profonde retraite », Giraud a néanmoins « attiré sur lui l’attention » au point de se voir proposer le commandement général de la résistance lyonnaise 338 . D’autre part, l’extrait ne retient pas les passages, plus ou moins étendus, qui concernent des personnages considérés comme périphériques par rapport au projet éditorial : le rôle de Brugnon et, plus loin, l’histoire de cet ancien domestique du père d’Alexandrine 339 ; le retour du frère cadet Chambolle à Lyon 340 ; au cours de la quête à Saint-Irénée, la « scène » avec la riche avare 341 ; surtout la pose des scellés chez la tante, l’intrusion du citoyen Forêt, de sa femme et de leur fils « le municipal », l’arrestation de la tante, les visites d’Alexandrine en prison qui permettent de découvrir certaines des autres prisonnières des Recluses ou encore l’« antipathie » que se vouent les domestiques Cantat et Saint-Jean 342 .
En raison de l’importance déterminante des aventures de la tante dans l’économie narrative du récit d’Alexandrine des Écherolles, on voit que non content de réduire le texte, l’extrait proposé tend à infléchir ses enjeux narratifs et à les simplifier en polarisant l’attention sur son frère, père d’Alexandrine : loin d’être un acteur central du récit, comme pourrait le suggérer l’extrait édité, la présence de ce personnage est cependant, dans les mémoires de l’autrice, de plus en plus intermittente.
Dans le fascicule qui édite cet extrait, le texte est accompagné de trois gravures. La première, signée par Martin Claverie, concerne l’épisode du « combat de Perrache » (p. 265) :
La deuxième, signée par Auguste Victor Deroy, illustre les bombardements pendant le siège (p. 273) 343 :
La dernière, signée par E. Thomas, constitue un portrait de Fouché (p. 281), dont le nom apparaît par la suite au moment de la « perquisition » effectuée chez la logeuse de Giraud, dont le mari a « été dénoncé comme suspect à Fouché alors en tournée dans le voisinage » (p. 285) :
La présence de ce portrait peut paraître incongrue au vu de la faible importance que joue ce personnage dans la séquence construite dans l’extrait. Elle s’explique peut-être par des raisons idéologiques. L’extrait est en effet introduit par un court texte de présentation (« Le siège de Lyon (1793) », p. 257) dû à Paul Gaulot (1852-1937) 344 , qui s’étonne incidemment : « Qui eût pensé que ce Fouché, si terroriste alors, deviendrait un jour ministre de Napoléon, duc d’Otrante et serviteur de Louis XVIII ?... »
L’objet de cette introduction est, d’une part, de fournir un résumé de la séquence historique développée dans l’extrait qui ne dissimule pas son parti pris historiographique : « la Terreur commençait à Paris son règne odieux ». Il s’agit de mettre l’accent sur les particularités d’une histoire lyonnaise qui, politiquement parlant, se développe à contre-courant des événements parisiens : la « révolte ouverte », à l’initiative d’un « mouvement […] girondin », des Lyonnais contre le parti de Chalier, qui rêve « d’imiter […] les exploits sanguinaires de Marat », « soutenu par la lie du peuple », mais « arrêté », « jugé » et « guillotiné » le 29 mai 1793 ; l’entreprise de la Convention, qui en a chassé les Girondins, visant à « réduire la cité rebelle » ; la défense « héroï[que] » des Lyonnais face à des assiégeants supérieurs en nombre et supérieurement armés, jusqu’à leur capitulation le 9 octobre ; « la cruauté et l’excessive rigueur », dans l’exercice des « vengeances jacobines », des « envoyés de la Convention, Couthon et Fouché ».
Cette présentation évoque, d’autre part, les qualités du récit d’Alexandrine des Écherolles en lien avec le statut de son autrice au moment des événements. D’un point de vue historiographique, Paul Gaulot évoque l’intérêt d’un témoignage (« les témoins étaient alors aussi exposés que les combattants ») qui émane d’« une enfant de quatorze ans » et trouve place « à côté des histoires qui relatent les faits plus complètement ». C’est dire que, s’il est dit « précieux », le « récit », d’une facture « simple et sincère », vaut surtout pour les « pages émouvantes » qu’il donne à lire et parce qu’« il permet de pénétrer dans l’âme de ceux qui vécurent ces époques terribles ».
Exemplaire consulté : BnF, 8-G-2548 (35).
Une famille noble sous la Terreur, éd. Sandrine Fillipetti, Paris, Mercure de France, coll. « Le Temps retrouvé », 2020.
L’éditrice reprend le texte de l’édition de 1879, qui nous paraît moins riche que la « deuxième édition » de 1845. L’apport critique, rudimentaire, consiste dans l’adjonction de quelques notes éditoriales identifiant les personnages les plus connus évoqués dans le récit. L’édition comporte une très courte « Préface » (p. [7]-11), qui cite longuement le jugement de Lamartine (p. 9-10), et propose une grille de lecture du texte très discutable : quoique le texte, par l’impression, ait été livré au public, l’éditrice, sans doute influencée par le discours de René de Lespinasse, avance que, « la destination première de ces écrits étant circonscrite à la sphère du lectorat familial », ils présentent « une franchise dépourvue d’artifices et de saillies polémiques » (p. [7]) et procèdent d’« une entière franchise » (p. [7]).
Texte de base de la présente édition
Choix
Même si l’édition de 1879, avec ses rééditions successives jusqu’au début du xx e siècle, a été la plus fréquemment rééditée, y compris récemment, partant la plus massivement prise en compte dans la plupart des comptes rendus 345 et dans les quelques travaux critiques consacrés au texte d’Alexandrine des Écherolles, nous avons privilégié le critère de l’auctorialité en choisissant de donner à lire un texte dont la forme et la teneur ont été arrêtés par l’autrice elle-même, morte en 1850, et non par un éditeur ultérieur, fût-il son parent. En éditant un texte dont la version n’a été connue que de quelques lecteurs et lectrices ou souscripteurs et souscriptrices, nous espérons aussi pouvoir en renouveler l’interprétation.
Parmi les éditions publiées à l’initiative de l’autrice, nous avons retenu non pas l’édition originale, dans l’une (1843a) ou l’autre (1843b) de ses réalisations, mais la « Deuxième édition » de 1845 parce qu’elle est la plus complète : non que le texte proprement dit s’en trouve au sens strict revu puisque, comme on l’a vu, les feuilles composées pour 1843a et 1843b ont vraisemblablement été utilisées pour la confectionner, mais les « Notes et pièces justificatives », selon nous déterminantes dans le projet de 1843, s’y trouvent encore et surtout sont pour la première (et unique) fois ajoutées, dans l’histoire éditoriale de ce texte, des « Notes supplémentaires », dont la présence est soulignée sur la page de titre d’une édition dite « augmentée de notes importantes ».
Comme le signalent nos notes éditoriales aux endroits concernés, les corrections indiquées dans la liste des Errata imprimée dans l’exemplaire qui nous sert de référence ont été prises en compte dans le texte que nous éditons.
Traitement
Conformément à l’usage dans le protocole éditorial de la collection, nous avons conservé l’orthographe originale, sauf lorsqu’elle nuit à la lecture, ou quand l’autrice en a demandé elle-même la modification dans les errata en fin de volume.
Nous ne mentionnons pas ci-dessous les mots dont les corrections n’ont pas été portées dans le texte entre crochets.
Deux mots s’écrivent systématiquement sans accent circonflexe : « ame » et « grace ». À l’inverse, « déjeûner » a un accent circonflexe quand aujourd’hui il a été perdu.
L’accent aigu est parfois employé à la place de l’accent grave, comme dans « sacrilége » et « piége ».
Plusieurs mots contiennent un trait d’union qui, depuis, a disparu, comme « long-temps », « sauve-garde ».
Certaines consonnes ne sont pas redoublées, comme dans « rafinement ».
Parfois, certains mots ont une terminaison en –x, comme « verroux ».
Certains mots sont graphiés de manière différente à différents endroits du texte (« exigeances », 3 occurrences ; « exigence », 1 occurrence ; « redingotte », 2 occurrences ; « redingote », 4 occurrences) : nous avons maintenu ces effets de disparate.
En revanche, on a corrigé, entre crochets, les graphies de tous les termes dont une seule occurrence, sans doute à la suite d’une erreur de composition typographique, ne correspond pas à la graphie usuelle dans la langue du xix e siècle, de même que les accords grammaticaux qui ne sont pas effectués selon un usage par ailleurs très majoritairement respecté dans le texte.
Traductions
Traductions allemandes
Erinnerungen aus meinem Leben, trad. Wilhelmine Lorenz, Altenburg, E. R. Stauffer, Schnuphase’sche Buchhandlung, 1845, xii-287 p. ; 261 p.
Cette traduction, réalisée peu de mois après la publication de l’édition originale, comporte une préface (« Vorrede der Uebersetzerin », p. [xi]-xii), datée de mai 1844. La traductrice souligne le caractère édifiant de cet ouvrage, lié aux qualités religieuses et morales de son autrice, ainsi que l’intérêt historique que présente un récit qui donne à lire sous un jour nouveau les événements dramatiques de la Révolution française 346 . Elle remercie aussi l’autrice de lui avoir fourni des additions et des corrections, notamment pour certains noms propres mal imprimés dans l’édition en français, qui rendent sa traduction plus complète que l’originale 347 . Elle affirme enfin avoir, à la demande de l’autrice, conservé dans sa traduction le style simple et pur du texte français 348 .
La traduction comporte les « Notes et pièces justificatives », classées par chapitre : « Noten und Beweisschriften » (vol. I, p. 276-287) ; « Anmerkungen und rechtfertigende Zufäße » (vol. II, p. 245-261).
L’exemplaire consulté, conservé dans les fonds de la Bibliothèque nationale d’Autriche, a été numérisé sur Google Books. Un autre exemplaire, en tous points identique à cette édition, porte, sur la page de titre, le millésime 1846 : voir sa numérisation sur Google Books.
Unter der Schreckensherrschaft. Erlebnisse der familie Echerolles während der Revolution, trad. L. Öhler, Calm & Stuttgart, Verlag der Vereinsbuchhanbdlung, 1891, 232 p.
Cette traduction comporte une préface (p. [3]-4), non signée, datée de juillet 1890, qui rappelle l’existence d’une précédente traduction (voir ci-dessus). La traduction du texte d’Alexandrine des Écherolles, qui rapporte une histoire de famille ayant pour toile de fond les grands événements de l’histoire 349 , se présente comme une adaptation (« Ve[r]arbeitung ») sans doute basée sur l’ensemble des éditions qui se succèdent à partir de 1879 : les passages qui concernent principalement la famille de l’autrice, notamment dans le premier chapitre, ont été omis ou résumés, ce qui a entraîné quelques modifications d’ordre stylistique 350 .
L’exemplaire consulté, conservé dans les fonds de la Bibliothèque universitaire de Bâle, a été numérisé sur Google Books.
Traductions anglaises
Public Trials and Public Calamities: or the Early Life of Alexandrine des Echerolles, during the Troubles of the First French Revolution, London, Richard Bentley, 1853, xvii-312 p. ; vii-303 p.
Sur la page de titre, l’identité du traducteur ou de la traductrice n’est désignée que par des périphrases (« By the translator of “The Sicilian Vespers,” and the author of “Gentle Influence.” »), ce qui paraît désigner Frances M. Levett, qui fait paraître ce dernier ouvrage sous son nom en 1852 351 .
Aucun élément du paratexte n’est pris en charge par le traducteur. La « Preface » (vol. I, p. [xi]-xiii), traduction de celle d’Alexandrine des Écherolles, est curieusement datée de juin 1853. Cette traduction ne comporte pas les « Notes et pièces justificatives ».
L’exemplaire consulté, conservé à la bibliothèque de l’université Harvard, a été numérisé sur Google Books : vol. I ; vol. II .
Memoirs of Mlle. des Écherolles being Side Lights on the Reign of Terror. Translated from the French by Marie Clothilde Balfour with an Introduction by George K. Fortescue [1900], London & New York, John Lane, 1904, xxxvi-334 p.
L’ouvrage présente trois illustrations : deux portraits réalisés d’après des miniatures appartenant à la famille, l’un d’Alexandrine des Écherolles, en frontispice, (« Alexandrine Etiennette Marie Charlotte des Echerolles / Dame d’honneur de S.A.R. Mad. la Duchesse de Wurtemberg / Dame Chanoinesse de l’Ordre Royal de Ste. Anne de Bavière / 1779-1850 »), l’autre de son père (« Etienne François Giraud des Echerolles / Chevalier de l’Ordre Royal et Militaire de Saint-Louis / Maréchal des Camps et Armées du Roi, etc. / 1731-1810 », p. xxii/xxiii), ainsi qu’une gravure représentant « Le château des Echerolles » (p. xxvi/xxvii), qui correspond à la gravure de Moretti présente dans l’exemplaire consulté de 1843b.
Cette traduction est basée sur l’édition de 1879 : elle est dédiée par sa traductrice, Marie Clothilde Balfour, à « Monsieur Réné [sic] de Lespinasse (École des Chartes) », « Editor of the “Memoirs of Mdlle. des Écherolles” » (p. [v]) ; sa préface est également traduite (« Preface to the Edition of 1879 », p. xxiii-xxvi) avant celle de l’autrice (« Author’s Preface to the First Edition », p. xxvii-xxviii).
Comme l’indique le titre, la traduction comporte une « Introduction » (p. vii-[xxii]), signée par G. K. Fortescue. Elle est presque exclusivement consacrée, sans doute à l’intention du public anglo-saxon, à un récit des événements révolutionnaires lyonnais orienté dans une perspective ouvertement hostile à la Convention montagnarde : d’un côté, la résistance lyonnaise pendant le siège est saluée de manière appuyée (« a formidable show of resistance », p. xii) ; de l’autre, sont épinglés les personnages de Chalier, dont le culte est tourné en dérision, de Collot d’Herbois, inventeur du système des fusillades (« the system of Fusillades », p. xix), qui a organisé, avec Fouché, le système de la Terreur (« the system of Terror », p. xvi). Les « terroristes » sont ainsi voués aux gémonies (« a horde of terrorists, “Buveurs de sang,” as they came to be called », p. xiv), ce que souligne le bilan accablant (non sourcé) de leurs exactions : entre le 12 octobre 1793 et le 4 avril 1794, 1905 personnes exécutées, dont 1127 fusillées et 778 guillotinées (p. xxi). Parmi elles figure la tante de « Mademoiselle des Écherolles », jugée et condamnée avec onze autres femmes, toutes coupables du même crime : dissimuler ou ne pas dénoncer des maris, des enfants ou des proches (« that of concealing or of not denouncing husbands, children, or other relations », p. xviii).
Le texte d’Alexandrine des Écherolles est très sommairement caractérisé : l’auteur de cette « introduction » souligne sa dimension pathétique en lien avec le point de vue de la jeune fille qui l’informe (« the pathetic figure of a child brought face to face with the hideous, the cruel and the grotesque features of the Terror », p. viii), la simplicité et la sobriété du récit (« The story is told with a straightforward simplicity and absence of hysterical emotion which enlist our sympathies with its authoress at once », ibid.), la vivacité des évocations qu’il livre (« the life-like description which Mademoiselle des Écherolles gives of her own experiences », p. ix), mais aussi sa valeur historique (« apart from the personal interest of the story, the narrative has a distinct historical value », p. viii).
Cette introduction effectue plusieurs parallèles avec le discours de Manon Roland, ce qui peut surprendre en raison des divergences idéologiques qui l’opposent à celui, ouvertement aristocratique, d’Alexandrine des Écherolles : peut-être faut-il interpréter ce rapprochement, qui n’a pas d’autre équivalent dans l’« introduction », comme la manifestation de l’intuition, qui n’est jamais explicitement formulée, que l’une des originalités majeures du texte est d’être pris en charge par une énonciation féminine.
L’exemplaire consulté, conservé dans les fonds de la bibliothèque de l’université de Californie, a été numérisé sur archive.org.
Autres traductions
Alexandrine des Écherolles, Ivanov Avasilévič, Sud’ba Odnoj Ivorjanskoj Sem’i Ve Vremja Terrora, Izd. Knizu, magazina « Novazo Vremeni », 1882.
Principales sources manuscrites
Archives départementales de l’Allier
Archives de l’état civil en ligne : les liens correspondant aux vues consultées sont indiqués dans les notes éditoriales.
Nous avons consulté les trois volumes de l’Inventaire sommaire des archives départementales postérieures à 1790. ALLIER : t. I (série L), rédigé par F. Claudon et P. Flament ; t. II (série B), rédigé par M. de Flamare ; t. III (série L), rédigé par Max Fazy, Moulins, Imprimerie du Progrès de l’Allier, 1912-1938.
L 54. (Registre.) — In-folio, 204 feuillets, papier.
21 juillet 1790 – 14 décembre 1792. Procès-verbaux des séances de l’Assemblée administrative du département de l’Allier.
Séance du 9 août 1792, 9 heures du matin (fol. 94) : « mandat d’arrêt contre le sieur Girault [sic] des Echerolles, son ancien domestique et le sieur Faux, instituteur à Moulins » (t. I, p. 54).
Séance du 11 août 1792, 9 heures du matin (fol. 95) : « Le procureur syndic de Moulins a requis l’expédition de l’affaire Girault [sic] des Écherolles. » (t. I, p. 54)
Séance du 14 août 1792, séance de l’après-midi, 5 heures (fol. 100) : « MM. Petitjean et Simon sont désignés pour examiner le dossier de l’affaire Giraud [sic] des Echerolles, mis enfin entre les mains du Conseil. » (t. I, p. 56)
Séance du 21 août 1792, 10 heures du matin (fol. 117v) : « Rapport relatif à l’affaire Giraud des Echerolles (enrôlements contre-révolutionnaires) et à la procédure suivie dans cette affaire au tribunal du district de Moulins, qui a déclaré (jugement du 8 août) n’y avoir pas lieu à accusation et prononcé la levée d’écrou. » (t. I, p. 62).
Séance du 21 août 1792, séance de l’après-midi, 4 heures (fol. 119v) : « Suite de la discussion de l’affaire des enrôlements contre-révolutionnaires (Giraud des Écherolles, etc.) ; observations de M. Tourret fils. Le Conseil, “convaincu que le jugement du tribunal du district de Moulins est irrégulier et contraire à la loy” et “susceptible de cassation”, décide l’envoi du dossier au Ministre de la justice et au Comité de surveillance de l’Assemblée nationale. » (t. I, p. 62)
Séance du 27 août 1792, 10 heures du matin (fol. 128v) : « Rejet des demandes de passeports des sieurs Robin et Faux, impliqués dans l’affaire Giraud des Écherolles. » (t. I, p. 64)
L 62. (Registre.) — In-fol., xxiii-226 feuillets, papier.
1 er thermidor an II – 1 er jour compl. an III. 9 floréal [an II] (fol. 104) : « La maison Des Écherolles, à Moulins, servira de logement au représentant Guillermault ; des matelas et des draps seront fournis par l’hôpital militaire. » (t. I, p. 163)
L 82. (Registre.) — In-fol., xxi-197 feuillets, papier.
5 fructidor an II – 5 germinal an III. 28 pluviôse [an II] (fol. 152) : « Le citoyen Marigny, qui a été pendant vingt ans au service “de la fille Giraud Des Écherolles, condamnée” [Marie-Anne Des Écherolles], expose qu’il lui est dû plusieurs sommes et “trois années de gages, à raison de 300 l., faisant entrer dans ce prix la somme de 150 l. pour le bénéfice que lui rapportaient chaque année les parties de jeux qui se faisaient dans la maison de ladite Giraud”. Ses gages arriérés ne lui seront payés qu’à raison de 150 l. par an. » (t. I, p. 181)
L 123. (Liasse.) — 62 pièces, papier.
Août 1793 – messidor an III. [pièces no] 43 et 44 (26 m[essidor]) : « Étienne-François Giraud des Écherolles ayant exposé que, bien qu’il ait servi sa patrie plus de quarante ans et ait été pour elle couvert de blessures, ses biens ont été séquestrés ; qu’il a été prévenu d’émigration ; qu’il se trouve présentement sans asile ; main-levée provisoire de tout séquestre lui est accordée sous caution, jusqu’à sa radiation définitive de la liste des émigrés (t. I, p. 201). (12 mess[idor]) : « extrait des registres des arrêtés du Département relatif à la radiation d’É.-Fr. Giraud des Écherolles de la liste des émigrés » (t. I, p. 201).
L 163. (Liasse.) — 36 pièces, papier.
Floréal-thermidor an III. Sûreté générale . « Expéditions d’arrêtés du représentant Guillerault relatifs aux biens des émigrés, pris sur pétitions des parents ou des créanciers dont les noms suivent : […] 22, François Giraud des Écherolles » (t. I, p. 222).
L 703. (Registre.) — In-folio, 140 feuillets, papier.
10 brumaire an IV – 20 prairial an VII. 9 floréal [an IV] (fol. 32) : « Signalement d’Alexandrine des Echerolles, émigrée (gouvernante en 1807 des enfants de la princesse Louis de Würtemberg, et fille d’Etienne Giraud des Echerolles. Elle a laissé d’intéressants mémoires, sous le titre de : Quelques années de ma vie. Ces mémoires, publiés pour la première fois en 1843, ont été réédités en 1879 et 1892 352 sous le titr[e] de : Une famille noble sous la Terreur. Le château des Echerolles est situé à 20 kilomètres au sud de Moulins, canton de Neuilly-le-Réal, commune de La Ferté-Hauterive[)] […]. » (t. III, p. 2)
L 886. (Liasse.) — 14 pièces, papier, dont 5 imprimées.
An II. [pièces no] 8-11 (germinal) : « Pièces concernant les interrogatoires d’Alix, fermier des Echerolles, contre la famille Girault [sic]. » (t. III, p. 75)
Archives départementales du Loiret
Archives de l’état civil en ligne : les liens correspondant aux vues consultées sont indiqués dans les notes éditoriales.
Archives départementales du Lot-et-Garonne
Fonds Marboutin : 24J1 et 24J2. Une partie de ces papiers a été consultée par Jean R. Marboutin, qui semble avoir aussi constitué ce fonds à son nom, auteur d’une étude intitulée « Le château de Castelnoubel », Revue de l’Agenais, Bulletin de la société d’agriculture, Sciences et arts d’Agen, t. 38, 1911, p. 285-303, 398-408 et 477-493 ; t. 39, 1912, p. 35-55, 141-163 et 197-226.
Archives départementales de la Nièvre
Archives de l’état civil en ligne : les liens correspondant aux vues consultées sont indiqués dans les notes éditoriales.
Archives départementales du Rhône
Archives de l’état civil en ligne : les liens correspondant aux vues consultées sont indiqués dans les notes éditoriales.
42L21 – [Commission révolutionnaire :] Réquisitions et copies de lettres (frimaire-prairial an II)
Fol. 22 : demande de renseignements sur Etienne Joseph Giraud.
42L24 – [Commission révolutionnaire :] Décisions (frimaire-germinal an II)
Fol. 160 : décision concernant Etienne Joseph Giraud.
42L25 – [Commission révolutionnaire :] Tableau des inculpés et des sentences prononcées (nivôse-germinal an II)
Registre de main courante, Marie Anne Giraud.
42L27 – [Commission révolutionnaire :] Jugements (14 frimaire-24 germinal an II)
Jugements de la commission révolutionnaire entre 1793 et 1794, no 55, jugement de Marie Anne Giraud.
42L28 – [Commission révolutionnaire :] Procès-verbaux d’exécution par la fusillade (14 frimaire-24 pluviôse an II)
Procès-verbal d’exécution de Marie Anne Giraud.
Archives départementales de l’Yonne
Archives de l’état civil en ligne : les liens correspondant aux vues consultées sont indiqués dans les notes éditoriales.
Archives nationales
Correspondance générale de la Division criminelle du Ministère de la Justice, Affaires criminelles et correctionnelles.
Ain à Bouches du Weser (An IV-1816). BB/18/102, Dossier 4056(DD), 5 - Affaire de Giraud des Echerolles, demandant sa radiation de la liste des émigrés en s’appuyant sur des pièces suspectes des faux (prair[rial] therm[idor] V). Lien dans l’inventaire.
Papiers des Comités d’Instruction publique de la Législative et de la Convention, archives de la Commission des Monuments et de la Commission temporaire des Arts, du Conseil de Conservation, des dépôts littéraires et d’objets d’art et de science […].
Pièces 26-45, District de Moulins. Envoi par le commissaire Dufour d’inventaires résumant ou récapitulant les précédents, ou concernant les objets provenant des personnes indiquées ci-après (cf. F/17/*/13, no 984), an III (1794-1795), [28] Giraud des Echerolles, 8 germinal an III (28 mars 1795). Lien vers l’ensemble de l’inventaire.
Intérieur. Dossiers des fonctionnaires de l’administration préfectorale (xix e siècle), Dossier de carrière personnel.
Dossier GIRAUD DES ÉCHEROLLES, Jean Marie Étienne : F/1bI/158/18. Lien dans l’inventaire.
Dossiers de demandes : naturalisations, admissions à domicile, réintégrations dans la qualité de français, autorisations de servir ou de se faire naturaliser à l’étranger, changements de nom, dispenses pour mariage, majorats, dotations, armoiries (1823-1830), BB/11/257.
Dossier 6308 B6 : Giraud des Echerolles, Étiennette Marie Charlotte Alexandrine, « Autorisation de servir à l’étranger ». Lien dans l’inventaire.
Archives du grand-duché de Berg (1806-1813).
Pièces no 210-322, 3/e/sous-dossier : troisième trimestre 1812, correspondance relative au capitaine Giraud des Echerolles.
Pièces no 323-421, 4/e/sous-dossier : quatrième trimestre 1812. Réclamation par les sieurs Rousselle et Laisné de sommes qui leur sont dues par le capitaine Giraud des Echerolles. 5/e/sous dossier : cavalerie. Nomination du capitaine Giraud des Echerolles dans la brigade des lanciers. 9/e/sous dossier : projets de décrets. Nominations dans la brigade des lanciers du capitaine Giraud Des Echerolles, dans l’artillerie du lieutenant Zilger, dans la gendarmerie du capitaine Ruhle de Lilienstern et du lieutenant Tryst (mars 1813).
Lien vers l’ensemble de l’inventaire.
Archives numérisées
Intérieur. Émigrés de la Révolution française : dossiers nominatifs de demandes de radiation et de main-levée de séquestre (Ain à Eure-et-Loir), F/7/4849, Dossier 8762, GIRAUD-DESESCHEROLLES, Joseph François Martial ; GIRAUD-DESESCHEROLLES, Étienne François ; GIRAUD-DESESCHEROLLES, Étiennette Marie-Charlotte Alexandrine ; GIRAUD-DESESCHEROLLES Marie Anne. 199 pages. Lien.
Intérieur. Émigrés de la Révolution française : dossiers nominatifs de demandes de radiation et de main-levée de séquestre (Ain à Eure-et-Loir), F/7/4849, Dossier 8763, GIRAUD DE SAINT-COMBYE, Étienne Marie Joseph. 137 pages. Lien.
Études
Charles-Antoine Cardot, « Alexandrine des Echerolles, témoin de la Terreur à Lyon », in Germain Sicard (dir.), Justice et politique : la Terreur dans la Révolution française, Toulouse, Presses de l’Université Toulouse Capitole, 1997, p. 141-153.
Jean-Noël Dujtel, L’affaire Giraud des Echerolles, Moulins, Études bourbonnaises, no 259, 261, 1992. BML, 951617
Louis-Mathieu Poussereau, « Thaix et les Mémoires de Mlle Des Echerolles », Revue du Nivernais, t. IX, février 1905, p. 129-132 ; mars 1905, p. 165-168 ; avril 1905, p. 194-197 ; mai 1905, p. 205-210 ; juin 1905, p. 239-241 ; juillet 1905, p. 265-269 et 290-293 ; t. X, octobre 1905, p. 30-33.